L’impérialisme
des préjugés petits-bourgeois
nous cache le vrai Molière

L’impérialisme
des préjugés petits-bourgeois
nous cache le vrai Molière
RÉSUMÉ
Dialogue avec un professeur de Lettres de l’Université pour une compréhension critique du siècle conformiste de Louis XIV et une remise en cause du point de vue petit-bourgeois des études dix-septiémistes.
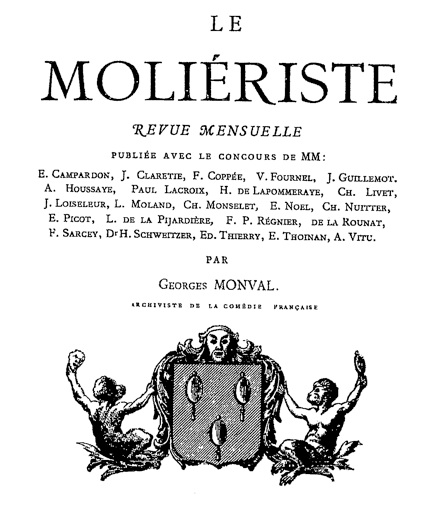
Ces entretiens ont eu lieu en septembre et octobre 2008, et se sont développés sur cinq séances d’enregistrement. Pour chacune d’elles, Denis Boissier et moi-même écoutions nos propos précédents et repartions où nous nous en étions arrêtés. Ces cinq dialogues ont été retranscrits par mes soins, et les seules corrections notables que j’ai cru nécessaires d’apporter sont quelques concordances de temps rétablies et plusieurs suppressions de mots superfétatoires que la spontanéité de l’oralité autorise mais que le mode écrit bannit autant que faire se peut. Ces modifications ont, bien entendu, été faites avec l’accord de M. Boissier. Je pense que l’on me saura gré également d’avoir mis entre crochets, à l’intention des lecteurs non spécialistes, les citations exactes auxquelles M. Boissier fait allusion ou qu’il citait de mémoire, ainsi que la date de publication des ouvrages mentionnés car, en tant qu’universitaire, je sais qu’il leur sera plus facile d’adhérer à ces thèses révolutionnaires si nous leur donnons la possibilité de vérifier que beaucoup de dix-septiémistes pensent, sur bien des points, comme M. Boissier. Aussi, je remercie l’auteur de l’essai L’Affaire Molière (Editions J.-C. Godefroy, 2004) et de la thèse Molière, Bouffon du Roi et prête-nom de Corneille (2007, hors commerce, édité par l’Association cornélienne de France) de m’avoir aidé à retrouver ces citations qui sont la preuve, en ce qui concerne Molière et Corneille, que rien n’est acquis, que rien n’est évident et que rien n’est simple.
Gérard DURAND, Professeur de Lettres à l’Université
PREMIER DIALOGUE
« Cessons d’idéaliser le XVIIe siècle qui fut le grand règne de l’hypocrisie… » (7 septembre 2008)
GERARD DURAND : J’ai lu que vous étiez le grand spécialiste de l’Affaire Corneille-Molière, qu’en pensez-vous ?
DENIS BOISSIER : Je doute qu’au XXIe siècle quiconque puisse se vanter d’être le "spécialiste" de quoi que ce soit. Faire le tour d’une question est une entreprise sans fin car toute question est pareille à Dieu dont une des définitions théologales est : son centre est partout et sa circonférence nulle part.
GD : Vous pensez que l’on ne peut jamais faire le tour d’une question ?
DENIS BOISSIER : Non. Surtout celles qui ont trait au passé. On ne peut aujourd’hui, en toute honnêteté intellectuelle, prétendre connaître le XVIIe siècle.
GD : Pourquoi cela ?
DENIS BOISSIER : Notre mentalité d’hommes modernes est à l’opposé de celle du XVIIe siècle. Ajoutez à cela que pour entrer de plain-pied dans le règne du Roi-Soleil il faudrait d’abord être familiarisé avec les XVe et XVIe siècles qui l’ont préparé et dont l’influence, bien qu’atténuée, demeure constante.
GD : Beaucoup d’érudition et une longue pratique des textes d’époque peuvent faciliter cette adaptation.
DENIS BOISSIER : Mais comment, par exemple, s’imprégner des réseaux traditionalistes et corporatistes qui agirent sur la politique, l’art et la religion du XVIIe siècle ? Qui aujourd’hui pourrait se vanter d’être "spécialiste", comme vous dites, de ces trois siècles, lesquels, par leur climat social, constituent un seul et même psychosystème, comme on dit un écosystème, plein de contrastes et de contradictions, et pour lequel le terme générique baroque convient assez, faute de mieux. Mais les universitaires délaissent l’ésotérisme propre à ces temps de bouillonnement culturel. Les travaux de Grasset d’Orcet ne sont jamais cités par les dix-septiémistes de la Sorbonne, et pourtant cet érudit hors du commun a passé toute sa vie à décrypter les arcanes, les grimoires et les palimpsestes de ces trois siècles. Il y a un lien subtil entre Paracelse, Cornélius Agrippa, Rabelais et le jeune Pierre Corneille, mais qui, aujourd’hui, en a conscience ? Par ailleurs, il est à craindre que nous soyons désormais incapables d’avoir une idée juste de l’univers mental des hommes du XVIIe siècle, à plus forte raison de l’univers mental du Roi-Soleil ou de celui de son bouffon favori.
GD : Etre dix-septiémiste n’est donc pas suffisant ?
DENIS BOISSIER : De la façon dont on vous apprend à l’être à l’Université, c’est en effet insuffisant.
GD : Que reprochez-vous à l’actuel cursus universitaire ?
DENIS BOISSIER : Comment voulez-vous que l’esprit petit-bourgeois né de la Troisième République puisse s’identifier à l’esprit Grand Siècle ?
GD : Sommes-nous si différents des contemporains de Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : Notre manière de comprendre et de ressentir la Vie, l’Homme ou Dieu, pour nous limiter à ces trois thèmes majeurs, est aux antipodes de celle d’un intellectuel ou d’un artiste du règne du Roi-Soleil. Nous avons une pensée moderniste, démagogique et républicaine. Ils avaient un mental axé sur la tradition féodale, la hiérarchie des valeurs, et ils étaient animés par une foi chrétienne si prégnante que je doute qu’un professeur de la Sorbonne puisse être en mesure aujourd’hui d’en éprouver la valeur ni même seulement la cohérence.
GD : Si je vous comprends bien, l’histoire a tellement changé depuis 1789 que nous ne pouvons plus comprendre ce qui animait les hommes qui vivaient cent ans avant la Révolution française.
DENIS BOISSIER : Exactement. Nous ne ressentons plus les choses comme eux.
GD : Tout de même, un coucher de soleil reste un coucher de soleil.
DENIS BOISSIER : Notre façon d’appréhender le monde est matérialiste, alors qu’ils le concevaient selon une pensée analogique et presque toujours anagogique, c’est-à-dire en ne perdant jamais de vue l’essence de toute chose. Ils pensaient verticalement où nous pensons horizontalement. Ils avaient un sens de la hiérarchie fortement ancré, et la conviction que le bien et le mal existent et se combattent. Or, depuis trois siècles, nous avons perdu un à un tous les sentiments et les intuitions qui leur donnaient la certitude d’être reliés à Dieu. Leur mental était architecturé par des principaux moraux et religieux, par une éthique humaniste que notre capitalist way of life a rejeté.
GD : Le propre de l’intellect humain n’est-il pas de parvenir à comprendre même ce qui lui ressemble peu ?
DENIS BOISSIER : Ce qui nous sépare des sujets de Louis XIV, et même nous oppose à eux, ce n’est pas un problème de compréhension intellectuelle, c’est une sorte de barrière que l’on pourrait qualifier d’ontologique. Nous avons perdu le sens du respect, de l’honneur et du devoir, le goût des symboles et notre intérêt pour la tradition. Jusqu’à nos liens avec la Nature qui sont rompus et, plus grave encore, nous ne ressentons plus en nous l’appel du sacré. Pour comprendre le XVIIe siècle, il faudrait pouvoir oublier cent cinquante ans d’industrialisation à outrance et son corollaire : l’abrutissement des masses. Comment, même pour les besoins d’un essai ou d’un roman, pourrions-nous nous remettre au diapason du système religioso-politique des castes, de la féodalité et de la royauté ?
GD : Peut-être y a-t-il une façon moins globalisante d’aborder le XVIIe siècle ?
DENIS BOISSIER : La seule que nous ayons trouvée, c’est l’approche romantique, pour ne pas dire romanesque. Cette approche romantique nous a donné le dogme "Molière auteur de génie". Mais le danger de faire de Molière notre contemporain, c’est de passer à côté de la réalité historique et de récrire le passé plutôt que d’essayer de le comprendre tel qu’il fut. Méfions-nous de la manière dont nous adaptons le passé à notre convenance et jugeons de lui à l’aune de nos préjugés intellectuels. Un exemple : on dit du XVIIe siècle qu’il est le siècle classique. Or, "classique" au sens où nous l’entendons, le XVIIe siècle ne l’a jamais été.
GD : Allons bon !
DENIS BOISSIER : Nous le disons "classique" et nous aimons à le définir parfait dans ses œuvres d’art, mais c’est seulement une vue de l’esprit moderniste, c’est-à-dire bourgeois. Et lorsque nous nous persuadons que sous Louis XIV l’art se présente comme miraculeusement indemne de toute contingence, nous sommes les dupes de notre idéologie républicaine.
GD : Vous n’allez pas dire que l’art du XVIIe siècle n’est pas empreint d’une certaine perfection ?
DENIS BOISSIER : C’est une affaire de goût. Montaigne ou Alfred de Vigny, ce n’est pas mal non plus. Et puis, qui donc appelez-vous "classique" ? Est-ce Boileau ou Molière, Corneille ou Racine ? Etes-vous certain que Molière ou Corneille, par exemple, soient des "classiques" ? Bien des spécialistes, pour reprendre votre terme, n’y croient guère, et je les comprends.
GD : Les œuvres de Racine, par exemple, ne sont-elles pas parfaites ?
DENIS BOISSIER : Le style de Racine est impeccable mais la pensée est étroite. Malgré les différents pays et les différentes époques où est censée se passer l’action, les personnages de Racine pensent et parlent comme des courtisans de Louis XIV, ce qui d’ailleurs agaçait beaucoup Pierre Corneille. Tout y est étroit et engoncé, maniéré et compassé. D’ailleurs, l’étude du champ lexical du théâtre racinien montre que son auteur a eu besoin d’à peine six cents mots différents pour écrire toute son œuvre.
GD : Mais n’est-ce pas cela le "classicisme" ? Une formidable économie de moyens que l’on retrouve aussi chez Mme de Lafayette avec son roman La Princesse de Clèves.
DENIS BOISSIER : Je suis d’accord avec vous : cette économie de moyens définit le prétendu "classicisme" du prétendu Grand Siècle. Nous admirons cette économie, mais la question est de savoir ce qu’elle cache. Richesse intérieure ou pauvreté morale ? Grandeur d’âme ou conformisme excessif ? On peut aussi se demander si ce n’est pas par dépit de ne pouvoir créer aussi puissamment et universellement que Pierre Corneille avec lequel il a longtemps espéré rivaliser, que Racine est devenu le champion d’une dramaturgie rétrécie. Et puis, moralement, Racine a prouvé qu’il était très en dessous de son œuvre, vous en conviendrez.
GD : Parce qu’il fut soupçonné de meurtre ?
DENIS BOISSIER : Je ne dis pas cela seulement parce qu’il fut accusé d’avoir fait absorber certains breuvages à sa maîtresse la comédienne Marquise du Parc. Trop souvent Racine a montré un caractère pour le moins médiocre.
GD : Vous pensez à son attitude envers Molière ?
DENIS BOISSIER : Je pense bien plus à cette sorte de lâcheté qui lui a fait renier sa vocation et ses œuvres dès que ses contemporains se sont mis à privilégier la bigoterie et à mépriser les arts et les artistes.
GD : Pouvait-il faire autrement quand tout le monde tournait le dos au théâtre ?
DENIS BOISSIER : Je ne lui jette pas la pierre. La crise dévote qui régna à partir de 1670 fut un monstre totalitariste auquel personne ne résista. Ce mouvement social a rendu hypocrite toute l’élite française. Cette hypocrisie a imposé que des comédiens comme Molière cessent d’être des comédiens pour devenir des "auteurs", c’est-à-dire des "honnêtes hommes", tandis que les véritables auteurs comme Racine ont dû cessé d’être des auteurs pour devenir des "personnes de qualité". Obliger chacun à cesser d’être ce qu’il est pour qu’il devienne conforme à l’hypocrisie bourgeoise, voilà ce qui m’empêche d’appeler cette époque : le Grand Siècle.
GD : C’est en effet le mauvais côté d’un siècle que j’ai encore la faiblesse, vous me pardonnerez, de considérer comme grand.
DENIS BOISSIER : La seule chose qui fut grande au XVIIe siècle, c’est la misère du peuple. Et quand je dis misère, je pense aussi à la misère intellectuelle. Sous Louis XIV, quatre-vingt-dix pour cent des Français ne savait pas écrire. A mon sens, une poignée de remarquables tragédies et quelques beaux récits maîtrisant parfaitement la litote et l’euphémisme ne suffisent pas pour que l’on puisse dire aujourd’hui, en toute honnêteté intellectuelle, que le XVIIe siècle fut classique, dans le sens de grand et parfait.
GD : Le Grand Siècle a tout de même donné l’ « honnête homme ».
DENIS BOISSIER : Sur le papier cela sonne bien, l’ « honnête homme ». Dans la réalité, cela a donné principalement « celui qui ne pense qu’à l’étroite réalité » ainsi que le définissait Nietzsche. Et cet homme-là s’est scindé en deux catégories. Primo : le spectateur des farces de Molière, futur abonné de TFI et de Canal Plus, autrement dit l’amateur du triumvirat "sexe, violence et sport". Secundo : le Roué, celui que l’on appellera un jour "le chevalier d’industrie", autrement dit le futur fraudeur du fisc, le futur accro aux délits d’initié. Au final, votre « honnête homme », qui ne le fut absolument pas, a engendré le Beauf et le Golden Boy. Votre « honnête homme », il s’est un jour appelé Voltaire, lequel jouait au philosophe tout en gagnant sa vie comme esclavagiste. Votre « honnête homme » règnera chez les voltairiens, tous ceux que Flaubert définissait comme « les gens qui rient sur les grandes choses. » Cet « honnête homme », qui est tout sauf honnête dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, étudiez-le de près, vous verrez qu’il s’exprime presque toujours au moyen de phrases toutes faites et ne défend jamais qu’un petit lot d’idées reçues, de ces idées reçues que Flaubert a, dans sa jeunesse, cataloguées pour s’en dégoûter tout à fait.
GD : Il n’y aurait donc rien à espérer de la société du Roi-Soleil ?
DENIS BOISSIER : Cessons d’idéaliser le XVIIe siècle qui fut le grand règne de l’hypocrisie… L’Université et l’Ecole laïque nous ont conditionnés pour qu’il nous en impose, alors qu’il devrait nous écœurer. Si par un coup de baguette magique nous nous retrouvions, vous et moi, dans le Grand Siècle, il ne nous serait pas supportable : trop de puanteur, d’injustices, de tortures, de superstitions.
GD : Oublions le quotidien, il reste les œuvres d’art, éternelles.
DENIS BOISSIER : Andromaque est un chef-d’œuvre, mais Racine n’est vraiment pas un type bien. Quitte à vous paraître paradoxal, je ne suis pas loin de conclure que c’est précisément la petitesse intellectuelle et l’étroitesse morale de leurs auteurs qui ont permis à des œuvres comme Andromaque, La Princesse de Clèves ou Les Maximes de La Rochefoucauld d’atteindre une certaine perfection formelle.
GD : Tout ceci, finalement, est une affaire de goût…
DENIS BOISSIER : Exactement. Et discuter de ce qui est artistiquement grand, ou ne l’est pas, n’est pas notre propos. Nous ne devons tenir compte que du contexte historique. Or, ce que l’on appelle le classicisme est la production d’une quinzaine de chefs-d’œuvre sur un très court laps de temps. Cette parenthèse ne doit pas nous leurrer sur ce que fut en profondeur le XVIIe siècle.
GD : Sur ce point, je suis d’accord avec vous. Le Grand Siècle est une mauvaise expression, car c’est tout au plus le règne de Louis XIV. Les universitaires préfèrent d’ailleurs appeler cette période le « second XVIIe siècle ».
DENIS BOISSIER : Là encore, nous nous illusionnons. Nous voulons croire que l’art sous Louis XIV était grand, fier et impeccable. Alors qu’il fut mesquin, guindé et obséquieux. On le prétend parfait : il est édulcoré, censuré et étroit. Nous croyons devoir l’admirer pour avoir atteint des sommets intellectuels. En vérité, jamais autant que sous le règne de Louis XIV l’art ne fut aussi viscéralement politisé, c’est-à-dire servile.
GD : Parce que l’élite de ce temps-là manque, selon vous, d’envergure morale ?
DENIS BOISSIER : Et aussi parce qu’à cause de ce manque d’envergure morale, l’élite du prétendu Grand Siècle n’a touché aucune extrémité. Elle est aussi éloignée du Peuple, dont les vertus sont essentielles, que des principes sacrés qui donnaient toute sa noblesse à l’Antiquité et, ce faisant, fondaient en droit la vraie pensée "aristocratique".
GD : En somme, le règne de Louis XIV n’apprécia que le juste milieu. Mais n’est-ce pas une vertu ?
DENIS BOISSIER : Ce n’est pas une vertu, c’est de l’étroitesse d’esprit. Et cette étroitesse d’esprit est une caractéristique de l’esprit petit-bourgeois. Les extrêmes ont toujours fait peur aux élites médiocres. Voilà pourquoi il y a peu de vrais philosophes sous le règne de Louis XIV mais beaucoup de moralistes et de coupeurs de cheveux en quatre. Vous conviendrez que l’expression des aspirations du Peuple et la liberté artistique et philosophique sont indispensables à toute société qui veut se survivre. Or, le XVIIe siècle les a volontairement ignorées.
GD : Dans ces conditions, pourquoi en sommes-nous arrivés aujourd’hui à admirer le XVIIe siècle comme si cette admiration allait de soi ?
DENIS BOISSIER : A cause de notre idéologie républicaine. Je prends pour exemple l’art, dans son acception la plus large. Comme depuis 1789, mais plus encore depuis la révolution industrielle, nous ne produisons que pour le grand public, nous avons fini par croire que le contraire de notre façon de faire, c’est-à-dire l’élitisme, était nécessairement la perfection. Et donc nous admirons, ainsi qu’on nous dit de le faire, l’art du XVIIe siècle. Mais c’est une admiration superficielle, et dangereuse.
GD : L’élitisme pas plus que la culture de masse n’est, selon vous, la solution.
DENIS BOISSIER : L’homme n’avance correctement que sur ses deux jambes. Notre société n’en a choisi qu’une, aussi, par compensation, elle idéalise tout naturellement l’autre. L’Ecole laïque et publique ayant façonné notre peu de jugement, le XVIIe siècle est devenu notre référence absolue. Mais c’est uniquement parce que nous avons refusé de voir que la nature de l’art prétendument classique est essentiellement politique. Nous avons préféré ne privilégier que son aspect formel, et encore, nous le disons parfait alors qu’il est seulement académique.
GD : Pour beaucoup de gens, académisme et perfection sont une même chose.
DENIS BOISSIER : Pour penser cela, nous sommes vraiment mal éduqués. Ou plutôt nous ne sommes pas éduqués du tout. Nous croyons que le siècle de Louis XIV est "classique" alors qu’il n’est bâti qu’à coups de faux-semblants. A tout prendre, les seuls hommes à avoir été "classiques" sous Louis XIV ont été les officiers supérieurs de l’armée du roi. Ceux-là, en effet, se faisaient tuer avec une grandeur toute stoïque, pour ne pas dire antique.
GD : En appelant le XVIIe siècle le Grand Siècle nous aurions donc, par commodité, trop simplifié une réalité nécessairement plus complexe...
DENIS BOISSIER : C’est le moins que l’on puisse dire car tous les artistes auxquels nous collons l’étiquette "classique" ont eu des styles divers et obtenu des résultats très différents. Leur seul prétendu classicisme, à tous ces artistes aujourd’hui tellement auréolés, est d’être demeurés aveugles à toute véritable grandeur d’âme. Tout ce qui est doré n’est pas d’or, et nous sommes très loin, en 1665, du siècle de Périclès…
GD : Les écrivains du XVIIe siècle n’ont-ils pas, précisément, comme point commun de s’être imposés dans leurs œuvres les principes d’Aristote, notamment la fameuse règle des trois unités ?
DENIS BOISSIER : D’abord, la règle des trois unités, qui est le pont-aux-ânes de nos manuels scolaires, n’a jamais été édictée telle quelle par Aristote. Cette règle est une mauvaise lecture d’Aristote. Ensuite, en obéissant à des règles aussi strictes, ces artistes sont allés contre leur naturel et, ce faisant, ont porté atteinte à l’intégrité même de leurs œuvres. Résultat : ils ont pratiqué la fausse grandeur.
GD : Qu’appelez-vous la « fausse grandeur » ?
DENIS BOISSIER : Celle qu’exigeait l’abbé d’Aubignac et tous les académiciens de salons. Cette "grandeur" que, par fatuité, ils appelaient le « naturel ». Mais ce prétendu « naturel » n’est qu’une vue de l’esprit. Et cet esprit-là fut celui d’une seule classe : la classe dirigeante. La "doctrine classique" dont se gargarisent nos dix-septiémistes fut élaborée par des pédants comme La Mesnardière ou l’abbé d’Aubignac. C’est une doctrine qui présente presque tous les aspects du terrorisme intellectuel.
GD : Du « terrorisme intellectuel » ?
DENIS BOISSIER : Oui. Que croyez-vous que furent les théoriciens du classicisme ? Des esprits totalitaristes, aussi étroits que mesquins, aussi vaniteux que courtisans. C’était une coterie, le haut de gamme des mondains qui paradaient dans les cercles et dans certains salons anciennement appelés « ruelles ». Ces doctrinaires s’étaient tous fait connaître en tant que censeurs de Pierre Corneille à l’époque du Cid [1637], certains d’entre eux étaient même ses adversaires en titre. Auprès de Louis XIV, ces maîtres de la Sorbonne se considéraient comme la race supérieure. La Mesnardière est allé jusqu’à exiger que le héros d’une tragédie soit toujours reconnaissant envers le roi [« Qu’on oblige le héros à parler avec respect des puissances souveraines, quand même ses infortunes partiraient de ce principe. » Poétique, 1639, 5]. D’Aubignac, le grand ennemi de Corneille, a interdit qu’une œuvre puisse dire du mal du roi ni même critique sa politique [« Nous ne voulons pas croire que les rois puissent être méchants, ni souffrir que leurs sujets, quoique en apparence maltraités, se rebellent contre leur puissance, non pas même en peinture. », Pratique du théâtre, 1659, 2, 1].
GD : Un art à la botte du pouvoir…
DENIS BOISSIER : Un art non seulement mercenaire mais aussi dénaturé. Chapelain dans les Sentiments de l’Académie sur le Cid [1637] affirme que la vérité historique ne compte pas et qu’on doit lui préférer dans les tragédies le goût de la bonne société. Comme il ne supportait pas le caractère de Chimène – pensez donc, elle aime celui qui a tué son père ! – Chapelain commande à Corneille de corriger Chimène, de passer sous silence le fait qu’elle a historiquement épousé le meurtrier de son père [« le poète ne doit pas craindre de commettre un sacrilège en changeant la vérité de l’Histoire. » Pratique du théâtre].
GD : Comment a réagi Corneille ?
DENIS BOISSIER : Corneille, qui se défiait de toute doctrine parce qu’il savait combien elle allait faire d’hypocrites et de doucereux, a refusé cette censure. Tout sa vie Pierre Corneille a lutté contre la tyrannie de la « bienséance ». Le grand héros du XVIIe siècle, ce n’est pas Molière le mercenaire mais Pierre Corneille le réfractaire. Comme le général De Gaulle, Corneille est celui qui a dit « non ! ». La doctrine classique mise en place dès Le Cid, celle de Chapelain, celle de La Mesnardière, celle de l’abbé d’Aubignac, cette doctrine-là est l’ancêtre du "politiquement correct" de nos médias. Quand le bourgeois devient la mesure même de l’Univers ( quelle plaisanterie, n’est-ce pas ?), ce qui déplaît au bourgeois doit disparaître. Et d’abord dans les arts.
GD : Expliquée ainsi, je comprends votre réticence envers des œuvres qui ont nourri, à partir de 1850, toutes les générations d’élèves.
DENIS BOISSIER : Je ne suis pas le premier à exprimer cette réticence, comme vous dites. Gustave Lanson, qui était un intellectuel extrêmement connu en 1900, a dit qu’il ne comprenait pas comment on pouvait enseigner à nos enfants une littérature écrite uniquement pour et par des monarchistes [« C’est une absurdité de n’employer qu’une littérature monarchique et chrétienne à l’éducation d’une démocratie qui n’admet point de religion d’Etat. », « Dix-septième ou dix-huitième siècle », Revue bleue, septembre 1905]. N’oublions pas que les doctrinaires du classicisme exécraient le peuple. Le peuple, qu’ils appelaient la « canaille », ne comptait pas pour eux. Et pas davantage les artistes, puisqu’ils sortaient presque tous du peuple. Pourtant, au XVIIe siècle, le seul à avoir éprouvé des sentiments véritables, c’est le Peuple dont la misère fut profonde et la douleur jamais feinte. A côté d’eux, D’Aubignac est un fasciste intellectuel, et Boileau un charlatan. Ce n’est pas pour rien que Voltaire surnommera Boileau le « flatteur de Louis XIV ». Au final, le seul lien entre tous ces artistes et intellectuels que l’Université croit devoir encenser, c’est leur plate dévotion envers le roi.
GD : De quoi refroidir mon admiration. Avez-vous un exemple de ce « terrorisme intellectuel » inhérent, selon vous, à cette époque ?
DENIS BOISSIER : Les écrivains étaient alors, ou bien voulaient tous être, membres de la Jet Set monarchique. Dans la préface de sa comédie Les Visionnaires, jouée en 1637 en même temps que Le Cid, Desmarets de Saint-Sorlin écrit :
Ce n’est pas pour toi que j’écris
Indocte et stupide vulgaire :
J’écris pour les nobles esprits.
Je serais marri de te plaire.
Ce ton, cette affirmation reflètent bien l’état d’esprit qui sera encore plus l’état d’esprit de la Cour de Louis XIV. Corneille est le premier grand auteur de tragédie à avoir proclamé qu’il écrivait d’abord pour le public. C’était courageux de sa part, car une gloire littéraire comme lui n’aurait dû penser qu’à l’élite de la société, c’est-à-dire la noblesse et le haut clergé. Mais non, Corneille voulait plaire au « public ». Ce « public » que Saint-Sorlin appelle le « stupide vulgaire »
GD : Cela explique sans doute les ennemis que Corneille s’est fait parmi les doctes.
DENIS BOISSIER : En effet. Corneille a eu pour adversaires les doctes, les mondains et les Précieuses (ridicules ?). Ceux-là mêmes dont il se vengera tardivement avec la participation active de Molière.
GD : Corneille est donc, vous n’en doutez pas un instant, un "classique" à part des autres. Il leur est différent par son état d’esprit et ses réalisations.
DENIS BOISSIER : Oui. C’est tout à son honneur d’avoir été bien plus qu’un grand classique.
GD : Comment définiriez-vous le classicisme du XVIIe siècle ?
DENIS BOISSIER : C’est un climat social fondé sur le principe de royauté lequel, par le biais d’un Louis XIV traître à sa propre cause, fut générateur de techniques artistiques établies sur des principes bourgeois. Le classicisme, c’est la synthèse d’un pouvoir totalitariste et des exigences d’une classe émergente, celle des grands bourgeois. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, devenu monarque absolu, Louis XIV a réduit au silence les corporations d’artisans et les fraternités d’artistes pour imposer ses propres Académies où régna aussitôt le favoritisme le plus choquant.
GD : Si je vous comprends bien, le classicisme, c’est "l’art bourgeois" dans toute la splendeur de ses débuts.
DENIS BOISSIER : Oui. L’art bourgeois rehaussé d’un reste d’esprit chevaleresque qui, très vite, s’est dissout dans la médiocrité mercantile. Votre « honnête homme » est vite devenu un « chevalier d’industrie ». Pour le Littré, un chevalier d’industrie est un escroc de bonne éducation, laquelle sert à tromper et à donner le change. Je vous l’ai dit, le règne de Louis XIV est celui du faux-semblant et de ses dérivés. C’est pour cela qu’il nous fascine, parce que notre société lui ressemble de plus en plus. Le petit monde de la télé, par exemple, c’est Versailles vu par l’œil de la caméra. Les magazines Gala et Voici sont les nouvelles versions de La Gazette et du Mercure galant. La Jet set est la noblesse d’aujourd’hui. Car aujourd’hui comme hier, il n’est question que des riches et de leurs extravagances, on n’admire que les monstres en tout genre. Et le "politiquement correct" a remplacé la « bienséance ».
GD : Cependant ces artistes dits classiques ne furent-ils grands par leurs techniques ?
DENIS BOISSIER : Des techniques assez efficaces, en effet. La bourgeoisie s’est toujours montrée industrieuse. Mais moralement ces artistes ne furent pas à la hauteur de leurs procédés techniques. Ils furent avant tout dévoués à la cause de l’égotiste Louis XIV, lequel, par crainte d’être dominé par la noblesse, exigea que l’on fût en toute chose bourgeois, c’est-à-dire d’esprit bas selon la définition de Flaubert. Le classicisme, c’est cet instant paradoxal, jamais saisissable, où un roi a secrété, un peu malgré lui, l’esprit petit-bourgeois. Car si Louis XIV n’était pas resté toute sa vie un enfant traumatisé par la Fronde, convaincu que sa vie était perpétuellement menacée par des ogres aux allures de grands seigneurs, jamais la royauté n’aurait permis à la pensée bourgeoise d’émerger, surtout si vite et si impérieusement.
GD : Vous accusez Louis XIV d’avoir trahi ses ancêtres ?
DENIS BOISSIER : C’est indéniable. Dès qu’il a pris la décision, à vingt-trois ans, de régner seul, il n’a choisi pour conseillers que des petits-bourgeois, notamment Colbert qui était fils d’un drapier, et prit pour bouffon Molière qui était le fils d’un « Tapissier du Roi ».
GD : Nous allons arriver à Molière, mais avant, je voudrais être bien sûr de vous avoir compris : nous appelons les œuvres d’art nées sous Louis XIV "classiques" parce qu’elles témoignent du commencement de la bourgeoisie, et que nous nous aveuglons sur la valeur ou les vertus de cette époque parce que nous en sommes, par bien des aspects, les héritiers ?
DENIS BOISSIER : Exactement. Nous avons hérité du XVIIe siècle l’hypocrisie et le goût du faux-semblant. Comment voulez-vous que l’art sous Louis XIV soit parfait alors que son ambition fut, avant tout, d’être « vraisemblable », c’est-à-dire de se conformer à la « bienséance » ? Autrement dit de s’adapter parfaitement aux usages de la bourgeoisie naissante. Croyez-vous que le but de l’Art, avec un grand A, soit d’être « bienséant » ?
GD : Pourtant, dans certaines œuvres, c’est la hauteur qui fut visée.
DENIS BOISSIER : Même si la hauteur fut visée, c’est un esprit bas qui animait ces artistes, parce que cet esprit était à la solde du pouvoir et que le pouvoir n’a jamais, et avec Louis XIV encore moins, les moyens intellectuels de ses prétentions.
GD : Il est vrai qu’un régime totalitaire se marie mal avec un art sincère.
DENIS BOISSIER : C’est même une constante historique. Et ce mariage mal assorti explique que les artistes qui voulaient s’élever au niveau des Grecs de la grande époque aient réussi exactement le contraire de ce qu’ils espéraient.
GD : Parce qu’ils ont tous obéi aveuglément à Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : Et que Louis XIV n’a rien produit autour de lui d’authentique ni même de moralement élevé. Au lieu d’appeler cet art "classique", nous devrions l’appeler "guindé". Tout fut gâché par le conformisme, qui s’appelait alors « l’étiquette ». Gâché aussi par l’esprit de compromission. Une élite qui ne ressent ni Dieu ni les aspirations du Peuple ne peut produire que de l’artificiel.
GD : Tallemant des Réaux a donc raison d’écrire que Louis XIV, qu’il connaissait bien, avait une intelligence en dessous de la moyenne.
DENIS BOISSIER : Tallemant des Réaux est lucide. C’est nous qui idéalisons un Louis XIV qui ne savait même pas bien écrire le français.
GD : Pour vous, dès l’instant où Louis XIV monte sur le trône, c’est la fin de la grandeur féodale et la mort de l’esprit chevaleresque.
DENIS BOISSIER : C’est, à coup sûr, la fin de la tradition et la disparition des confréries qui maintenaient intact l’esprit du travail non seulement bien fait, mais fait avec abnégation et humilité.
GD : Comme l’art des bâtisseurs de cathédrales.
DENIS BOISSIER : C’en est un parfait exemple, et rien de tel n’a été entrepris sous Louis XIV.
GD : Tout de même : Versailles !
DENIS BOISSIER : Le palais de Versailles s’est fait sans la moindre vision d’ensemble, toujours en tâtonnant et avec beaucoup de contradictions et d’erreurs rectifiées à grands renforts d’argent prélevé sur la sueur du peuple. Tout le contraire de l’esprit féodal et des cathédrales qui sont nées de l’âme du Peuple et des dernières grandes aspirations de l’Eglise. Avec Louis XIV, l’Eglise perdra son esprit et ne fera plus que tergiverser, tandis que le Peuple, ayant perdu son âme, n’aura de cesse de grommeler sa colère. Avec Louis XIV, c’est aussi la fin du grand art royal de la Danse, laquelle avait pour but, quand le roi dansait devant toute la Cour, de symboliser, et même de permettre analogiquement, l’harmonie dans son royaume.
GD : Pourtant Louis XIV dansait souvent et admirablement, dit-on.
DENIS BOISSIER : Pour le plus grand bonheur de sa Cour Louis XIV dansera une dizaine de fois en compagnie de son bouffon Molière. Mais c’est ce même Louis XIV qui signera dès 1670, parce qu’il est devenu « le roi très-chrétien », la mort du grand Art royal de la Danse et éloignera de sa Cour son partenaire privilégié Molière, ainsi que tous ses confrères en farceries, notamment ceux de la troupe de Scaramouche. Au final, le Roi-Soleil a réduit à peu de chose tout le glorieux passé dont son père fut le dernier garant.
GD : Une sorte de crépuscule des rois ayant pour décor le château de Versailles.
DENIS BOISSIER : La formule est bonne. Voilà pourquoi appeler la période allant de 1660 à 1700 le plus haut sommet de l’art en France est une vue académique. Car ce sommet-là est avant tout un déclin. C’est la mort de l’esprit traditionaliste, c’est la fin de l’artisan fier de son savoir et le déclin du respect que l’on doit au passé, et, trop souvent aussi, la destruction de l’harmonie en chaque chose.
GD : Vous pensez que l’art aurait été plus sincère si Louis XIV n’avait pas craint de n’être pas à la hauteur de ses ancêtres ?
DENIS BOISSIER : Sans doute. Louis XIV fut un esprit médiocre et pragmatique qui préféra être le patron des bourgeois plutôt que l’âme des princes. Les Grecs faisaient dans le marbre et le naturel, les serviteurs de Louis XIV firent dans le stuc et le compassé. Et si nous croyons devoir les admirer, c’est parce que nous sommes descendus moralement encore plus bas qu’eux, et que nous faisons désormais dans le plastique et le people. Loin d’être "classique" comme le fut l’art des Athéniens par exemple, l’art du XVIIe siècle est hypocrite et mystificateur, d’où l’abus en littérature de l’anonymat et des prête-noms. Et, preuve de sa pauvreté intrinsèque, cet art très encadré par les préjugés ne fera que s’appauvrir au siècle suivant.
GD : C’était inévitable, selon vous ?
DENIS BOISSIER : Oui, parce que le principe même de l’art bourgeois est contre-nature. Il est fait pour satisfaire des gens qui se flattent de n’avoir ni éducation ni goût, ceux-là mêmes dont se plaindront deux siècles plus tard Baudelaire et Flaubert. Comment voulez-vous que l’esprit bas, bienséant et mercantile, puisse prétendre toucher à l’universel et faire preuve d’un humanisme véritable ? L’IPPB [l’Impérialisme des Préjugés Petits-Bourgeois] est, par essence, un anti-humanisme et une politique contre la Nature. La guerre des Anciens et des Modernes, qui commence timidement au moment où Molière meurt, est révélatrice à cet égard. Les sottises qu’ont pu dire les Modernes à l’encontre de la pensée et de l’art antique témoignent d’une étroitesse d’esprit inquiétante. Faire table rase du passé et tout parier sur la modernité est un point de vue réducteur dont nous continuons aujourd’hui à pâtir. Et plus les artistes "modernistes", c’est-à-dire aux ordres de Louis XIV, ont illustré et défendu les préjugés bourgeois qui les protégeaient, plus leur inspiration s’est tarie. Les Hellènes n’auraient eu que dédain pour leur art de salon.
GD : Dans ce cas, pourquoi les manuels scolaires imposent-ils d’admirer les œuvres nées de cette politique ?
DENIS BOISSIER : Parce que le citoyen post-révolutionnaire ou, si vous préférez, le contribuable que nous sommes devenus, est socialement hypocrite. Car comment expliquer que, d’un côté, on nous conditionne pour admirer les œuvres nées sous Louis XIV et que, de l’autre, nous ayons tout fait, et continuions à tout faire, pour vivre dans une société qui, si l’on excepte l’hypocrisie et le faux-semblant, est l’antithèse de celle dans laquelle vécut Louis XIV ?
GD : Oui, il y a là comme une contradiction.
DENIS BOISSIER : L’existence même de cette contradiction est la preuve que nous sommes devenus incapables de comprendre ce que fut réellement le XVIIe siècle.
GD : En concluez-vous que nous tournons le dos à notre idéal républicain quand nous avouons notre fascination pour la littérature du XVIIe siècle ?
DENIS BOISSIER : Donner aux enfants de la République à admirer des œuvres nées de l’amour que leurs créateurs éprouvaient pour un roi égotiste, oui, je crois que l’on peut appeler cela de l’inconséquence morale et politique.
GD : Et ce serait cette « inconséquence morale et politique» qui nous fait admirer Molière et son œuvre ?
DENIS BOISSIER : Le cas de Molière est complexe. D’abord, nous l’admirons parce que nous croyons devoir admirer l’époque dans laquelle il vivait. Ensuite, nous le chérissons pour avoir combattu les travers de son époque, indiqué la voie d’un progrès social et humaniste. Du moins, c’est ce que l’on veut nous faire croire. Et grâce à cette façon malhonnête de présenter les choses, Molière gagne sur les deux tableaux. Et avec lui les institutions qui le représentent : la Sorbonne, l’Ecole publique, la Comédie-Française.
GD : Molière ou le consensus social.
DENIS BOISSIER : En tant qu’icône française Molière est un produit marketing parfaitement bien accepté et adapté à tous les besoins. Or, nous avons dit à quel point son époque n’était pas admirable. Il nous reste à comprendre pourquoi Molière, loin d’avoir combattu les erreurs de son temps, fut celui qui, parmi les artistes, en a profité le plus, du moins financièrement. Grâce au roi, en trois ou quatre années de bouffonnerie, Molière a gagné plus d’argent que Corneille durant toute sa très longue carrière. Nous aimons Molière parce que supposons qu’il fut un grand écrivain. Or, non seulement Jean-Baptiste Poquelin ne fut pas un écrivain, mais il assuma la fonction exactement contraire, puisqu’il fut le bouffon du roi. Le vrai Molière, le Molière historique, n’a rien à voir avec ce demi-dieu qu’aujourd’hui l’on vénère si docilement. Le culte qu’on lui voue est proportionnel à notre mécompréhension de ce que fut le XVIIe siècle. Nous idéalisons Molière comme nous idéalisons le règne de Louis XIV. Dans les deux cas, nous avons fait d’eux un mythe. Le « mythe du règne de Louis XIV » a dit bien avant moi l’historien Raymond Picard.
GD : Mais il n’a jamais dit que Molière lui-même était un mythe !
DENIS BOISSIER : Non, en effet. En raison de son cursus universitaire il ne lui était vraiment pas possible de porter un regard critique sur Molière, ni même d’écorner son image d’Epinal. Mais d’autres historiens, moins en vue certes, commencent à le faire…
GD : Je ne m’explique toujours pas pourquoi notre point de vue républicain aurait dénaturé la vérité historique.
DENIS BOISSIER : Cela a été fait pour satisfaire les besoins de l’enseignement de l’Ecole laïque.
GD : Pour la bonne cause alors…
DENIS BOISSIER : C’est cela. Afin d’éduquer le peuple nous avons peu à peu effacé tout l’aspect politique et propagandiste des œuvres d’art du XVIIe siècle. Comme cet aspect servile nous déplaisait, nous l’avons éliminé de notre vision. Ainsi, nous pouvons étudier les chefs-d’œuvre nés sous Louis XIV comme s’ils venaient d’esprits absolument dégagés de toute contingence. Le théâtre de Molière par exemple, n’est jamais étudié politiquement, seulement en tant qu’œuvre littéraire. Or, historiquement parlant, le théâtre moliéresque n’a jamais été conçu ni écrit ni joué en tant qu’œuvre littéraire. Mais dégager les œuvres d’art de leur contexte, et plus particulièrement le théâtre moliéresque, permet aux universitaires de les récupérer au profit de la République et de leur faire dire ce que notre idéologie veut entendre. Grâce à ce subterfuge, notre admiration pour le Grand Siècle, comme on dit, a pu s’institutionnaliser. Mais le concept "classicisme du dix-septième siècle" est uniquement franco-français. Les autres pays ne nous ont pas tous suivis dans cette vision politique.
GD : L’école dite classique n’aurait donc pas de réalité historique ?
DENIS BOISSIER : Comme je vous l’ai dit, historiquement il n’y a jamais eu d’"école classique", à peine une doctrine que la grande majorité des artistes ne suivit jamais réellement. La prétendue "école classique" dont on se pourlèche à l’Université est une vue de l’esprit de la Nouvelle Sorbonne fondée en 1888. L’objectif principal de la Nouvelle Sorbonne fut la canonisation laïque de Molière et, en seconde place dans le panthéon universitaire dix-septiémiste, de Boileau. Le prétendu joyau qu’était Molière fut donc placé dans un écrin fait exprès pour lui : l’ "école classique". Durant tout le XIXe siècle on s’est efforcé, à coups de contresens et en multipliant les tours de passe-passe, de rendre "classique" Molière. Mais même aujourd’hui on n’y est toujours pas arrivé, et pour cause !
GD : Vous ne croyez pas possible que l’on puisse y arriver ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non puisque le dogme « Molière moraliste » est le contraire de la réalité historique ! Le pontife Nisard a essayé. Le pontife Brunetière a essayé. Eugène Despois et Paul Mesnard ont essayé. Et plus récemment Antoine Adam et Georges Couton. Et maintenant Georges Forestier. C’est ce que le moliériste Claude Bourqui appelle le « processus de "classicisation" de Molière. » On a toujours voulu cacher que Molière était un bouffon, que Molière jouait des bouffonneries, que Molière était complètement immergé dans la farce italienne, que Molière n’avait cherché qu’à faire rire, que la littérature n’était pas son fort, etc. On a nié tous les commentaires de ses contemporains qui, eux au moins, savaient de qui ils parlaient. Cette négation de ce que fut historiquement Molière est aujourd’hui encore celle que nous impose la Sorbonne. Pourtant, comme l’écrit Claude Bourqui, cette façon d’envisager Molière fait bon marché de tous les exemples qui prouvent que la "classicisation" de Molière est une aberration littéraire [Claude Bourqui, Claudio Vinti, Molière à l’école italienne, 2003]. Molière est un farceur et il ne fut que cela. Il n’a jamais conçu le moindre projet littéraire, ni même pensé en tant qu’auteur au sens où nous comprenons aujourd’hui ce mot [« Nous inclinerons à penser qu’il n’y a pas de projet, pas de direction dans l’œuvre de Molière, si ce n’est la dynamique de la conquête d’un marché et la continuelle adaptation à un environnement mouvant. » Claude Bourqui, Molière à l’école italienne, 2003, p. 13]. Molière fut un farceur qui devint le bouffon du roi, c’est dire qu’il ne travailla qu’à fabriquer du rire, d’abord pour son roi, et ensuite pour le « parterre », ainsi qu’on appelait les spectateurs pauvres.
GD : Si je vous comprends bien, et pour reprendre votre formule, la théorie de l’ "école classique" fut une sorte d’écrin étincelant dans laquelle on s’empressa de cacher les défauts du joyau Molière. L’école classique serait en quelque sorte un miroir aux alouettes.
DENIS BOISSIER : Un miroir aux étudiants plus exactement. L’"école classique" dont se gargarisent certains n’a jamais satisfait un seul véritable artiste, ni rassemblé ceux-ci. Elle est le fait de quelques doctes imbus d’eux-mêmes, comme le fut d’Aubignac qui attaquait Corneille surtout parce que celui-ci refusait d’apprendre de lui comment devait être écrite une belle tragédie. Cette "école classique" est un leurre dans laquelle la critique du XIXe siècle a essayé de faire entrer, au point où ils en étaient, les prétendus amis de Molière : Racine, Boileau et La Fontaine.
GD : Parce qu’ils n’étaient pas non plus des amis ?
DENIS BOISSIER : Racine, Boileau et La Fontaine se connaissaient, étant du même métier. Mais aucun des trois ne fut l’ami de Molière.
GD : La Fontaine ne fut pas l’ami de Molière ?
DENIS BOISSIER : Aucun document d’époque ne prouve une quelconque amitié. Les contemporains prêtaient à La Fontaine une épigramme cruelle envers Molière et son jeune amant Baron. Et certains ont dit qu’il était l’auteur d’un pamphlet non signé contre les mœurs de Molière et plus encore contre celles de sa jeune femme, Armande [Les Intrigues de Molière et celles de sa femme ou La Fameuse Comédienne, 1688].
GD : Parce qu’elle cocufiait Molière ?
DENIS BOISSIER : Entre autres raisons, oui. La Fontaine qui avait aimé Les Fâcheux [1661] à une époque où il ignorait que l’auteur en était principalement Pierre Corneille, avait, avec le temps, appris qui était Molière. En fin de vie, il confia à son ami Le Verrier qu’il était « indigné », c’est le mot qu’il utilise, par le théâtre de Molière [« Je ne sais pas ce que Molière pensait des Contes de La Fontaine, mais pour celui-ci que j’ai fort connu, il était indigné contre certains caractères que Molière a mis sur le théâtre. », Cité dans Georges Mongrédien, Recueil des textes et des documents du XVIIe siècle relatifs à La Fontaine, 1973, p. 207].
GD : Pourtant, j’ai lu certains textes qui font allusion à l’amitié entre La Fontaine et Molière.
DENIS BOISSIER : Ce sont des anecdotes imprimées au XVIIIe siècle, elles n’ont aucune valeur historique. Il est bien sûr possible que La Fontaine, par l’intermédiaire de Boileau, ait rencontré Molière. La Fontaine, comme tous les écrivains de son temps, rêvait d’approcher le roi et serrer la main à son bouffon pouvait se révéler stratégique. Mais qu’ils aient été des amis, cela non. Quant à Racine, son fils nous apprend qu’il n’appréciait pas Molière et que Molière le lui rendait bien. Bien sûr, ils se sont rencontrés et ont parlé théâtre, mais très vite ils se sont fâchés.
GD : Boileau, lui, fut l’ami de Molière, non ?
DENIS BOISSIER : Son amitié avec Molière est à double tranchant comme l’ont constaté le moliériste Léon Chancerel, et René Bray qui fut le biographe et de Boileau et de Molière. Les vers les plus critiques envers le théâtre moliéresque viennent de Boileau.
GD : Et quelques éloges aussi…
DENIS BOISSIER : Ce n’est pas surprenant de la part de celui qui rêvait d’être le poète officiel de la Cour et qui était le « flatteur de Louis ». Mais dès que le roi s’est détourné de Molière, Boileau en a fait autant. Et Molière mort, Boileau l’a tout de suite renié, cela a même choqué certains. L’un d’eux a écrit un poème pour piquer au vif Boileau [« Cœur lâche qui poursuis les vivants et les morts, /Tu m’adorais vivant, maintenant quand je dors / Tu me lances les traits d’une âpre calomnie : / Du titre de bouffon tu noircis mon génie. […] », Défense du poème héroïque, 1674].
GD : Oublions ces amitiés incertaines et revenons à ce que vous appelez « la canonisation laïque de Molière ».
DENIS BOISSIER : Dès 1863, c’est-à-dire sous Napoléon III, Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, avait chargé le moliériste Eudore Soulié d’établir les bases de la biographie officielle de Molière. Il faut toujours s’inquiéter lorsqu’un gouvernement, quel qu’il soit, décide de prendre en charge un artiste et d’en faire son porte-parole. Ce fut le cas avec Molière. En 1888 on créa la Nouvelle Sorbonne et l’ambition de cette Nouvelle Sorbonne – canoniser Molière et Boileau – devint celle de l’Ecole républicaine de Jules Ferry, laquelle s’empressa d’auréoler le théoricien Boileau, et de distribuer aux élèves des "bons points" à l’effigie de Molière.
GD : D’autres historiens partagent-ils votre point de vue quelque peu, comment dirais-je… iconoclaste ?
DENIS BOISSIER : Plusieurs l’ont dit avant moi, notamment" l’éminent René Bray, qui était pourtant un fervent moliériste [cf. Boileau, l’homme et l’œuvre, 1941], en ce qui concerne l’"école classique.
GD : Quand je pense à tout ce que mes professeurs ont pu me raconter sur l’amitié entre Molière et La Fontaine, Molière et Boileau, comment tous les grands artistes de ce temps se réunissaient pour préparer un art supérieur…
DENIS BOISSIER : Lorsque Boileau réunissait ses compagnons, c’était pour boire. Molière et son acolyte Chapelle aimaient beaucoup boire. Mais jamais une anecdote ne montre Molière discutant sur l’art en général ou sur le sien en particulier. Au contraire, il était connu pour ne guère aimer parler en présence d’écrivains, ce qui indique bien que Molière n’était pas un intellectuel.
GD : Donc, pas d’amitié entre les grands noms littéraires de l’époque et pas d’ "école classique" aux bancs de laquelle ces amis du théâtre se seraient assis.
DENIS BOISSIER : Comme je vous le disais, il n’y a jamais eu d’"école classique", à peine une doctrine du "naturel" et du "vraisemblable" qui reflète une pensée bourgeoise qui s’est révélée plutôt stérile. Cette doctrine, qui avait commencé avec La Pléiade et qui s’est poursuivie avec la Querelle du Cid, a été définie principalement par l’abbé d’Aubignac.
GD : Le grand adversaire de Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Oui, toujours lui. Pour d’Aubignac, une tragédie ne doit faire mention que de ce qu’il plaît à la « bienséance ». Et ce qui plaît à la « bienséance », ce sont les choses qui sont « vraisemblables » c’est-à-dire acceptables par l’esprit petit-bourgeois [« Il n’y a donc que le vraisemblable qui puisse raisonnablement fonder, soutenir et terminer un poème dramatique. Ce n’est pas que les choses véritables et possibles soient bannies du théâtre ; mais elles n’y sont reçues qu’en tant qu’elles ont de la vraisemblance ; de sorte que pour les y faire entrer, il faut ôter ou changer toutes les circonstances qui n’ont point ce caractère, et l’imprimer à tout ce qu’on y veut représenter. », La Pratique du théâtre, 1657].
GD : C’est un peu étroit comme doctrine artistique.
DENIS BOISSIER : Elle horripilait Pierre Corneille. Surtout qu’il fallait respecter la règle des trois unités, même dans des œuvres qui s’en passaient fort bien.
GD : Et Molière, que pensait-il de la nouvelle doctrine ?
DENIS BOISSIER : Molière ne s’est jamais occupé de doctrine artistique, qu’elle soit classique, ancienne, moderne ou ce que vous voulez. Et les doctes, qui n’avaient absolument rien à faire avec le « premier fou du Roy », n’ont jamais étudié le théâtre moliéresque. Molière avait si peu à voir avec la littérature qu’il n’a jamais préparé aucune édition des pièces que l’on publiait sous sa signature.
GD : Peut-être n’avait-il pas le temps de se pencher sur les gros ouvrages de l’abbé d’Aubignac…
DENIS BOISSIER : Ni le temps ni l’envie. Il laissait cela à Messieurs les auteurs comme il les appelle ou, plus prosaïquement, il laissait à son associé Corneille ces questions qui ne rapportaient pas d’argent. Mais vous me demandiez tout à l’heure si d’autres que moi portaient sur cette période le même jugement.
GD : En effet… Et vous avez cité René Bray qui ne croyait pas non plus à l’école classique.
DENIS BOISSIER : En ce qui concerne le but poursuivi par la Nouvelle Sorbonne en 1888, lisez l’universitaire Ralph Albanese. Il est moliériste, mais américain, ce qui lui évite de pratiquer l’autocensure qui est la règle chez nous [Molière à l’Ecole républicaine, De la critique universitaire aux manuels scolaires (1870-1914), 1992, Ed. Anma Libri. California, USA].
GD : L’"école classique" était LE sujet de thèse par excellence des universitaires du XIXe siècle. Ils se seraient donc tous trompés ?
DENIS BOISSIER : C’est ce que l’on appelle l’esprit du temps. Et l’esprit du temps est toujours étroit d’esprit. Il en a toujours été ainsi. Même si l’"école classique" fut le cheval de bataille de Sainte-Beuve, elle n’en demeure pas moins un leurre ou, si vous préférez, un abus de langage.
GD : Je n’ai pas de préférence...
DENIS BOISSIER : Alors, disons que ce fut un abus du conformisme intellectuel petit-bourgeois. D’abord celui de la Restauration, ensuite celui de la Troisième République. Ce que j’appelle l’IPPB [l’Impérialisme des Préjugés Petits-Bourgeois]. Je vous le répète : nous idéalisons le XVIIe siècle parce que nous nous faisons de lui une idée fausse et très superficielle. Nous ne le voyons que de notre point de vue moderniste.
GD : Vous voulez dire que, selon l’expression bien connue, nous nous faisons "du cinéma" ?
DENIS BOISSIER : On peut le dire ainsi. Le XVIIe siècle made in Sorbonna, c’est beau, c’est propret – mais c’est une vision des choses étonnamment réductrice. C’est comme si nous étions convaincus que les dinosaures sont exactement ces squelettes que nous admirons dans les musées d’histoire naturelle, et que nous ne voulions pas admettre qu’ils avaient, de leur temps, une peau, des os et des muscles. Nous croyons aimer Molière, Boileau ou Racine – nous n’aimons que les statues qu’on nous présente. Ce que l’on nous apprend à aimer, ce sont de belles fictions démagogiques. Chaque spécialiste a constaté cela avant moi mais, par souci de ne pas heurter le consensus national, ils ne combattent que mollement les préjugés actuels.
GD : Or, il est temps, selon vous, de mettre en garde le public ?
DENIS BOISSIER : Oui, l’Histoire n’est pas du cinéma avec des méchants dévots tout en noir et de beaux comédiens de blanc vêtus. Au XVIIe siècle il n’y a aucun surhomme, ni même de héros, il n’y a que des sujets obéissants au roi tout-puissant. Et Molière, en raison de son emploi de bouffon du roi, fut le plus zélé de tous.
GD : Il nous faut donc apprendre à aimer des êtres vivants parfois déplaisants, et non des squelettes fossilisés presque toujours admirables ?
DENIS BOISSIER : Exactement.
GD : Et vous voulez que nous commencions par Molière…
DENIS BOISSIER : Oui. Il serait bien que nous commencions à aimer Jean-Baptiste Poquelin et oubliions Molière, ce héros de théâtre qui ne paraît vrai qu’à la lueur trompeuse des flambeaux que brandissent les « dévots de Molière », car c’est ainsi que se définissent les moliéristes.
GD : Qu’est-ce qui vous gêne le plus dans Molière tel qu’on nous le donne à admirer ?
DENIS BOISSIER : C’est un personnage de théâtre, un demi-dieu à usage laïque auquel on ne prête, par excès de démagogie et de star system, que de belles actions et de nobles sentiments. Jean-Baptiste Poquelin, lui, est un homme. Un homme de son temps. Un homme qui, lorsqu’on se donne la peine de le connaître, nous force à redescendre sur terre. Mais les « dévots de Molière », accrochés à leur statue dorée, ne veulent pas le faire tomber de son piédestal.
GD : On peut les comprendre.
DENIS BOISSIER : Mais mon cher Gérard, c’est précisément ce que je fais. Je crois les avoir parfaitement compris, c’est pour cela que je combats leur foi naïve. Car cette foi absolue en Molière parangon de l’ « humain trop humain » se révèle sclérosante pour ceux qui n’ont pas l’âme d’un dévot.
DEUXIÈME DIALOGUE
« Cessons d’idolâtrer Molière, le plus servile des courtisans. » (14 septembre 2008)
GERARD DURAND : Parlons de Molière puisque il est l’auteur le plus emblématique du XVIIe siècle. Depuis deux siècles tous les exégètes ont essayé de définir son théâtre, et aucun, semble-t-il, n’y est parvenu. Même pour les moliéristes, il n’y a aucune certitude et personne n’a pu nous dire quel homme se cache derrière le masque du plus célèbre des comédiens français. Le « Mystère Molière » écrivait-on en 1880… et en 2008 nous ne savons toujours pas quel homme fut Molière.
DENIS BOISSIER : En effet, tout et son contraire ont été dits sur lui. Chaque thèse s’oppose à la précédente. Mais il y a plus inquiétant : aucun point du dogme moliériste ne résiste à une analyse réellement historique ; d’ailleurs, chaque spécialiste s’est fait un malin plaisir de démolir tel ou tel article du dogme.
GD : Mais tous considèrent Molière comme un grand homme et un génial auteur de théâtre.
DENIS BOISSIER : Certes, mais après cent vingt ans de propagande intensive les moliéristes n’ont jamais réussi à se mettre d’accord ni sur l’homme ni sur l’auteur que fut Molière. Ne croyez-vous pas que c’est la preuve que le moliérisme, en tant que méthode d’analyse, cache un grave vice de forme ?
GD : Heureusement que vous êtes là pour sonner l’alarme.
DENIS BOISSIER : Vous ironisez, mais un fait sociologique est patent : Molière est l’opium des dix-septiémistes. C’est d’ailleurs pour cela que le moliérisme est devenu une religion d’Etat dès 1863, et que les moliéristes se sont aussitôt définis comme les « dévots de Molière ».
GD : Aujourd’hui tous ne sont pas forcément des "dévots".
DENIS BOISSIER : Ceux-là commencent à nous rejoindre. Mais c’est au compte goutte. Comment voulez-vous qu’un universitaire parfaitement conditionné puisse ne pas finir "dévot de Molière" ? Comment combattre les préjugés des pères fondateurs de la République ? Comment laisser place à la vérité historique quand les mensonges doctrinaires remplissent toute la place publique ? Plus encore, comment un dix-septiémiste pourrait-il, même si l’envie lui en venait, renier un cursus sanctifié par un diplôme flatteur ?
GD : Dites-vous cela parce que je suis universitaire ? Non, je plaisante, je ne sais que trop qu’il est presque impossible pour un doctorant d’aller à contre-courant d’une thèse officielle, quelle qu’elle soit.
DENIS BOISSIER : Rendez-vous compte : on a écrit entre 1830 et 1880 plus de trois cents pièces de théâtre avec pour personnage Molière ! En 1870 on clamait « Vive Molière ! » à chaque coup de canon qui nous protégeait des Prussiens. Je vous assure que dans les décennies qui suivirent bien des universitaires ont été envoûtés par le « dieu » Molière, jusqu’à porter en sautoir ou en collier une dent ou un bout de mâchoire que l’on pensait avoir été les siennes.
GD : A quelle époque cette mode saugrenue ?
DENIS BOISSIER : Autour de 1880.
GD : C’est du fétichisme ou je me trompe ?
DENIS BOISSIER : Cela y ressemble. Et ce fétichisme-là n’est qu’un des aspects le plus anodin du culte national rendu à Molière. Comme je vous l’ai dit, ce culte date de l’après Révolution française et lorsque les chefs révolutionnaires exigèrent de retrouver la dépouille du « grand homme », on exhuma, au mépris de la vérité historique, la dépouille de Molière là où elle n’avait jamais été enterrée.
GD : C’est là, me semble-t-il, l’illustration de ce fait bien connu que le Mythe est plus fort que l’Histoire.
DENIS BOISSIER : En effet. Et c’est pourquoi Molière fut en quelque sorte sanctifié.
GD : On est allé jusque-là ?
DENIS BOISSIER : Vous n’imaginez pas jusqu’où on a pu aller. Après la Restauration, le critique d’art Théophile Thoré a écrit que Molière ne ressemble à aucun type humain et qu’il est formé à l’image de Dieu. Et cet imbécile préconise très sérieusement aux Françaises de faire l’amour devant le portrait de Molière afin de mettre au monde des garçons beaux et forts et courageux et intelligents comme Molière ! [« Presque toutes les têtes de l’histoire ancienne ou moderne ont une analogie plus ou moins lointaine avec quelque race animale ; Molière ne ressemble à aucun type de la création inférieure. Il est véritablement formé à l’image de Dieu, suivant le symbole de la Genèse. Et comme les Athéniens recommandaient à leurs femmes, afin qu’elles procréassent de beaux enfants, d’orner leurs maisons avec les statues des gladiateurs et des héros, de même on pourrait conseiller aux matrones de notre temps de placer dans leurs alcôves le portrait de Molière. Les générations futures y gagneraient sans doute en beauté physique et morale », Théophile Thoré, Salon de 1847, Introduction].
GD : On a peine à y croire…
DENIS BOISSIER : Et ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan d’idolâtrie déversé pendant des décennies. En 1870 Molière est un saint républicain, et même plus.
GD : Par chance, vous, vous n’êtes pas envoûté par Molière.
DENIS BOISSIER : C’est gentil de me rassurer… Les Français depuis deux siècles croient en un "Molière génie universel" parce qu’ils ont hérité de l’esprit petit-bourgeois de la Troisième République. Cet esprit passe de génération en génération parce que la Troisième République, comme chacun le sait, a très bien su enrégimenter la gent professorale. A l’Ecole, nous apprenons à admirer Molière pour tout ce qu’il ne fut pas. C’est aussi surréaliste que si nous avions fait de Baudelaire le parangon de la ligue des vertus civiques.
GD : Un parangon moral, c’est ce que nous avons fait de Molière ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Non seulement nous nous leurrons sur lui, mais nous avons à cœur de nous mentir à nous-mêmes.
GD : Je ne suis pas certain de vous suivre.
DENIS BOISSIER : Je m’explique. Notre monde étant de plus en plus déshumanisé et mécaniste, nous avons besoin de héros. Mais à cause de notre besoin naturel d’admiration, et parce que l’esprit moderne est par nature bourgeois, nous avons édulcoré la carrière et le théâtre de Molière. Nous avons fait de lui un « grand auteur incomparable », et de son théâtre une « œuvre classique », alors que Molière et son théâtre furent tout le contraire.
GD : C’est-à-dire ?
DENIS BOISSIER : Molière est, au XVIIe siècle, « le premier farceur de France », comme le définissait son contemporain Somaize. Ou, si vous préférez, le « Héros des farceurs » ainsi que l’appelait l’académicien Valentin Conrart. Historiquement donc, le farceur nommé Jean-Baptiste Poquelin a fait ses débuts sur le Pont-Neuf où opéraient le farceur Tabarin, les charlatans et les tire-laine, et il a terminé sa carrière sous le masque de Scapin. Or, Scapin avec son grand sac est très précisément l’imitation du célèbre Tabarin, et Les Fourberies de Scapin, signées Molière, sont un plagiat des scènes les plus drôles d’une pièce de Rotrou, La Sœur [1647].
GD : Mais les autres pièces, les grandes pièces de Molière qui font aujourd’hui l’admiration unanime des critiques du monde entier !
DENIS BOISSIER : C’est bien là le problème. Sous le prétexte que son nom est sur des couvertures de pièces publiées en raison des scandales que le « premier farceur de France » suscitait, les universitaires de 1880 ont décrété que Molière était en l’auteur.
GD : Ce qui paraît logique, non ?
DENIS BOISSIER : Pas forcément si nous nous replaçons dans le contexte historique. Je n’ai pas à vous rappeler que nous n’avons de la main de Molière aucun manuscrit, aucune lettre ni aucune annotation. A cause de beaucoup trop d’indices précis, graves et concordants, il est plus que probable que Molière, en signant ses spectacles, s’est contenté d’en assumer la responsabilité comme le faisaient alors toutes les vedettes de la scène.
GD : Dans ce cas, pourquoi les premiers historiens ne l’ont-ils pas dit ?
DENIS BOISSIER : Parce que sous la Troisième République nous étions en pleine crise de dévotion républicaine, en plein nationalisme anti-prussien et, pour compliquer les choses, en plein combat anticlérical. Or, présenté sous un certain éclairage artistique, Molière pouvait servir d’icône idéologique à ces trois combats.
GD : Mais depuis…
DENIS BOISSIER : Depuis, l’instinct grégaire et le conformisme des universitaires ont fait le reste. Même le moliériste Antoine Adam a fini par prendre conscience de ce processus. Pour lui, on admire Molière par esprit d’orthodoxie, et la critique universitaire fait de même par conformisme [« On s’expliquerait mal certaines formules d’admiration si l’on ne savait combien l’esprit d’orthodoxie peut fausser le goût, et de quelles erreurs est capable une certaine critique avant tout soucieuse de prouver son conformisme. » Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1997, T. I, p. 431].
GD : Ainsi, aimer ou ne pas aimer Molière est un acte politique ?
DENIS BOISSIER : La littérature n’a que très peu à voir dans l’Affaire Corneille-Molière. Lorsqu’on nous refuse la parole, croyez-vous que cela soit pour des raisons littéraires ? Lorsque aucun grand éditeur ne veut publier ma thèse [Molière, Bouffon du Roi et prête-nom de Corneille, pour l’heure éditée hors commerce par l’Association cornélienne de France, 2007], pourtant écrite selon les règles de l’art, avec chaque citation parfaitement référencée, et dans laquelle je n’avance pas un argument sans l’aval d’un dix-septiémiste éminent, croyez-vous que la raison de ce refus ait son origine dans l’amour des éditeurs pour la littérature et la recherche ?
GD : Je ne suis pas assez candide pour l’affirmer. Toutefois, je n’avais pas mesuré à quel point l’Affaire Corneille-Molière était un enjeu politique.
DENIS BOISSIER : Un enjeu politique et un enjeu économique. Ceux qui défendent la thèse officielle ne le font pas toujours pas conviction littéraire, ni même par conviction politique, mais simplement par souci carriériste. Molière est le gagne-pain de beaucoup d’esprit routiniers qui ne souhaitent qu’une chose, c’est que tout reste en l’état, puisqu’ils en vivent bien. Au XIXe siècle, les dix-septiémistes étaient moliéristes par patriotisme. Au XXe siècle, ils devinrent moliéristes par esprit de corps. On est moliériste à la Sorbonne comme on est parisianiste à l’Académie française, cela ne se discute même pas.
GD : Ils pourraient au moins avoir des doutes.
DENIS BOISSIER : Même lorsqu’on a des doutes, on se dit : pourquoi serais-je le premier à vouloir enrayer la belle mécanique de la Sorbonne ? Pourquoi serais-je celui par qui le scandale arrive ? Parce qu’ils n’ont osé aucun bémol, les dix-septiémistes du XXe siècle ont fait de Molière un auteur de théâtre comme l’étaient Giraudoux ou Montherlant, et même un « chrétien » comme se voulait Mauriac, alors que, grâce à l’appui de Louis XIV, le Jean-Baptiste Poquelin historique fut seulement un comédien entrepreneur de spectacles, comme l’étaient toutes les vedettes de la scène, à ceci près – et là tient tout le mystère de sa glorieuse postérité – qu’ayant assumé la fonction honorifique de bouffon du roi, Molière devint après sa mort une sorte de mythe urbain. Et ce mythe urbain est devenu peu à peu incompréhensible parce que l’on a refusé de tenir compte, précisément, qu’il avait été le bouffon du roi. Pourtant son contemporain Le Boulanger de Chalussay, qui le connaissait bien, a écrit noir sur blanc que Molière est « le premier fou du Roy » [Elomire hypocondre, 1670, I, 3 ; Elomire est l’anagramme de Molière].
GD : Voilà une expression qui doit déplaire à beaucoup !
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! J’ai étudié la fonction de bouffon du roi telle qu’elle se présente jusqu’à Louis XIII. J’ai recensé 26 caractéristiques qui déterminent un bouffon du roi. Eh bien, ces 26 caractéristiques, Molière les possède toutes. D’ailleurs, avant que Molière ne devienne une religion d’Etat et qu’il était encore possible, vers 1850, de dire certaines vérités, il est arrivé à Anaïs Bazin, un des pères du moliérisme, d’employer l’expression « bouffon émérite » [Notes historiques sur la vie de Molière, 1851, p. 74]. Aujourd’hui une telle expression est tout bonnement interdite à la Sorbonne.
GD : Si Molière a réellement été le bouffon du roi, comment expliquer que de son vivant il a pu être appelé « l’illustre Molière » ? Sa biographie apporte-t-elle des réponses à cette question ?
DENIS BOISSIER : L’« illustre Molière » dont vous parlez est un qualificatif qui signifie simplement que Molière est le favori de Sa Majesté. Il n’est « illustre » que parce que Louis XIV le veut bien. D’un autre côté, cet « illustre Molière », qui vous en impose semble-t-il, n’est pas à proprement parler un individu particulier mais un "homme public", c’est-à-dire une représentation sociale qui résulte de l’action de trois fortes personnalités : celle de Madeleine Béjart qui fut la formatrice de Jean-Baptiste Poquelin, celle de Pierre Corneille qui fut son associé et celle de Louis XIV qui fut son protecteur. Trois influences qui se sont succédé, puis conjuguées à partir de 1659. Mais c’est surtout grâce à Pierre Corneille qui fut son mentor dès ses débuts provinciaux en 1643, et son principal associé en 1658, que Jean-Baptiste Poquelin est devenu Molière. Pas le Molière que nous admirons, lequel n’a jamais existé, mais le Molière historique, l’"homme public" qui défrayait la chronique, nous dirions aujourd’hui la vedette people.
GD : A vous entendre, Jean-Baptiste Poquelin n’aurait eu qu’une faible part dans la genèse de Molière.
DENIS BOISSIER : Comme toute star qui pour réussir est aux mains de son coach et aux ordres de son producteur.
GD : Pierre Corneille et Louis XIV.
DENIS BOISSIER : Oui, l’homme de l’ombre et le Roi-Soleil.
GD : Vous ne reconnaissez aucune qualité à Jean-Baptiste Poquelin ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr que si ! Jean-Baptiste Poquelin fut un homme particulièrement souple de caractère et capable de s’adapter à toutes les circonstances. Un farceur bien rôdé qui s’est transformé en une véritable icône médiatique. Mais si Jean-Baptiste Poquelin et ses compagnons n’étaient pas venus vivre à Rouen durant le printemps et l’été 1643, et plus encore en 1658, et si Pierre Corneille n’avait pas été le collaborateur de Molière, ce dernier n’aurait pas eu, littérairement parlant, matière à intéresser l’Université. La postérité n’aurait retenu du comédien Molière que le fait qu’il fut à la fois un comique célèbre et l’amuseur attitré de Louis XIV.
GD : Reprenez-moi si je me trompe, mais Molière a tout de même à son actif le fait d’être devenu un personnage incontournable de son temps. N’est-ce pas dû à sa personnalité ?
DENIS BOISSIER : Pas nécessairement. C’est parce que Louis XIV, qui avait déjà adopté Molière, a permis à la satire Les Précieuses ridicules [1659] d’être représentée malgré l’interdiction qui la frappait, que la carrière de Molière a pris une ampleur démesurée.
GD : Sans le roi et sans Corneille nous n’aurions jamais entendu parler de Molière ?
DENIS BOISSIER : Pas plus que de Raymond Poisson ou de Montfleury, lesquels furent pourtant de célèbres comédiens-auteurs, c’est-à-dire des prête-noms, que le peuple encensait alors.
GD : Ces comédiens ont aussi publié des pièces ?
DENIS BOISSIER : Ils ont même eu droit à une édition de leurs œuvres complètes. Mais tous les spécialistes savent que ces comédiens n’ont pas écrit les œuvres parues sous leur nom.
GD : Evidemment, aucun de ces acteurs n’étaient un écrivain.
DENIS BOISSIER : En effet : pourquoi la nature aurait-elle brusquement donné aux comédiens le génie de l’écriture, eux qui s’en sont parfaitement bien passés avant et après le règne de Louis XIV ? Dieu, dans Son infini goût pour les spectacles, aurait brusquement décidé de gratifier les plus célèbres comédiens de cette époque de tous les dons ? Vous devinez bien que c’est un phénomène de société. Comme la censure sociale empêchait les écrivains de s’exprimer, la société a tout naturellement contourné le problème en permettant aux comédiens de devenir leurs prête-noms. En raison de leur ancien statut d’excommunié ils pouvaient sur scène tout se permettre. Sous Louis XIV, sans les comédiens, les poètes étaient condamnés au silence. Après cela, vantez-moi les vertus du Grand Siècle !
GD : Et il en serait de même pour Molière.
DENIS BOISSIER : Pourquoi voulez-vous qu’il en aille autrement ? Parce que Molière est aujourd’hui notre gloire nationale ? Ce n’est pas une raison. Il est ici question du Molière historique, pas du culte. Le Molière historique était connu, comme tous ses compagnons de scène, pour n’être pas l’auteur des pièces qu’il signait. Philippe de La Croix, qui n’était pas un ennemi de Molière, témoigne que Molière est « un homme qui n’est riche que des dépouilles des autres » [La Guerre comique, 1663].
GD : Oui, je sais que ses contemporains l’ont accusé d’être un plagiaire. Mais ils l’ont aussi comparé à Térence !
DENIS BOISSIER : Lequel était connu de tous les lettrés du XVIIe siècle pour avoir été le prête-nom de l’homme politique Scipion. Vous savez comment se prénommait Scipion ? Cornélius... Ceci rend encore plus ironique l’équation Molière = Térence. Et le Romain Térence fut le prête-nom de Cornélius pour la même raison que Molière fut celui de Corneille.
GD : Parce que Scipion était une gloire nationale et qu’il ne pouvait pas se permettre d’écrire des comédies…
DENIS BOISSIER : … Alors que Térence, lui, était un esclave. Scipion ne pouvant, à cause de son rang, s’offrir le plaisir de s’amuser de la bêtise de ses contemporains, c’était l’esclave Térence qui signait les satires qu’il écrivait.
GD : On dirait que les mœurs ne changent guère.
DENIS BOISSIER : En tout cas, pas sur ce point. Que Térence ait été le prête-nom de Scipion était pour les sujets de Louis XIV une vérité historique indiscutée. Dans ses Stances à M. de Moliere sur sa comédie de l’Ecole des Femmes [1663] Boileau a été le premier à faire allusion au fait que Corneille est derrière Molière comme Scipion était derrière Térence.
GD : Il dit cela ?
DENIS BOISSIER : Oui, mais à mots couverts, comme c’était alors la règle. Et son maître l’abbé d’Aubignac, dans sa Quatrième dissertation [1663], faisant allusion à l’allusion de Boileau, confirme l’équation Scipion-Térence = Corneille-Molière.
GD : Que disent les moliéristes ?
DENIS BOISSIER : Ils n’ont, semble-t-il, jamais remarqué que ces deux écrivains levaient un peu le voile sur la collaboration Corneille-Molière. J’en ai fait un article pour le site corneille-moliere.org, sous le titre « Boileau, d’Aubignac, La Fontaine dévoilent la collaboration Corneille-Molière. » [rubrique ARTICLES A LIRE EN PRIORITE ; aussi sur le présent site]. Aucune réaction de ces Messieurs de la Sorbonne.
GD : C’est pourtant une sorte de scoop littéraire !
DENIS BOISSIER : On peut voir les choses ainsi. Mais croyez ma vieille expérience, il ne se trouvera pas un seul dix-septiémiste pour reconnaître que ma grille de lecture a permis de comprendre une petite énigme littéraire. En effet, comme d’Aubignac disait dans sa Quatrième dissertation que Boileau parlait de Corneille dans ses Stances, les moliéristes s’étonnaient puisque le nom de Corneille n’était pas cité par Boileau. Et depuis des décennies aucun moliériste n’avait trouvé la clef : Scipion le Romain = Corneille le Romain. Ils expliquaient que l’abbé d’Aubignac s’était trompé ou qu’il s’était mal exprimé.
GD : Cela les arrangeait de le croire…
DENIS BOISSIER : Imaginez un instant qu’ils acceptent de lire réellement Boileau et d’Aubignac… et tout le dogme moliéresque s’effondre.
GD : Quelqu’un d’autre a-t-il dit que Corneille se cachait derrière Molière ?
DENIS BOISSIER : La Préface du Tartuffe, qui est le texte le plus personnel que Corneille ait jamais écrit, y fait allusion lorsqu’elle rappelle que des Anciens, les « premiers en dignité », ont écrit des comédies [« Elle (l’Antiquité) nous apprendra que de ses plus grands hommes, et des premiers en dignité, ont fait gloire d’en composer eux-mêmes. »]. Il ne peut s’agir que de Scipion et Lélius, les hommes de l’ombre du comique Térence.
GD : Qu’en disent les moliéristes ?
DENIS BOISSIER : L’éminent Georges Couton est d’accord qu’il est bien question dans la préface de Tartuffe de Scipion et de Lélius.
GD : Pour une fois que vous avez la même opinion !
DENIS BOISSIER : Oui, mais l’éminent moliériste oublie d’en tirer la conclusion qui s’impose : si la préface de Tartuffe était de Molière il n’aurait jamais évoqué le fait que Térence était le prête-nom de Scipion et Lélius, car cela revient à dire que lui-même, si souvent comparé à Térence, est le prête-nom de Pierre et Thomas Corneille.
GD : En effet, dire que Térence n’avait pas écrit ses comédies aurait été stupide de la part de celui qui était le mieux placé pour savoir qu’on le comparait à Térence.
DENIS BOISSIER : En revanche, nous avons ici un exemple de l’ironie savante de Pierre Corneille.
GD : D’autres ont-ils dit aussi que Molière n’était pas l’auteur de ses pièces ?
DENIS BOISSIER : Le savant Adrien Baillet, qui n’était pas un homme de théâtre, écrit : « On prétend que Molière ne savait pas même son théâtre tout entier » [Le Jugement des savants sur les principaux ouvrages des auteurs, 1686]. Remarquez qu’il a soin de préciser on prétend que… C’était donc une chose connue de tous. Et Donneau de Visé qui, lui, travaillait avec Molière, nous apprend que « le Parnasse s’assemble, lorsque Molière veut faire quelque chose »[Réponse à l’Impromptu de Versailles, 1663].
GD : Même si Molière n’a pas écrit tout son théâtre, nous ne pouvons pas lui enlever le mérite d’avoir été un grand comédien !
DENIS BOISSIER : Uniquement dans la comédie ! Nous avons, par esprit républicain, et parce que cela nous flattait, fait de Molière un grand comédien alors que tous les témoignages attestent que ses contemporains l’ont toujours trouvé exécrable dans les rôles tragiques, et excellent seulement dans la pantomime et la pitrerie. Une anecdote raconte qu’on lui a jeté des légumes quand il s’évertuait à jouer la tragédie. A l’évidence, le seul emploi qu’il incarna parfaitement fut celui de bouffon du roi. D’ailleurs, lorsque Molière, dans le Premier Placet présenté au roi sur la comédie du Tartuffe [en 1664], fait allusion à sa fonction, il a soin d’utiliser le mot « emploi » ; or à son époque on utilisait le mot « emploi » pour une fonction officielle, comme l’a d’ailleurs admis Georges Couton [« le mot emploi a toujours une coloration officielle et ne peut pas désigner, je crois, la simple vocation de comédien. C’est que Molière est déjà un personnage officiel. » (Molière, Œuvres complètes, 1971, T. I, p. 1331].
GD : Nous allons parler de cet « emploi » de bouffon du roi mais juste avant, j’aimerais que vous rappeliez par quels mécanismes s’est opérée la métamorphose posthume de Molière.
DENIS BOISSIER : Après avoir chamboulé les esprits, la Révolution française a récrit l’histoire dont elle ne voulait plus. C’est ainsi que Molière est devenu « l’écrivain du peuple ». Il en fallait un, et personne d’autre ne convenait.
GD : Pourquoi pas La Fontaine ? Ses Fables étaient connues de tous.
DENIS BOISSIER : La Fontaine avait été un écrivain, pas une vedette. En 1792 personne ne se souvenait de l’homme qu’il avait été, alors que les faits et gestes de « l’illustre Molière », personnage le plus médiatique de son temps, étaient dans la mémoire collective. Mais surtout, La Fontaine n’avait pas écrit des pièces pouvant être arrangées et récupérées par la propagande révolutionnaire.
GD : Parce qu’on a arrangé les pièces de Molière, enfin, celles « signées » par Molière ?
DENIS BOISSIER : Oui, on les a adaptées au goût du temps. On les a même récrites. Dans ses pièces sérieuses les allusions au roi ont été effacées, on a remplacé le mot "roi" par "peuple" et on a, par exemple, incorporé le chant révolutionnaire Ça ira dans Le Médecin malgré lui transformé en opéra-comique.
GD : Quand ça ?
DENIS BOISSIER : En 1791. Molière fut l’auteur non officiel le plus joué pendant la Révolution française. C’est d’ailleurs à ce moment-là que la Comédie-Française a été appelée la « maison de Molière ».
GD : Une maison où il n’a jamais mis les pieds puisqu’il est mort avant la création de la Comédie-Française en 1680.
DENIS BOISSIER : Exactement.
GD : Donc on "arrange" Molière pour qu’il devienne, pour reprendre l’expression célèbre, l’ «écrivain du peuple ».
DENIS BOISSIER : Et aussi le pré-républicain idéal. Grâce aux Précieuses ridicules et plus encore au Tartuffe, pièces qui favorisent les contresens, Molière devient en 1792 l’incarnation du bon peuple français comme, avant lui, Triboulet ou Angoulevent, deux célèbres bouffons du roi qui étaient devenus des mythes. Ensuite, par la vertu de la Révolution française, Molière a été promu héros des citoyens. Et finalement, à force de contresens, il est devenu le pré-républicain que nous idolâtrons, c’est-à-dire un grand auteur rempli de la plus saine des morales. Oui, Gérard Durand, nous parlons bien de l’homme appelé le « Héros des farceurs » par son contemporain Valentin Conrart.
GD : …Lequel était un des membres fondateurs de l’Académie française. Il n’y a donc, selon vous, aucune raison historique qui puisse légitimer cette apothéose de Molière.
DENIS BOISSIER : Rien, historiquement, ne justifie que Molière ait été porté au rang d’institution nationale. Les "raisons" en furent politiques. Après avoir vaincu l’Eglise, la toute récente Ecole républicaine s’empressa de faire de Molière le porte-parole de ses aspirations. Pourtant, jamais Molière n’a combattu l’Eglise, ni encore moins anticipé les idéaux républicains. D’ailleurs, pour Tartuffe, Molière s’est vanté d’avoir l’approbation du légat de Rome, le cardinal Chigi, que Louis XIV accueillait à Fontainebleau. Cela lui fut d’autant plus facile que le cardinal Chigi, quelques jours auparavant, avait été enchanté par une représentation de la tragédie Othon de Pierre Corneille.
GD : Je ne comprends plus : Molière est-il un libertin ou pas ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr qu’il est libertin (tous ses proches le sont), et il a des penchants sexuels jugés alors "condamnables". Mais il est aussi le fils d’un bourgeois, et en tant que bourgeois ayant fait fortune il ne peut que vouloir être en bons termes envers l’Eglise. Et ceci vaut pour Corneille. Corneille est un poète païen qui n’a jamais renié les plaisirs de la chair et les joies du monde et, dans le même temps, un homme pénétré des choses du sacré. Pour en revenir à Molière, il est comme beaucoup de gens : ni dévot ni foncièrement impie.
GD : Sans doute est-il d’abord pragmatique…
DENIS BOISSIER : Exactement. Ce n’est pas son âme qu’il veut sauver, c’est sa troupe. Il est surtout comédien, son âme est sur scène. Et puis, circonstance aggravante, il est aux ordres du roi. Ses opinions, tout le monde s’en fiche et en premier lieu Louis XIV, qui ne l’a jamais considéré que comme maître-d’œuvre de ses amusements, ce que les moliéristes admettent à contre-cœur. En tant que bouffon du roi, Molière s’est contenté, comme « l’illustre Triboulet », de tirer à boulets rouges sur l’étroitesse d’esprit de certains prêtres et sur la vanité de petits bourgeois tirés à des milliers d’exemplaires sur le modèle de Monsieur Jourdain, voilà tout. Il n’y a pas de quoi faire de Molière un diable ni un saint.
GD : Fustiger l’étroitesse d’esprit, ce n’est déjà pas si mal.
DENIS BOISSIER : Certainement, mais le mérite en revient d’abord à Pierre Corneille. Molière, lui, voulait faire rire, un point c’est tout. Pour parvenir à ses fins, et d’abord remplir ses caisses, il a ridiculisé les revendications des premières "féministes" , ce qui n’est pas à son honneur. Il a aussi caricaturé ceux qu’on appelait alors les pédants et que nous appelons aujourd’hui des érudits. Molière s’est moqué des savants et des "férus" parce que le roi les dédaignait et que les nobles, qui étaient souvent incultes, les méprisaient. Dans son « emploi », comme il dit, Molière a jugé utile de rire avec les imbéciles. C’est à des détails comme celui-ci que l’on comprend à quel point Molière n’a jamais été un intellectuel, encore moins un lettré et surtout pas un érudit car l’on n’attaque pas ce que l’on est soi-même. De la même façon, il rabaissa les médecins, lesquels n’étaient pas tous des charlatans, loin de là.
GD : Oui, mais comme vous le disiez, Molière n’a fait que son métier d’amuseur du roi.
DENIS BOISSIER : En effet, il a tourné en dérision et dénigré uniquement ce qui déplaisait à son maître, autrement dit tout ce qui est noble, au sens large de cette épithète.
GD : A sa décharge, Molière a aussi égratigné les marquis dans sa comédie des Fâcheux et dans une autre comédie il s’est moqué de ceux qui croient dur comme fer à l’astrologie. Ces gens méritaient d’être mis en scène, non ?
DENIS BOISSIER : Il attaqua les devins dans Les Amants magnifiques parce que Louis XIV ne croyait pas à l’astrologie et que trop de charlatans envahissaient ses salons. De la même façon, quand le roi le lui demanda, Molière dénonça dans George Dandin tous ceux qui voulaient s’anoblir par le mariage.
GD : Qu’avait-il contre les mariages ?
DENIS BOISSIER : Louis XIV et Colbert avaient besoin de remplir les caisses du royaume. Or, ceux qui épousaient des aristocrates ne payaient plus l’impôt.
GD : Etes-vous en train de dire que Molière était aux ordres ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Molière a toujours été aux ordres. Dans Les Femmes savantes, il s’en prend aux érudits qui n’étaient pas pensionnés, autrement dit les penseurs qui n’étaient pas à la solde du pouvoir. Dans Le Bourgeois gentilhomme, pour les seuls besoins de la vanité du roi, il ridiculise les Turcs et leur religion.
GD : A ce compte, Molière n’aurait jamais été moral ?
DENIS BOISSIER : Ni moral ni immoral, seulement amoral. C’était le privilège inhérent à son statut, et ce qui faisait de lui un être hors norme. Le bouffon du roi a toujours été un personnage à part. C’est d’ailleurs pour cela qu’aucun écrivain n’a dédié à Molière une œuvre de son vivant.
GD : Personne, vous en êtes sûr ?
DENIS BOISSIER : Personne. Vous imaginez bien qu’un écrivain n’allait pas se recommander d’un personnage pour lequel l’élite et l’Eglise avaient du mépris et même de la haine. Car on a cherché plusieurs fois à le punir physiquement, à tel point que certaines anecdotes sur Molière semblent décalquées de celles sur Triboulet, lequel vivait pourtant au Moyen Age. Mais Louis XIV comme Louis XII protégeaient leurs favoris de la colère des grands princes.
GD : Je reviens au fait que personne n’a dédié une œuvre à Molière de son vivant… Boileau, qui était proche de Molière, ne lui a-t-il pas dédié une satire ?
DENIS BOISSIER : Boileau n’a pas dédié sa Deuxième satire à Molière, il la lui a seulement adressée. La nuance est d’importance. De plus, comme son titre l’indique, ce texte est une satire. Et comme le rappelle le dictionnaire de Furetière, une satire n’est pas un hommage mais une « médisance ». Dans cette satire médisante donc, Boileau ironise sur l’étonnante facilité qu’a Molière d’écrire sans effort ni travail préparatoire.
GD : C’est le vers si célèbre : « Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime »…
DENIS BOISSIER : Un vers dont il faut citer la suite qu’oublient les moliéristes : « On dirait, quand tu veux, qu’elle te vient chercher. » Boileau était un satiriste professionnel et, à l’époque, il n’était pas encore l’ami de Molière, ce qui explique le ton persifleur.
GD : Pour les moliéristes, Boileau vante ici le génie de Molière.
DENIS BOISSIER : Voilà pourquoi ils se définissent comme les « dévots de Molière ». Ils négligent le contexte historique au seul profit de leur dieu. Le « génie de Molière »… Quel génie ? En 1663, date de cette satire, Molière n’a représenté aucune des pièces qui franchiront les siècles. Même pour le moliérâtre Louis-Auguste Ménard cet enthousiasme est « inexplicable » [« Quand Molière n’avait encore rien publié de prodigieux, comme versification surtout, le difficile Boileau le félicite, avec un enthousiasme inexplicable jusqu’ici, de son inspiration universelle, phénoménale. » Le Livre abominable de 1665 qui courait en manuscrit parmi le monde sous le nom de Molière, 1883, T. I, p. XXXII.]
GD : Et les autres moliéristes, qu’en disent-ils ?
DENIS BOISSIER : Antoine Adam lui non plus ne comprend pas cet éloge que rien ne justifie. Pour Roger Duchêne le compliment « surprend », c’est le verbe qu’il utilise [« Le compliment surprend. Molière vient justement de donner devant la Cour une Princesse d’Elide qu’il n’a pas réussi à écrire en vers jusqu’au bout. La même sorte d’aventure lui arrivera encore à l’avenir. », Molière, 1998, p. 401].
GD : Boileau félicite donc Molière pour un don qu’il ne possède pas encore ?
DENIS BOISSIER : Et qu’il n’est pas près de posséder. Il a plus de quarante ans…or « la valeur n’attend point le nombre des années » a dit quelqu’un qui s’y connaissait. Et on veut nous faire croire que Molière, qui à quarante ans passés n’a encore rien " écrit " de valable, en 1659, alors qu’il n’a pas un instant à lui à force de courir prendre ses ordres chez le roi et de faire le soir la fête avec les comédiens italiens, rencontrerait soudain la Muse la plus réfléchie de France !
GD : On dit aussi qu’il se disputait beaucoup avec sa jeune femme.
DENIS BOISSIER : Ajoutez qu’il avait en tant que régisseur du Palais-Royal une cinquante d’employés à gérer.
GD : A ce rythme il devait avoir à peine le temps de respirer.
DENIS BOISSIER : En fait, toute l’ironie de cette Deuxième satire est là : Boileau sait que l’homme du peuple le plus surbooké de son temps a pour plume Pierre Corneille, et que de grandes choses sont en préparation…
GD : On louait donc Molière à cause de son « emploi » de bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : On ne faisait pas que le louer, on l’insultait aussi beaucoup. Ceux qui voulaient profiter de la jeunesse effrénée du roi le louaient, ceux qui espéraient amener Sa Majesté à des sentiments plus chrétiens l’insultaient. Mais, dans tous les cas, on craignait le bouffon du roi. La célèbre Madame Dacier ne fera pas jouer une pièce qu’elle venait d’écrire de peur, dit-on, que Molière ne la ridiculise dans Les Femmes savantes.
GD : Les écrivains se méfiaient donc de Molière ?
DENIS BOISSIER : Les écrivains plus que les spectateurs, parce qu’ils étaient encore moins dupes. Et les comédiens plus encore que les écrivains, parce qu’à cause de Molière le théâtre était devenu un objet de scandale.
GD : Cela en fait du monde contre lui !
DENIS BOISSIER : Les comédiens ne l’ont jamais soutenu. C’est un fait historique qui étonnait Georges Couton qui a constaté que les comédiens ont « renié » Molière, c’est le terme qu’il utilise [« Molière est renié par les gens du théâtre qui eussent dû être ses alliés naturels », Molière, Œuvres complètes, 1971, T. I, p. XXXI].
GD : Pauvre Molière…on dirait le vilain canard de la fable.
DENIS BOISSIER : Eh oui, à cause de sa fonction de bouffon du roi, non seulement Molière a eu contre lui ceux dont il s’était moqué – les intellectuels, les savants, les gens pieux, les hommes d’Eglise, une bonne moitié de la Cour – ce qui est normal, mais également ceux qui auraient dû être proches de lui : les comédiens.
GD : Selon vous, ils l’ont « renié » non pas en tant que comédien, mais en tant que bouffon du roi, comme les soldats grecs reniaient parfois leur Champion parce que celui-ci avait tendance à en faire trop.
DENIS BOISSIER : C’est exactement cela : le bouffon du roi est aux comédiens ce que le Champion est aux soldats. C’est un être sur lequel s’exerce trop de pression et qui risque à tout instant d’exagérer et de faire venir le malheur sur la tête de ceux dont il est censé être le fer de lance.
GD : Tout de même, Molière eut bien quelques soutiens… Ce poète qui vivait chez lui, à Auteuil…Chapelle…
DENIS BOISSIER : Chapelle, un soutien ? Non, il était trop souvent ivre pour jouer ce rôle auprès de Molière. Mais, en effet, les seuls poètes qui lui sont restés proches furent des poètes marginaux, alcooliques et homosexuels comme Claude Chapelle ou Charles Dassoucy.
GD : Boileau n’était pas homosexuel…
DENIS BOISSIER : Mais il avait, lui aussi, une réputation de « pilier de taverne ». Chapelain traitait le jeune Boileau tout à la fois de parasite, de farceur et de blasphémateur ! [« Vous faites ouverte profession de parasite, de farceur, d’impie, de blasphémateur dans les lieux où l’on s’enivre et dans les maisons de débauches. Je ne dis rien en ceci que votre genre de vie ne confirme et que vos écrits ne fassent aisément juger… » Discours au Cynique Despréaux, environ 1663].
GD : On parle bien du Boileau qu’on étudie à l’école, de cet homme pondéré, sérieux comme un pape et qui décerne des bons points à ses confrères ?…
DENIS BOISSIER : Lui-même. Mais ce Boileau statufié est l’équivalent du Molière sculpté dès 1680 par la propagande dévote du bon roi très-chrétien Louis XIV. Ce sont des portraits officiels complètement arrangés. Le Boileau de l’époque de Molière est un libertin qui aime se saouler et fréquente la célèbre courtisane Ninon de Lenclos. Le portrait que fait Chapelain du jeune Boileau permet de mieux comprendre pourquoi Molière a pris Boileau sous sa coupe, c’est le cas de le dire, d’autant que le jeune satiriste était un iconoclaste encore inconnu des grands écrivains de son temps. Vous savez la réputation que Boileau avait à trente ans ? Celle de se fâcher avec tout le monde.
GD : Je ne crois pas qu’il se soit jamais fâché avec Molière.
DENIS BOISSIER : Il ne risquait pas. Il avait trop besoin de Molière comme protecteur. N’oubliez pas que c’est grâce à Molière qu’il a réussi à approcher le roi. Et dès que celui-ci sera son nouveau protecteur, Boileau reniera Molière. Comme je vous l’ai dit, plusieurs biographes doutent que Boileau ait été l’ami du Comédien. En tout cas, plusieurs de ses vers, avant ou après son reniement, sont très critiques envers Molière. Et pourtant Boileau, à cause du roi qui avait élu Molière, faisait très attention aux mots qu’il employait.
GD : Oui, en s’en prenant à Molière, il avançait sur un terrain dangereux…Certains vers pouvaient déplaire au roi.
DENIS BOISSIER : Pour en terminer avec la prétendue amitié Boileau-Molière, ajoutons ce fait que je crois très significatif : Molière est absent de la très longue correspondance que Boileau a échangée avec ses amis écrivains, alors que Racine et des dizaines d’autres y sont...
GD : Le prince de Condé, dit-on, appréciait Molière.
DENIS BOISSIER : Personne n’en sait rien, mais il est vrai que le prince de Condé passait pour un grand mécréant, et il était, comme par hasard, le protecteur de Pierre Corneille.
GD : Molière n’a donc pour appui social ou politique que le seul Louis XIV.
DENIS BOISSIER : Ce qui est logique. N’oubliez pas qu’en ce temps-là, encore très respectueux des traditions, le bouffon du roi est le reflet inversé du roi. Son double en mode grotesque. C’est avec Molière que Louis XIV danse ou mange, comme le rappelle l’anecdote de l’en-cas de nuit, pas avec les grands noms de sa Cour. Le roi, si respectueux de l’étiquette tutoie Molière, ce qui est le signe distinctif du bouffon du roi. Entouré de tous et pourtant seul, Molière ne pouvait compter que sur l’appui de son maître, lequel ne le lâcha jamais, sauf lorsqu’il décida vers 1670 sous les conseils de Mme de Maintenon, de son confesseur, mais plus encore sous l’influence de Colbert, de devenir le « Roi très-chrétien » que la France espérait depuis longtemps.
GD : Pensez-vous que l’on ait pu redouter Molière parce qu’il était, grâce à sa fonction d’amuseur, écouté par Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : Vous ne l’auriez pas craint, vous ? Pour son premier biographe Grimarest cela ne fait aucun doute. Il écrit : « Connaître Molière était un mérite que l’on cherchait à se donner avec empressement » [La Vie de M. de Moliere, 1705].
GD : Les petits marquis devaient espérer de Molière qu’il leur facilite une entrevue avec Louis XIV.
DENIS BOISSIER : Tout à fait. D’ailleurs l’intellectuel Charles Jaulnay dit qu’il a vu des marquis :
Qui pliaient le genou en terre
Devant ce marmouset hideux.
Un marmouset, si vous l’avez oublié, est un être mal bâti, quelque peu difforme.
GD : Vous croyez qu’il y a là une allusion à l’aspect physique de Molière ?
DENIS BOISSIER : Physique et moral. Nous savons, par le seul portrait authentique que l’on ait de lui, celui de Claude Lefèbvre, dessiné vers 1652, et grâce à la description qu’a publiée une comédienne qui avait été dans sa troupe, que Molière était « laid ». C’est le mot qu’a utilisé le grand moliériste Gustave Larroumet et, plus récemment, Antoine Adam [« Je regrette de détruire une illusion chez ceux qui ne voient la beauté intellectuelle que complétée par la beauté physique, mais, comparaison faite de ces divers documents, je suis obligé de dire que Molière était laid. », Gustave Larroumet, La Comédie de Molière, l’auteur et le milieu, 1903, p. 308 ; « Molière n’était pas beau […] il faut même parler de laideur. […] Les gravures de Brissart en 1682 prouvent qu’il était bas sur jambes, et que le cou très court, la tête trop forte et enfoncée dans les épaules lui donnaient une silhouette sans prestige. Les plaisanteries de Le Boulanger de Chalussay n’ont de sens que si Molière pouvait presque passer pour un bossu. », Antoine Adam, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1997, T. II, p. 630].
GD : Laid ? Faudra-t-il donc que je perde une à une toutes mes illusions ?
DENIS BOISSIER : Vous vous sentirez plus léger ensuite. Oui, Molière était laid. S’il avait été Apollon pensez-vous que sa jeune femme se serait empressée de le cocufier ? D’ailleurs, comme le remarquait le moliériste Gustave Larroumet, si Molière avait été beau, il n’aurait pas triomphé comme pitre et grimacier [« Mieux fait et avec des traits plus fins, aurait-il pu réussir complètement dans la comédie et dans la farce ? », La Comédie de Molière, l’auteur et le milieu, 1903, p. 308].
GD : Les bouffons de Cour étaient souvent laids, et même difformes.
DENIS BOISSIER : C’est indéniable. Molière est le « singe de la vie humaine » ou, comme l’appelle le sieur de Rochemont : le « diable incarné ». Montfleury fils, qui connaissait bien Molière, dit la vérité lorsqu’il écrit que Molière est le « bouffon du temps ». On flattait Molière devant le roi, mais on ne se commettait pas avec lui. En 1670 Le Boulanger de Chalussay le définit comme « le premier fou du Roy » et constate qu’on montre du doigt Molière lorsqu’on l’aperçoit dans la rue [Elomire hypocondre, 1670, I, 3 ; Elomire est l’anagramme de Molière].
GD : Heureusement qu’il avait Louis XIV pour le protéger de tout et de tous.
DENIS BOISSIER : Le roi était sa seule protection et sa seule référence. D’ailleurs, Molière travaillait sous ses ordres, c’est tout dire. Bouffon du roi était son « emploi », nous avons vu que c’est le terme qu’il utilise lui-même et qui montre combien cette fonction est officielle. Toutefois dans La Princesse d’Elide, comédie dans laquelle il joue un bouffon de cour, Molière se plaint :
L’office de bouffon a des prérogatives ;
Mais souvent on rabat nos libres tentatives.
GD : Beaucoup de gens auraient préféré moins d’initiative personnelle et qu’il soit seulement aux ordres.
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Le bouffon du roi est toujours un personnage dangereux parce qu’il est libre de tout dire. Aussi Molière fut-il souvent aux ordres du ministre Colbert. Pourquoi Sganarelle-Molière vante les effets du tabac dans Dom Juan ? Parce que Colbert avait décidé que chaque soldat du roi serait désormais gratifié d’une bonne mesure de tabac.
GD : Du tabac pour que les soldats aient plus de cœur à l’ouvrage ?
DENIS BOISSIER : C’est probablement ce qu’espéraient Colbert et Louis XIV. Par ailleurs, son métier de directeur de troupe le fit aussi être aux ordres de Madeleine Béjart et de Pierre Corneille, bien que celui-ci soit socialement son obligé.
GD : Molière fut donc toujours aux ordres de quelqu’un. On est loin du libre penseur dont parlent les manuels scolaires.
DENIS BOISSIER : Aux antipodes. Et comme tous ces ordres étaient parfois contradictoires, on ne constate chez Molière, et encore moins dans son théâtre, aucune ligne de conduite directrice. Sur ce point, les moliéristes sont d’accord.
GD : Molière n’aurait agi qu’en fonction de la politique de Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : Bien obligé. Et comme la politique change au gré des circonstances, aujourd’hui encore les moliéristes ne peuvent décider si son théâtre est moral ou pas, progressiste ou passéiste, s’il flatte la Cour ou la bourgeoisie montante.
GD : Autrement dit, c’est selon l’opportunité que Molière est allé vers la Cour ou vers le peuple ?
DENIS BOISSIER : Oui, selon les circonstances et les caprices du roi. Et selon aussi les volontés de l’homme de l’ombre… Car Pierre Corneille s’intéressait à l’actualité. Même en tant qu’auteur de tragédies, il a toujours été ce que l’on appelait un « actualiste ».
GD : J’ai peine à imaginer Corneille écrivant ses tragédies en fonction de l’actualité.
DENIS BOISSIER : C’est pourtant un trait de son caractère. Les spécialistes sont formels : pour écrire ses œuvres, Pierre Corneille utilisait les événements récents. Mais permettez-moi d’ajouter, car cela ils ne se disent pas, qu’au moins une fois Corneille fut en désaccord avec Louis XIV.
GD : A quelle occasion ?
DENIS BOISSIER : Lors du procès contre Fouquet.
GD : C’était en quelle année, 1660 ?
DENIS BOISSIER : A partir de 1662. Fouquet avait été celui qui lui avait permis de relancer sa carrière, et le seul, si j’excepte Molière, à lui offrir de l’argent, beaucoup d’argent. Aussi, quand le roi fait emprisonner à vie Fouquet, Corneille est plus que tout autre en mesure de sentir l’injustice d’une telle condamnation.
GD : On le comprend…
DENIS BOISSIER : C’est pour cela, selon moi, que Le Misanthrope, qui raconte en filigrane un procès et l’injustice dont sont victimes certaines personnes d’honneur, est une allusion au malheur qui frappait le grand mécène des arts. Une allusion que le peuple a saisie et qui a peut-être nui au succès de la pièce.
GD : Parce que les Parisiens commençaient à oublier Fouquet ?
DENIS BOISSIER : Ils obéissaient au ministre Colbert qui avait tout fait pour prendre la place de Fouquet. Et Colbert ne plaisantait pas avec ceux qui lui résistaient. Qui est le « traître dont on sait la scandaleuse histoire » dont parle Alceste ? Qui est le «traître » qui est « sorti triomphant d’une fausseté noire » ? Tout le monde savait la part obscure et machiavélique qu’avait prise Colbert dans le procès de Fouquet.
GD : Il est vrai que Colbert a toujours été la bête noire de Corneille…
DENIS BOISSIER : Il y a contre ce « traître » qui « renverse le bon droit et tourne la justice » des vers très durs, sculptés dans le bronze cornélien…
[ Sur la foi de mon droit mon âme se repose :
Cependant je me vois trompé par le succès,
J’ai pour moi la justice, et je perds mon procès !
Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire,
Est sorti triomphant d’une fausseté noire !
Toute la bonne foi cède à sa trahison !
Il trouve en m’égorgeant, moyen d’avoir raison !
Le poids de sa grimace, où brille l’artifice,
Renverse le bon droit et tourne la justice !
Il fait par un arrêt couronner son forfait ! v. 1490-1499]
GD : La pièce Le Misanthrope aurait donc été une arme politique ?
DENIS BOISSIER : Je le pense, et c’est pour cela que Le Misanthrope n’a pas été présenté à la Cour, comme toutes les autres pièces de prestige, mais directement aux Parisiens. Et, pour n’être pas trop inquiétés, on a profité que la Cour était en deuil d’Anne d’Autriche pour représenter la pièce uniquement au Palais-Royal.
GD : Vous y voyez une stratégie ?
DENIS BOISSIER : C’est d’abord la stratégie de Corneille. Molière n’avait aucun intérêt à faire jouer Le Misanthrope. D’ailleurs le roi ne demandera pas à voir cette pièce du vivant de Molière, ce qui est sans doute révélateur d’une tension qui ne fera qu’empirer.
GD : Alceste a peut-être servi dans une scène de porte-parole à Fouquet, mais il n’est pas que Fouquet. Beaucoup de moliéristes pensent qu’Alceste c’est Molière, mais d’autres trouvent cette équation ridicule.
DENIS BOISSIER : Tout à fait ridicule. Lorsqu’il ne parle pas politique, le personnage d’Alceste, ce n’est pas Molière, c’est Pierre Corneille. C’est Corneille qui est en rupture de société, non Molière qui profite au maximum de cette société. Alceste est tellement Corneille que le comédien Coquelin, qui était moliériste, a affirmé qu’« Alceste a sur l’honneur des idées cornéliennes » [Molière et le Misanthrope, 1881, p. 66].
GD : Si Corneille est Alceste, qui est Célimène ? Marquise du Parc pour laquelle Corneille eut un béguin ?
DENIS BOISSIER : Célimène est sans doute un reflet de Marquise du Parc ou, plus probablement, une synthèse de toutes celles qui ont repoussé Pierre Corneille. Corneille a toujours aimé les jeunes femmes et, vous le savez, ce n’était pas un bel homme ni un beau parleur. Quant à Arsinoé, Georges Couton a dit qu’elle a « la même humeur que celle de Corneille. » [Molière, Œuvres complètes, 1971, T. 1, p. 1332].
GD : Décidément, Corneille est partout !
DENIS BOISSIER : Corneille seul avait la rancœur nécessaire et les dispositions pour composer le caractère complexe d’Alceste. C’est Corneille qui n’a jamais fait partie d’un cénacle ni d’aucun salon. C’est Corneille qui, dégoûté du monde, a fait trois retraites totalisant une douzaine d’années de silence. Même pour Alfred Simon, Alceste est à « l’opposé de Molière » [« Alceste représenterait même plutôt l’opposé de Molière qui n’a jamais prétendu, ni comme comédien ni comme courtisan, rompre en visière tout le genre humain », Molière, une vie, 1988, p. 355].
GD : S’il en est ainsi, que vient faire Le Misanthrope dans la carrière de Molière ?
DENIS BOISSIER : Rien n’explique la nécessité du Misanthrope dans la biographie officielle de Molière. Sauf que cette biographie officielle ne tient pas compte de Pierre Corneille. C’est lui qui a écrit Le Misanthrope. Et c’est lui seul qui a voulu participer, à sa manière, au mouvement de soutien envers Fouquet que dirigeait son amie Mme de Sévigné. Les intellectuels et la plupart des nobles savaient Fouquet innocent de tous les crimes qu’on lui reprochait.
GD : Ce même Fouquet qui a commandé à Molière sa première pièce de Cour, Les Fâcheux.
DENIS BOISSIER : Oui, Fouquet était le protecteur de Corneille. Voilà une nouvelle connexion entre Corneille et Molière à laquelle les moliéristes ne veulent pas penser…Car qui a pu recommander Molière à Fouquet ? Question spectacle, Corneille était le mieux placé, non ? Donneau de Visé, futur collaborateur de Molière, nous dit que « plusieurs de ses amis ont fait des scènes aux Fâcheux. » [La Vengeance des marquis, 1663]. En fait, l’essentiel de cette satire, nous la devons à Pierre Corneille. Dès que l’on étudie son style, la part prépondérante de Corneille saute aux yeux. Il y a même un private joke…
GD : Dites vite…
DENIS BOISSIER : Qui sont les fâcheux ? Alcandre. C’est le nom d’un magicien de Corneille dans L’Illusion comique, Alcippe est dans Le Menteur, Dorante aussi. Quant à Lysandre c’est un personnage de La Galerie du Palais, et Orphise vient de La Comédie des Tuileries. Bien sûr, on prétendra que c’est le hasard, que ce sont des noms de comédie… Alors, dans ce cas, pourquoi une telle rencontre ne se retrouve nulle part ailleurs ?
GD : Corneille aurait donc voulu signer discrètement cette œuvre ?
DENIS BOISSIER : Oui, c’est là, je pense, un exemple de ce qu’André Le Gall appelle « l’humour enfoui » de Corneille. Car lorsque le nom de Corneille est cité dans Les Fâcheux – rappelons que Corneille adore se faire de la publicité par pièces interposées – c’est dans un vers où le verbe est placé au 7e pied, particularité stylistique qui lui est propre.
GD : Une sorte de clin d’œil ?
DENIS BOISSIER : Exactement :
Je sais par quelles lois un ouvrage est parfait,
Et Corneille me vient lire tout ce qu’il fait.
Bien sûr, ce n’est amusant que si l’on sait que c’est Molière qui apporte à Corneille tous ses projets de spectacle…
GD : Naturellement...
DENIS BOISSIER : De plus, cette pièce a été écrite en quelques jours. Or Corneille est l’auteur le plus rapide de son temps. Il a composé les mille huit cents vers de Polyeucte en vingt jours, la tragédie Œdipe en moins de deux mois, et Psyché en quinze jours. Molière, lui, nous apprend son premier biographie Grimarest, est « l’homme du monde qui travaillait avec le plus de difficulté » et de réaffirmer plus loin : « il ne travaillait pas vite, mais il n’était pas fâché qu’on le crût expéditif. » [Vie de M. de Moliere, 1705].
GD : C’est en effet quelque peu déroutant…
DENIS BOISSIER : Voulez-vous une autre connexion significative ? Pendant que Molière doit, en moins de quinze jours, écrire, mettre en scène, préparer la création des Fâcheux et apprendre son texte, quelle grande pièce présente-t-il dans le même temps ?
GD : J’ai dans l’idée que c’est une tragédie de Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Gagné ! Molière joue Sertorius, et il enchaînera avec plusieurs autres tragédies de Corneille, ce même Corneille dont les moliéristes veulent nous faire croire qu’il est fâché avec Molière.
GD : Pourquoi seraient-ils fâchés ?
DENIS BOISSIER : Personne ne le sait, pas même les moliéristes, mais cela les arrange de les croire ennemis.
GD : Ils se basent tout de même sur quelque chose pour affirmer cela !
DENIS BOISSIER : Sur une petite phrase d’une lettre de Thomas Corneille à son ami l’abbé de Pure. Thomas constate que Molière et sa troupe ne sont bons qu’à jouer des « bagatelles » et non les tragédies. Pour les moliéristes, le terme « bagatelles » est la pire des injures, alors que c’est simplement un mot à la mode, qui n’a rien d’injurieux. De plus, Thomas Corneille utilise la formule « tout le monde dit », il ne fait donc que répéter un fait banal connu de tous, il n’y a là rien de personnel.
GD : Et c’est tout ?
DENIS BOISSIER : Oui. Et comble du parti pris des moliéristes, Molière lui-même employait le mot « bagatelles » pour désigner ses petites farces en un acte !
GD : Donc Corneille et Molière ne se sont jamais fâchés.
DENIS BOISSIER : Jamais. Mais puisque le dogme moliériste impose une « Querelle » entre Corneille et Molière, aucun dix-septiémiste aujourd’hui ne supposera que ces deux artistes pouvaient se côtoyer et avoir des projets communs.
GD : Ils en ont eu au moins un avec Psyché [1671] !
DENIS BOISSIER : Cette pièce est la preuve évidente de l’incroyable dogmatisme des « dévots de Molière ». Sans parler de toutes les pièces de Corneille que Molière joue ou crée pendant cette prétendue « Querelle »…
GD : J’ai lu que bien que Fouquet ait été le commanditaire des Fâcheux cette satire a resserré les liens entre Louis XIV et Molière.
DENIS BOISSIER : En effet, c’est après Les Fâcheux que le roi s’est définitivement attaché Molière, et accessoirement le vétéran Pierre Corneille.
GD : Revenons, si vous le voulez bien, au procès de Fouquet et au Misanthrope.
DENIS BOISSIER : En tant que bouffon du roi, Molière n’a jamais pris la défense de Fouquet, ce qui est bien la preuve que Molière n’a jamais été ce libre penseur auquel rêvent les moliéristes. Cela attristait Louis-Auguste Ménard qui trouvait que Molière s’était montré « ingrat » ! [« J’avais déjà remarqué que, de tous les obligés de Fouquet, Molière était le seul qui n’eût pas pris sa défense : or, étant donné le grand cœur qui parut en toutes ses actions et éclate dans tous ses ouvrages, je ne m’expliquai pas ce silence ingrat. », Le Livre abominable de 1665 qui courait en manuscrit parmi le monde sous le nom de Molière, 1883, T. I, p. XLVII].
GD : A cause du roi, Molière pouvait-il faire autrement que d’être « ingrat » ?
DENIS BOISSIER : Dans l’« emploi » qui était le sien, Molière ne pouvait même pas envisager de s’opposer à Louis XIV. Ce fut le courage de Corneille que de risquer de déplaire au roi. Et ce fut, à ma connaissance, la seule fois où Corneille courut ce risque. Mais il en allait de son honneur.
GD : Pourquoi cela ?
DENIS BOISSIER : Parce que Corneille n’est pas une girouette. Il a l’amitié tenace, ainsi que la rancune. Une dizaine d’années après que Fouquet a été emprisonné à vie dans la forteresse de Pignerol, Corneille était le seul à toujours défendre l’honneur de son dernier mécène.
GD : On en a la preuve ?
DENIS BOISSIER : Il suffit de lire son Ode à Pellisson. Pellisson était le secrétaire de Fouquet, et il avait été enfin libéré. Corneille profite du retour en grâce de Pellisson pour évoquer le sort inique de Fouquet. Corneille est alors le seul à continuer à prendre fait et cause pour un homme que chacun veut oublier. Voilà la sorte d’homme que fut Pierre Corneille : un homme d’honneur, un artiste du combat social pourvu d’un grand sens de l’amitié. Revers de la médaille, Corneille est un rancunier et un revanchard. C’est pour cela qu’il fut un bon collaborateur de Molière. Comme l’a écrit son biographe André Le Gall, « Avec Corneille, tout, toujours continue. ». Et c’est bien vrai. Avec cette Ode, Corneille rappelle au roi qu’il n’oublie pas, lui, ce qu’il doit à Fouquet.
GD : Les biographes de Corneille sont-ils d’accord avec cette interprétation ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. André Le Gall parle de la « vindicte » de Corneille [les vers de l’Ode à Pellisson « signifient à Louis XIV que, s’il est en son pouvoir de prononcer la réclusion du mécène, il ne l’est pas d’effacer l’action par laquelle lui, Pierre Corneille, a été rappelé à la vie en un temps où il pouvait sembler qu’il était devenu étranger à son siècle. Obligé de ménager le commis [Colbert] qui gouverne les arts et les lettres, prudent, mécontent de sa prudence, de sa complaisance, Corneille engrange sa vindicte, l’enfouit longuement, et brusquement, une décennie et demie plus tard, il la laissera jaillir à l’air libre dans son Ode à Pellisson. Avec Corneille, tout, toujours continue. », Corneille, en son temps et en son œuvre, 1997, p. 396]. Ce sens de l’amitié et le fait qu’ « avec Corneille, tout, toujours continue », explique la durée et la solidité de son association avec un directeur de troupe « premier farceur de France ».
GD : Il semble bien que plus on a une vue d’ensemble de la vie et de la carrière de Corneille mieux on comprend la raison de son association avec Molière.
DENIS BOISSIER : Exactement. De la même façon qu’au début de sa carrière Corneille fut le discret collaborateur de Richelieu pour plusieurs pièces, il deviendra, en fin de carrière, le discret collaborateur de Molière pour plusieurs grandes pièces. L’homme en vert après l’homme en rouge.
GD : Le rouge cardinal et le vert moliéresque…
DENIS BOISSIER : On ne l’a pas assez remarqué, mais il y a toujours du vert dans ses costumes de scène. Même les tentures de ses appartements étaient de couleur verte.
GD : Et vous allez me dire qu’il n’y a rien d’étonnant puisque le vert a toujours été la couleur des bouffons…
DENIS BOISSIER : C’était aussi l’opinion du moliériste Edouard Fournier qui a même écrit, je cite : « En adoptant le vert, Molière avait fait choix de la couleur des bouffons. »
GD : Textuellement ?
DENIS BOISSIER : Oui, dans son ouvrage le plus célèbre : Le Roman de Molière [1863, p. 127, n. 1.]. Aujourd’hui pas un dix-septiémiste n’oserait écrire cela.
GD : Revenons au Misanthrope…
DENIS BOISSIER : Surnommé « l’homme aux rubans verts »… Comme je vous l’ai dit, le roi n’a pas voulu assister à la création du Misanthrope. Peut-être doit-on dater de cette pièce le refroidissement progressif de Louis XIV envers son bouffon…
GD : Le Misanthrope est-elle la pièce où l’on perçoit le plus l’influence de Pierre Corneille ?
DENIS BOISSIER : Certainement. Il suffit d’analyser scène par scène Le Misanthrope, chaque alexandrin constitue le meilleur indice que l’auteur ne peut être que Pierre Corneille.
GD : Pourrait-on faire la même constatation avec Tartuffe ?
DENIS BOISSIER : Oui. A ceci près que le personnage de Tartuffe n’est pas une part du caractère de Corneille mais un archétype, un archétype comme Corneille a toujours aimé les travailler. Après le Champion [Le Cid], le Vantard [le Matamore dans L’Illusion comique], le Menteur [Dorante dans Le Menteur], c’est le tour l’Hypocrite [titre originel du Tartuffe] puis du Misanthrope... On retrouve cette même densité cornélienne dans Amphitryon et Les Femmes savantes, bien que dans cette dernière pièce, il y ait plus de lazzi parasites.
GD : Puisque l’on sait que Corneille était fidèle en amitié, il l’a prouvé envers Fouquet, croyez-vous que c’est par amitié que Corneille soit resté associé à Molière jusqu’à sa mort ?
DENIS BOISSIER : Pas uniquement à cause de l’amitié, bien qu’elle ait été, je le crois, essentielle. D’abord, en tant que collaborateur de Molière, il appartenait au Service du Roi. Travailler pour Louis XIV, Corneille en avait toujours rêvé, mais son seul génie n’avait pas suffi à lui obtenir cet « emploi ». Ensuite, être la plume du bouffon du roi lui offrait l’opportunité d’exprimer sans risque ce qu’il avait sur le cœur.
GD : Corneille avait tant de choses « sur le cœur » ?
DENIS BOISSIER : Durant toute sa carrière, qui dura un demi-siècle, il a été en butte à l’étroitesse d’esprit de ses contemporains. Pour chacune de ses pièces, surtout pour Le Cid, Polyeucte ou sa tragédie chrétienne Théodore, il a subi les sarcasmes des académiciens et des doctes, les préjugés des faux dévots et les petites considérations de Mesdames les Précieuses qui dans leur jargon l’appelaient Cléocrite. Parmi ses adversaires les plus injustes, il y avait aussi l’abbé d’Aubignac, dont nous avons déjà parlé. Corneille a utilisé La Critique de l’Ecole des Femmes pour répondre à l’abbé. Le personnage de Lysidas, c’est d’Aubignac.
GD : J’imagine que les moliéristes ne partagent pas cette opinion.
DENIS BOISSIER : Détrompez-vous. Beaucoup de moliéristes pensent sur ce point comme moi. Mais les premiers pontifes du moliérisme ayant décidé que Lysidas était Pierre ou Thomas Corneille, le préjugé demeure, surtout dans les manuels scolaires.
GD : Pourquoi pensent-ils que c’est Thomas ou Pierre ?
DENIS BOISSIER : Pour asseoir leur dogme d’une « Querelle » entre Corneille et Molière. Ce préjugé a l’avantage de séparer les deux artistes.
GD : Je ne comprends pas comment des universitaires peuvent accepter une chose si rien ne la prouve.
DENIS BOISSIER : C’est là le problème du moliérisme, qui est une prétendue science qui ne cherche que là où elle croit avoir déjà trouvé. Comme dans ce numéro de cirque où un clown demande à son compagnon : « Que cherches-tu sous ce projecteur ? » Et l’autre répond : « La pièce que j’ai perdue dans la rue, parce qu’ici, c’est éclairé. »
GD : Les moliéristes vous répondront qu’ils ont des documents prouvant que Corneille et Molière étaient fâchés.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, j’aimerais bien savoir lesquels. J’ai lu plus de sept cents ouvrages de moliéristes éminents. Tous ne s’appuient que sur trois textes : Primo : la petite phrase de Thomas avec le mot « bagatelles » (phrase dont nous venons de parler et qui ne signifie rien en elle-même). Secundo : quatre vers de L’Ecole des Femmes où il est fait allusion à un « Gros Pierre » qui a pris pour nom pompeux « de l’Isle » ; certains veulent croire qu’il s’agit de Pierre Corneille, d’autres disent que c’est Thomas, et certains admettent qu’il n’y a là aucune allusion aux Corneille ; l’éminent Paul Lacroix a d’ailleurs découvert qui était ce De Lisle auquel s’en prennent Molière et Madeleine Béjart – ce De Lisle refusait de leur rembourser l’argent qu’il leur devait...
GD : Tertio ?
DENIS BOISSIER : Tertio : une petite phrase de l’abbé d’Aubignac dans sa Troisième dissertation [1663] : « J’avais cru, comme beaucoup d’autres, que vous étiez le poète de La Critique de l’Ecole des Femmes ».
GD : D’Aubignac écrit « j’avais cru » ?
DENIS BOISSIER : Oui. Donc il n’en sait rien. D’ailleurs, une lecture sans parti pris de ce passage montre que d’Aubignac feint seulement d’accuser Corneille d’être Lysidas parce que cet homme perfide – tous les moliéristes le disent perfide – sait que Lysidas, c’est lui.
GD : Pourquoi le sait-il ?
DENIS BOISSIER : Il le sait parce que tout le monde le disait.
GD : … L’affirmation de Donneau de Visé selon laquelle Lysidas, c’est d’Aubignac…
DENIS BOISSIER : Oui, mais d’autres le disaient aussi. Voilà pourquoi d’Aubignac a détourné l’attention de ses lecteurs sur Pierre Corneille. D’accusé, il retourne une situation inconfortable en jouant le rôle d’accusateur.
GD : Même pas puisqu’il ne fait qu’insinuer… « j’avais cru »…
DENIS BOISSIER : Vous avez raison. Il ne fait qu’insinuer. En revanche, abandonnant l’idée que Corneille puisse être Lysidas, il écrit que Corneille est « sans doute Mascarille ».
GD : Le personnage principal des Précieuses ridicules.
DENIS BOISSIER : Or Mascarille est un imposteur, quelqu’un qui se fait passer pour quelqu’un d’autre…
GD : … Et il était joué par Molière.
DENIS BOISSIER : Et pour tout le monde alors, Mascarille était comme le second nom de Molière. Ce nom lui collait à la peau. Or, que nous dit d’Aubignac ? Que Corneille est « sans doute Mascarille » [« J’avais cru, comme beaucoup d’autres, que vous étiez le poète de la Critique de l’Ecole des Femmes, et que M. Lysidas était un nom déguisé, comme celui de M. de Corneille, mais tout le monde est trompé, car vous êtes sans doute le Marquis de Mascarille, qui parle toujours, piaille toujours, ricane toujours, et ne dit jamais rien qui vaille. », Troisième dissertation, 1663, p. 141].
GD : Etonnant !
DENIS BOISSIER : Mais cette équation-là, les moliéristes n’en parlent jamais. Ils préfèrent l’autre : Corneille = Lysidas.
GD : Et c’est juste sur ça que se fondent les moliéristes pour décréter que Molière et Corneille étaient ennemis ?
DENIS BOISSIER : C’est ridiculement peu, je sais, mais cela a suffi pour que la « Querelle » devienne, au fil des décennies, le pont-aux-ânes de ces Messieurs de la Sorbonne qui y passent tous en procession.
GD : Il y a toutefois une chose que je ne m’explique pas… Qu’est-ce que cela aurait prouvé des sentiments de Molière envers Corneille si celui-ci avait été le personnage de Lysidas ? Il ne m’a pas paru si épouvantable que cela, ce Lysidas !
DENIS BOISSIER : Lysidas, c’est le moine bourru des moliéristes. Mais il ne fait peur qu’à ces Messieurs car Lysidas, que l’on veut « pédant », est d’abord un homme de goût, certes un peu vieux jeu – car il n’aime que les tragédies – mais d’un caractère distingué et très lucide sur les mœurs de son temps. C’est d’autant plus injuste de nous faire croire que Lysidas est un abruti que le personnage de Lysidas, du temps de Molière, était loin de déplaire. Les trois-quarts de la France soutenaient le point de vue de Lysidas. D’ailleurs le jeune écrivain arriviste Edme Boursault se vantera d’être Lysidas…
GD : Si je comprends bien, tout le monde est un peu Lysidas.
DENIS BOISSIER : Vous avez tout compris. Lysidas est tout simplement quelqu’un qui aimerait bien que la tragédie soit la reine du théâtre et non la comédie dans ce qu’elle a de plus bas.
GD : L’argument des moliéristes comme quoi Corneille est le Lysidas de La Critique de l’Ecole des Femmes n’est donc pas prouvé.
DENIS BOISSIER : Il n’est ni prouvé ni probant. Pas plus que n’est établi que Corneille est le « Gros-Pierre » auquel fait allusion L’Ecole des Femmes. Il y a fort à parier que « Gros-Pierre » est un nom proverbial et relève du folklore, comme Gros-Jean ou Petit-Jean.
GD : Y a-t-il des moliéristes qui ne croient pas à cette « Querelle » entre Corneille et Molière ?
DENIS BOISSIER : Dans le passé de très grands moliéristes comme Jules Taschereau ou Louis Moland n’y ont pas cru. Mais depuis que Georges Mongrédien a réussi à imposer en 1971 la « Querelle », plus personne aujourd’hui ne songe à remettre en doute ce grand article du dogme moliériste.
GD : En conclusion, la « Querelle » entre Corneille et Molière ne reposerait que sur une interprétation abusive et tendancieuse de trois courts textes qui, replacés dans leur contexte, signifient, selon vous, le contraire de ce qu’ils prétendent.
DENIS BOISSIER : Exactement. Mais comme ils ont le monopole du discours critique sur Molière et Corneille, les moliéristes parlent de cette « Querelle » comme d’une chose allant de soi. C’est ce que j’appelle du terrorisme intellectuel. Mais il y a une vérité historique contre laquelle ils ne peuvent rien : c’est que les contemporains de Corneille et de Molière n’ont jamais parlé d’une « Querelle ».
GD : Ils n’auraient pourtant pas manqué d’y faire allusion si elle avait existé…
DENIS BOISSIER : Bien sûr. D’ailleurs lorsque le clan Corneille et le clan d’Aubignac se sont affrontés, de nombreux contemporains en ont parlé et nous sont parvenues des épigrammes assassines des deux camps adverses.
GD : Et nous n’avons rien sur la « Querelle » entre Corneille et Molière ?
DENIS BOISSIER : Rien. Et même des années plus tard ni l’historien Samuel Chappuzeau, ni Grimarest ni La Grange n’ont évoqué le moindre conflit entre les frères Corneille et Molière.
GD : Pierre Corneille n’a jamais écrit une ligne sur Molière ?
DENIS BOISSIER : Jamais. Et c’était pourtant un redoutable polémiste.
GD : Pour vous, il ne fait aucun doute que c’est Donneau de Visé qui dit la vérité : Lysidas est l’abbé d’Aubignac.
DENIS BOISSIER : Il l’a écrit noir sur blanc.
GD : Sans doute Donneau de Visé était mieux placé que la critique moderne pour le savoir.
DENIS BOISSIER : Il est certain que de Visé connaissait bien les coulisses du Palais-Royal. C’était un collaborateur de Molière. Certaines de ses pièces ont été publiées sous le nom de Molière, et comme ces deux hommes ne se sont jamais fait de procès, on peut en conclure que Molière lui servait aussi de prête-nom.
GD : Revenons à Pierre Corneille. Pour vous, Corneille utilise le théâtre de Molière pour régler ses comptes.
DENIS BOISSIER : Sinon où serait pour lui le plaisir ? Rassurez-vous, en tant que docte académique, d’Aubignac était tout naturellement l’ennemi aussi de Molière. Tous les lettrés ont d’ailleurs accusé Molière de pervertir le théâtre français si bien restauré par Richelieu.
GD : Les moliéristes sont-ils d’accord avec vous sur ce point ?
DENIS BOISSIER : Evidemment, mais ils sont conditionnés pour ne jamais évoquer cet aspect de la glorieuse et si méritante et si noble carrière de leur illustre et si viril et si magnanime grand homme. Parfois un moliériste ose le dire, mais en tant qu’historien, comme l’a fait Antoine Adam [« Toutes les polémiques du temps ont accusé Molière d’avoir compromis l’œuvre morale entreprise au théâtre depuis Richelieu. », Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1968, T. IV, p. 326, note 1]. La meilleure preuve que Molière n’était qu’un comédien dans le monde de la littérature est qu’aucun organe officiel n’a jamais fait cas de son théâtre. Cela étonnait beaucoup Eugène Despois, grand prêtre parmi les « dévots de Molière », qui avoue quelque part qu’il a constaté ce « fait curieux » – car pour lui c’est « un fait curieux » – que La Gazette, qui était l’organe officiel, n’ait jamais jugé utile de se préoccuper de Molière [« Nous avons pu constater un fait curieux, c’est que le seul journal du temps, la Gazette, nomme souvent des écrivains contemporains, surtout ceux qui ont quelque recommandation officielle ; elle mentionne leur succès à la Cour, à l’Académie ou ailleurs ; lorsqu’ils meurent, elle leur consacre une notice plus ou moins élogieuse ; quant à Molière, elle ne le nomme jamais de son vivant, elle ne lui accorde pas une ligne à sa mort. », Œuvres de Molière, 1927, T. II, p. II]. Et plus récemment, cela étonnait tout autant l’éminent Georges Mongrédien – le promoteur de la « Querelle » entre Corneille et Molière – que pas un seul intellectuel n’ait voulu étudier le théâtre moliéresque. Il a eu beau chercher partout, pas un seul éloge d’un seul intellectuel. C’est vraiment ne rien avoir compris à Molière que de se demander pourquoi il était mis à l’Index.
GD : Quelle explication a-t-il avancée pour expliquer cette… comment dire ?… anomalie ?
DENIS BOISSIER : Mongrédien, en bon moliériste, n’a pas apporté de réponse. Il s’est contenté de seulement poser la question [« Alors que la littérature du XVIIe est si abondante sur l’œuvre d’un Corneille et d’un Racine, pourquoi est-elle si pauvre sur celle de Molière ? [...] J’ai eu la curiosité de lire toutes les préfaces de ces auteurs dramatiques dont beaucoup, comme Molière lui-même, furent comédiens et parfois de sa troupe même : Baron, Boursault, Brécourt, Champmeslé, Thomas Corneille, Donneau de Visé, Hauteroche, Montfleury père et fils, La Tuilerie, Raymond Poisson, Quinault, Rosimond, Brueys et Palaprat, Regnard, Dufresny, Dancourt ; pas un ne cite le nom de Molière, ne fait allusion à son œuvre. », Recueil des textes et des documents du XVIIe siècle relatifs à Molière, 1965, pp. 14 et 17].
GD : Vous dites que, face aux attaques des doctes, Corneille et Molière faisaient cause commune. C’est donc d’un commun accord qu’ils ont répondu aux attaques de d’Aubignac dans La Critique de l’Ecole des Femmes ?
DENIS BOISSIER : Ils ont toujours tout fait d’un commun accord. Dans cette satire, Dorante représente le tandem Corneille-Molière. Il est deux tiers Molière, un tiers Corneille.
GD : Comme le héros babylonien Gilgamesh qui était deux tiers homme, un tiers dieu.
DENIS BOISSIER : Si vous voulez. Que nous dit Dorante, lequel porte le nom du Menteur de Corneille (doit-on y voir un clin d’œil et comprendre qu’il ne faut pas croire tout ce qu’il nous dit ?) ? Que la grande règle est de plaire [« Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n’est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n’a pas suivi un bon chemin. », La Critique de l’Ecole des Femmes, 1663, scène 6]. Or que disait Pierre Corneille vingt-cinq ans plus tôt ? La même chose : « Notre premier but doit être de plaire » [« Puisque nous faisons des poèmes pour être représentés, notre premier but doit être de plaire à la Cour et au peuple et d’attirer un grand nombre à leurs représentations », Epître dédicatoire de La Suivante 1637].
GD : Ils ont le même point de vue.
DENIS BOISSIER : Ils ont toujours le même point de vue. D’ailleurs le point de vue de Molière est toujours celui de Corneille. Il suffit de lire l’Avertissement des Fâcheux ou la préface du Tartuffe pour en être convaincu. Dès sa comédie La Veuve, qui date de 1631, Corneille a l’état d’esprit qui lui permettra de faire du Molière. Ce qu’il dit dans le "Au Lecteur" de La Veuve [« Je tâche de ne mettre en la bouche de mes acteurs que ce que diraient vraisemblablement en leur place ceux qu’ils représentent, et de les faire discourir en honnêtes gens, et non pas en auteurs. »], c’est exactement ce que dira Molière vingt ans plus tard à Marquise du Parc dans L’Impromptu de Versailles [« Tâchez donc de bien prendre tous les caractères de vos rôles, et de vous figurer que vous êtes ce que vous représentez. », 1663, scène 1].
GD : L’un semble l’écho de l’autre.
DENIS BOISSIER : Parce que Pierre Corneille est doué pour parler de lui par le biais de quelqu’un d’autre… Relisez l’Avertissement des Fâcheux et vous aurez un exemple de son ironie lorsqu’il profite du masque de Molière pour ridiculiser ceux qui, à l’exemple de d’Aubignac, se cachent derrière Aristote et ses règles, et ne savent même pas écrire une pièce qui plaît au public [« Ce n’est pas mon dessein d’examiner maintenant si tout cela pouvait être mieux, et si tous ceux qui s’y sont divertis ont ri selon les règles. Le temps viendra de faire imprimer mes remarques sur les pièces que j’aurai faites, et je ne désespère pas de faire voir un jour, en grand auteur, que je puis citer Aristote et Horace. »]. Pour parler vulgairement, Molière n’avait "rien à cirer" de d’Aubignac. En revanche, Corneille devait éprouver un subtil plaisir de traiter à la légère l’excessif intérêt que les doctes accordaient aux règles.
GD : Vous dites que Corneille et Molière sont « complémentaires », et pourtant ils sont si différents de caractère ! Et même dans leur théâtre, car vous admettrez qu’il y a loin de Cinna à L’Ecole des Femmes.
DENIS BOISSIER : Beaucoup moins qu’entre Le Misanthrope et Le Mariage forcé. Ce qui vous fait croire à une grande différence entre l’œuvre de Corneille et le théâtre moliéresque c’est que le théâtre moliéresque a bénéficié d’une écriture collégiale. De nombreux collaborateurs plus ou moins occasionnels y ont contribué, comme le montre l’anormale diversité du champ lexical ainsi que l’étonnante variété de styles. Alors, bien sûr, si nous prenons le pire des collaborateurs et que nous le comparons à Corneille la différence est flagrante. C’est pourquoi il ne faut comparer que ce qui est comparable : les pièces de Corneille avec les pièces dites sérieuses de Molière, comme Le Misanthrope ou Tartuffe.
GD : Cette écriture que vous appelez « collégiale » était-elle la norme au XVIIe siècle ?
DENIS BOISSIER : Pour les comédies et les farces, oui. C’est ainsi que se fabriquaient des spectacles qui, comme ceux de Molière, n’avaient aucune prétention littéraire. Mais seul le théâtre moliéresque a eu assez d’argent, de pouvoir, de réputation pour susciter un telle profusion de plumes. Le moliériste Claude Bourqui, qui est parfois plus lucide que ses confrères, a écrit qu’une comédie de Molière est un « assemblage d’unités disparates » [« Une comédie de Molière est construite en assemblage d’unités disparates plutôt qu’en bloc cohérent. », Molière à l’école italienne, 2003, p. 151]. Il a raison bien plus qu’il ne veut l’envisager. Souvent Molière et son équipe se sont contentés de « raccommoder », comme on disait alors, plusieurs scènes de pièces différentes. Parfois c’est à une œuvre plus ou moins cohérente que se sont attelés plusieurs tâcherons. Il n’y a jamais dans les petites pièces de Molière une homogénéité organique. Il n’y a pas un « sujet », comme disent les spécialistes, mais une multitude de digressions, de lazzi, de gags, qui parasitent le « sujet » bien vite réduit à la part congrue. Heureusement pour la postérité, Donneau de Visé, Adrien Subligny ou Edme Boursault ont sans doute écrit pour Molière, sans oublier Chapelle ou Boileau. Dans ce cas, telle comédie fait preuve d’une plus grande unité stylistique et sa structure organique est plus apparente. Mais là encore, d’autres plumes ont pu ajouter une scène ou quelques répliques.
GD : Comme on le fait aujourd’hui avec les scénarios de films. Jusqu’à cinq ou six écrivains peuvent se succéder à l’élaboration d’une histoire…
DENIS BOISSIER : Le cinéma américain a repris les pratiques du XVIIe siècle : l’écriture collégiale, le prête-nom et jusqu’à cette idée bourgeoise selon laquelle la propriété intellectuelle d’une œuvre appartient à celui qui la produit ou l’achète !
GD : Le Palais-Royal ou Hollywood, mêmes pratiques !
DENIS BOISSIER : Il n’y a pas lieu d’en rire ! Les auteurs européens luttent aujourd’hui contre l’impérialisme américain afin que soient reconnus le droit moral de l’auteur et la propriété intellectuelle. C’est un combat pour la dignité de l’artiste et pour la protection de la qualité des œuvres d’art ! Pour en revenir à notre propos, l’écriture collégiale était le mode d’expression des comédiens appelés les Enfants-sans-souci. Or la troupe de Molière, historiquement parlant, est le dernier surgeon des Enfants-sans-souci. D’ailleurs, une fois Molière mort, Louis XIV mettra fin à cette confrérie.
GD : En quelle année ? Et pourquoi ?
DENIS BOISSIER : En 1676. Louis XIV interrompt la longue lignée des comédiens satiristes – cette satire qui s’est longtemps appelée sotie – parce que la sottise-satire n’est plus de mise avec un monarque devenu « le Roi très-chrétien ». La France se fait dévote et ne peut plus tolérer la grivoiserie et la critique sociale.
GD : Pensez-vous que c’est à cause de cette écriture théâtrale à plusieurs mains que les critiques modernes ne sont pas parvenus à s’entendre sur le théâtre de Molière ?
DENIS BOISSIER : A l’évidence ! L’écriture collégiale est ce qui rend caduque la critique universitaire. Il y a dix mille commentaires sur Molière et pas un seul qui ne contredise les autres. Récemment le professeur de la Sorbonne René Pommier a jugé ridicules les commentaires de Georges Forestier sur Dom Juan. Des commentaires si absurdes, si modernistes, qu’il a titré son article « Assez décodé ! ».
GD : Amusant…
DENIS BOISSIER : Comme le laisse entendre ce professeur, le second « d » peut, sans préjudice, être remplacé par deux « n ».
GD : C’est donc à cause de l’écriture collégiale que les moliéristes ne sont jamais parvenus à se faire une idée précise de l’homme que fut Molière.
DENIS BOISSIER : Exactement. Ils s’obstinent à voir en Molière un auteur là où il n’y a qu’un entrepreneur de spectacles. De là découle qu’ils ne parviennent pas à définir ni sa morale ni sa philosophie, parce qu’ils n’ont pas à faire à un intellectuel mais au bouffon du roi, lequel est tout ce que vous voudrez mais pas un intellectuel.
GD : En lisant le Molière de Daniel Mornet, publié en 1943, j’ai relevé ce jugement, qui rejoint le vôtre : « Que de Molières et dont chacun est la négation d’un autre Molière ! » [p. 6].
DENIS BOISSIER : Génération après génération, les moliéristes tentent sans y réussir – et pour cause ! – de faire de Molière, malgré toutes les anomalies constatées et les contre-exemples manifestes, un auteur riche de sa cohérence intime… alors que nous avons affaire à un conglomérat d’individus.
GD : La richesse stylistique que la critique moderne croit inhérente à Molière n’est due, selon vous, qu’à l’emploi de plusieurs plumes successives ou simultanées.
DENIS BOISSIER : Voilà pourquoi Claude Bourqui constate une permanente « rupture de ton » dans chaque pièce de Molière. Il pense que c’est dû au fait que Molière a été formé à l’école de la commedia dell’arte, sans se rendre compte que, précisément, jamais la commedia dell’arte n’a suscité un auteur, au sens moderne de ce mot, encore moins un auteur de l’envergure supposée de Molière.
GD : La commedia dell’arte, c’est Scaramouche.
DENIS BOISSIER : Oui, et Scaramouche n’a jamais songé à être un poète, encore moins l’égal d’un Corneille. D’ailleurs Molière non plus ne s’est jamais pris pour un auteur, lui qui ne voulait pas, en début de carrière, être publié parce qu’il croyait, parce qu’il était un comédien, que les comédies n’avaient pas à être publiées. Il n’y a vraiment qu’un comédien pour pouvoir penser cela !
GD : Selon vous, cette « rupture de ton » est la conséquence de mauvais raccords entre des scènes démarquées d’un peu partout ?
DENIS BOISSIER : Evidemment. Pour avoir écrit une vingtaine de pièces de théâtre je crois connaître un peu la question. Mais comme il s’agit de Molière – le dieu de la Sorbonne – la critique moderne a réussi l’exploit de voir dans ces « ruptures de ton » l’essence même du génie de Molière, ne tenant même plus compte que ces « ruptures de ton », ces contradictions et ces gags qui partent dans tous les sens, s’opposent à toute cohérence intellectuelle.
GD : Cela me fait penser aux critiques des Années Trente qui s’enthousiasmaient pour ce qu’ils appelaient le "génie" des surréalistes, alors que ceux-ci, pour composer leurs poésies, se contentaient d’associer au hasard des vers écrits à l’avance et qui, vérification faite, n’étaient pas toujours d’eux.
DENIS BOISSIER : Le parallèle est intéressant. Les Enfants-sans-souci étaient, sans y songer, des surréalistes, comme, bien souvent, les surréalistes furent des farceurs. Cette déstructuration que la critique relève en permanence dans le théâtre moliéresque est facile à expliquer quand on sait que la fabrication d’un spectacle était une entreprise collégiale. Faire du seul Molière l’auteur de tant de registres intellectuels ou psychologiques, de tant de différences stylistiques ou thématiques, permet, certes, de s’écrier que « Molière est à lui seul tout un monde !» mais c’est une façon bien naïve de voir la réalité théâtrale propre au règne de Louis XIV.
GD : La critique n’accepte ces singularités que de Molière, je crois bien.
DENIS BOISSIER : En effet. Comme les Anglais ne l’acceptent que du seul William Shakespeare. Et pour la même raison. Ni l’un ni l’autre n’existe en tant qu’auteur unique de leur théâtre. D’ailleurs, cette façon de comprendre le théâtre moliéresque est tellement perverse que les moliéristes eux-mêmes s’étonnent que Molière n’ait jamais cherché à rendre cohérente sa pensée, sa morale ou sa philosophie... Daniel Mornet que vous citiez tout à l’heure le dit clairement : « Il n’y a pas de style de Molière » [« il y a un style de Regnard, un style de Marivaux, un style de Beaumarchais, même un style de Nivelle de la Chaussée, qui est détestable, ou un style des drames de Diderot, qui n’est pas meilleur. Il n’y a pas de style de Molière », Molière, 1963, p. 183]. Et les moliéristes ne se rendent même plus compte que ce qui définit un auteur est son style – non son absence de style.
GD : Je suis bien d’accord avec vous.
DENIS BOISSIER : Cette diversité de styles, ce parasitage constant de la pièce par une ribambelle de lazzi étrangers au sujet traité, autrement dit cette dichotomie permanente, Molière s’en fichait comme de sa première planche ! Comme je crois vous l’avoir dit, il ne prenait même pas la peine, ou le temps, de lire la version du spectacle qu’il donnait à publier.
GD : Cette diversité de styles, je dois reconnaître que c’est elle qui m’a fait douter de Molière. Il se trouve que je connais bien le théâtre attribué à William Shakespeare, qui précède de peu Molière… Or, il est évident que la même diversité entraînant les mêmes contradictions et les mêmes incohérences se rencontre aussi dans le théâtre shakespearien.
DENIS BOISSIER : Aux mêmes causes les mêmes effets. Shakespeare fut lui aussi le prête-nom de plusieurs plumes qui ont voulu, pour les mêmes raisons que Corneille, rester dans l’ombre.
GD : Il est curieux de constater que, comme Molière, il n’est pas prouvé que Shakespeare ait suivi une scolarité poussée. Comme Molière aussi, Shakespeare n’a laissé aucun manuscrit de sa main et, ce qui est pour le moins suspect, il ne fait aucune allusion à son œuvre dramatique dans le testament qu’il a laissé. Mais revenons à Molière. La grande qualité de Molière, du moins pour la postérité, est d’avoir porté un regard lucide sur les mœurs de son temps.
DENIS BOISSIER : Heureusement pour lui, car sans cette lucidité, un bouffon n’a aucun avenir, encore moins le bouffon du roi. Ridiculiser les autres et savoir rire de soi sont les deux réflexes de tout bon bouffon. Aujourd’hui, Molière trouverait ridicules ses propres dévots. Ce n’est pas moi qui l’affirme, mais l’historien Antoine Adam : « Molière eût bien ri de ses dévots » écrit-il dans son Histoire de la littérature française au XVIIe siècle [1997, T. 2, p. 793].
GD : J’aimerais que vous reveniez sur ce point d’histoire que je m’explique mal : comment en 1870 on a réussi à faire de Molière un héros républicain si, comme vous le dites, Molière fut officiellement employé comme bouffon du roi ?
DENIS BOISSIER : Le bouffon du roi étant de façon emblématique le reflet de son maître, il ne fut pas trop difficile aux Encyclopédistes de ranger abusivement Molière parmi les « libres penseurs » puis, à la Révolution, de l’assimiler à un pré-républicain. Bien sûr, c’était ne pas tenir compte de la nature même de Jean-Baptiste Poquelin, le plus servile des sujets de Louis XIV. Cherchez autant que vous voudrez : rien dans sa vie ne montre un conflit entre lui et son maître. Mais, paradoxalement, c’est cette servilité étalée sur une quinzaine années d’intense activité qui a facilité la métamorphose posthume de Molière.
GD : Je ne vous suis pas très bien…
DENIS BOISSIER : Si Molière n’avait pas été un bouffon exemplaire, Louis XIV ne se serait pas empressé de le renier ainsi qu’il l’a fait dès qu’il décida d’être le « Roi très-chrétien ». Car c’est Louis XIV qui exigea que soit effacé le côté carnavalesque de sa jeunesse, donc le rôle prépondérant que tenait auprès de lui Molière.
GD : A partir de quand, ce revirement de Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : En 1671/1672, peut-être dès 1670. L’historien François Bluche, à mille lieues de nos thèses, situe ce qu’il appelle « la rupture » en 1670 [« la rupture va se dessiner en 1670 », Louis XIV, 1986, p. 256].
GD : Et Molière meurt en 1673...
DENIS BOISSIER : Oui. Comme Louis XIV a voulu renier son passé de grand païen méchant homme, il a commencé par renier Molière. Il ne veut plus danser devant la Cour toute assemblée, il ne veut plus jouer dans les spectacles de Molière, il ne veut plus rire aux farces de son ex-compère.
GD : Est-il sincère ?
DENIS BOISSIER : Il semble s’être humblement ouvert, chaque jour davantage, à la foi chrétienne. Il est probable qu’il a voulu se montrer digne de celle qui allait devenir son épouse.
GD : …La future madame de Maintenon…
DENIS BOISSIER : Le premier impératif de la crise de dévotion qui frappa la France vers 1670 fut d’édulcorer le passé afin d’effacer toutes « les erreurs de la jeunesse du Roi », comme les appelait le Saint-Siège. Il fallait harmoniser ce récent et gênant passé avec l’Ordre nouveau qui s’établissait. Dès 1673 il n’est plus question d’évoquer le souvenir d’un Molière organisateur des plaisirs de Sa Majesté. La mythologie et ses excès de sensualisme laissent la place dans l’iconographie royale à l’héroïsme chrétien. Versailles a cessé d’être un lupanar. Pour effacer de la mémoire collective les scandales que Molière n’avait cessé de provoquer on n’a pas d’autre choix que de faire de lui un "auteur", comprenez un honnête bourgeois. C’est ainsi qu’on a très vite occulté le bouffon du roi.
GD : Vous dites « on », mais qui est ce « on » ?
DENIS BOISSIER : Tous ceux qui voulaient que la France redevienne chrétienne. Tous ceux que la reine-mère avait autrefois réunis sous sa tutelle et qui adhéraient au plan de restructuration morale mis en place en 1627 par la discrète mais redoutable Compagnie du Saint-Sacrement. Cette compagnie était encore active vers 1665, bien qu’elle ait été officiellement dissoute en 1660. Un témoignage prouve qu’elle a eu sa part dans l’interdiction du Tartuffe. C’est elle encore qui, sans le vouloir, a contribué à renforcer l’amitié entre Corneille et Molière.
GD : Pourquoi ?
DENIS BOISSIER : Parce que la Compagnie du Saint-Sacrement voulait interdire le théâtre sur le sol de France. Pour elle, le théâtre est un lieu de perdition puisqu’il incite à singer des sentiments qu’on n’éprouve pas, sans parler des frasques et des scandales qui ponctuaient la vie des acteurs célèbres, notamment ceux de la jeune épouse de Molière qui faisait de son mari le roi des sots, c’est-à-dire des cocus…
GD : Si je comprends bien, d’un côté nous avons Molière incarnant la vie joyeuse et cocufiée, de l’autre la Compagnie du Saint-Sacrement bastion de la vie dévote.
DENIS BOISSIER : C’est cela. Toutefois le bilan de la Compagnie du Saint-Sacrement n’est pas aussi négatif que vous pourriez le croire. Cette Compagnie est à l’origine de belles actions sociales. Elle était animée par un très utile sentiment de solidarité envers les pauvres, les prostituées, les vagabonds et les prisonniers des galères royales. Mais il est vrai qu’il y avait aussi des fanatiques dans ses rangs. Comme l’écrit l’historien Raoul Allier, la Compagnie du Saint-Sacrement, pour arriver à ses fins, a utilisé « tous les moyens » [« Le rêve de la Compagnie était de ramener l’ordre dans les esprits. Elle s’efforça d’abord de le rétablir dans la conduite visible des hommes. Elle détestait dans le mal qui s’étale un outrage public à Celui dont elle voulait fonder le règne définitif. Ayant assumé la charge de venger la divine Majesté, elle se croyait autorisée à user de tous les moyens, y compris la force, pour arriver plus vite à son but. », La Cabale des dévots, 1627-1666, 1902, p. 110]. Au final, tout ce courant de pensée est devenu ce qu’Antoine Adam appelle le « réalisme politique chrétien », un totalitarisme bourgeois dont le mot d’ordre fut la « bienséance ».
GD : Et tout le monde s’est plié à ce mot d’ordre.
DENIS BOISSIER : Plutôt deux fois qu’une. Le 3 mai 1673, quelques mois après la mort de Molière, Louise Pellisson, veuve d’un comédien de la troupe Béjart/Molière, écrit à un proche de Madeleine Béjart que Molière semble n’avoir jamais existé [« Je vous assure que l’on ne parle non plus du pauvre Molière que s’il n’avait jamais été, et que son théâtre, qui a fait tant de bruit il y a si peu de temps, est entièrement aboli.», Lettre au Comte de Modène].
GD : Quel changement dans les mœurs !
DENIS BOISSIER : Oui, on a fait table rase du passé, pour reprendre une célèbre expression du totalitarisme politique. En 1682, La Grange et l’officier du roi Jean Vivot publient la première hagiographie de l’ex-amuseur du roi. Les moliéristes eux-mêmes, notamment Claude Bourqui, parlent d’une «hagiographisation» [« Le meilleur exemple de ce type d’"hagiographisation" est la préface de l’édition posthume des Œuvres de 1682. », Molière à l’école italienne, 2003, p. 191]. En même temps que l’on "hagiographisait" la vie de Molière, son théâtre était censuré et c’est ainsi qu’il nous est parvenu.
GD : Vous parlez de l’édition de 1682 sur laquelle se base l’Université.
DENIS BOISSIER : Oui, ce qui était un théâtre carnavalesque collégial fut recyclé comme œuvre littéraire bourgeoise, dans l’espoir qu’il cesserait d’être subversif. Ce qui fut sans doute le cas. L’autre grand pivot de cette "hagiographisation", c’est Grimarest. Comme il le reconnaît lui-même, il était aux ordres de la Censure. Il travailla donc en accord avec la Censure pour concocter sa Vie de Monsieur de Moliere, première biographie officielle, c’est-à-dire bien-pensante, de celui qui avait pourtant été honni, notamment par Bossuet, pour avoir été le plus dangereux des mécréants.
GD : En quelle année parut la biographie de Grimarest ?
DENIS BOISSIER : 1705. Avec Grimarest, Molière le bouffon cessait d’être un danger social pour devenir un auteur bien policé.
GD : Et tout cela parce que le roi ne voulait plus entendre parler de Molière. Pousser à ce point l’hypocrisie !
DENIS BOISSIER : Quand je vous disais que le XVIIe siècle fut le grand règne de l’hypocrisie. Eh oui, c’est à cause du triumvirat Colbert-Louis XIV- Mme de Maintenon qu’est née cette hypocrisie bourgeoise dans laquelle nous baignons encore. Et c’est à cause de cette hypocrisie sociale bienséante qu’est née la légende d’un Molière « honnête homme et grand auteur ».
GD : La morale a remplacé le carnaval.
DENIS BOISSIER : Disons un semblant de morale, ou si vous préférez la morale de la classe dirigeante, une morale dans laquelle la simple morale n’entre que pour une mince part. L’Italien Visconti, lors d’un long séjour à Paris, se plaint que la Cour est devenu un « couvent » [« …peu à peu, par la politique du Roi, la Cour devient un couvent de religieux et de religieuses. » Mémoires sur la Cour de Louis XIV, p. 219]. La France était devenue telle que la souhaitait la Confrérie du Saint-Sacrement et Louis XIV ne demandera plus à rire aux farces de son ancien bouffon. D’ailleurs, pour le moliériste Anatole Loquin, c’est Louis XIV lui-même qui exigea qu’une biographie de Molière soit publiée afin d’éviter que les confréries d’amuseurs, prétextant une censure, ne retournent contre lui son ex-bouffon, puisque un bouffon du roi est toujours une arme à double tranchant.
GD : Vous pensez comme lui ?
DENIS BOISSIER : Oui, il est probable que Loquin a raison. En plus, Grimarest a veillé à ne jamais parler de ce qui fâchait les autorités, notamment l’enterrement nocturne de Molière, enterrement durant lequel la foule, qui s’était assemblée dans le petit cimetière, a fait peur aux braves bourgeois.
GD : Pourquoi une telle foule en pleine nuit ?
DENIS BOISSIER : Parce que la foule a toujours aimé les bouffons du roi. Elle voyait en eux son porte-parole. Or, toujours la foule a fait la fête à l’enterrement du bouffon du roi. Donc, à la mort de Molière, elle a fait la fête, même si son enterrement clandestin a eu lieu la nuit… Armande a eu tellement peur de cette foule qu’elle lui a jeté de l’argent pour qu’elle se disperse.
GD : Cela a suffi ?
DENIS BOISSIER : Nous n’en savons rien. Ce qui est sûr, c’est qu’un lecteur de Grimarest lui a reproché publiquement d’avoir occulté, parmi bien d’autres choses, ce passage de la vie de son « Monsieur de Moliere ». Et ce lecteur anonyme rappelle à Grimarest que Molière ne méritait pas le qualificatif de « Monsieur ».
GD : Mais la biographie de Grimarest est aujourd’hui encore l’ouvrage de référence des moliéristes !
DENIS BOISSIER : C’est leur Evangile. Grimarest présente un Molière qui leur convient parfaitement : un Molière honnête homme parangon de l’esprit petit-bourgeois. Comme je vous l’ai dit, ce n’est pas une biographie mais une œuvre édifiante. A tel point que Boileau, qui savait qui avait été Molière, pas précisément ce qu’on appelle un « parfaitement honnête homme », dira de cet ouvrage « qu’il est fait par un homme qui ne sait rien de la vie de Molière » [« Pour ce qui est de la Vie de Moliere, franchement ce n’est pas un ouvrage qui mérite qu’on en parle ; il est fait par un homme qui ne savait rien de la vie de Moliere, et il se trompe de tout, ne sachant pas même les faits que tout le monde sait. » Lettre à Brossette du 12 mars 1706].
GD : On peut s’étonner que ce soit un ouvrage si sévèrement critiqué par Boileau qui cautionne les travaux des moliéristes ! Mais c’est le comédien La Grange qui, le premier, évoque un Molière « parfaitement honnête homme ». Cette expression m’a donné à réfléchir car la différence est colossale entre le Molière tel qu’on le présente de façon posthume et le Molière tel qu’il est perçu de son vivant.
DENIS BOISSIER : L’expression « parfaitement honnête homme » a beaucoup fait pour établir le culte que la Troisième République voua à Molière. Tous les « dévots de Molière » l’ont reprise à leur compte. Grâce à elle, et au mépris des contre-exemples de sa biographie, ils ont pu faire – du moins essayé de faire – de Molière un auteur moral soucieux de la moralité de son époque.
GD : Et c’est ce qui vous agace.
DENIS BOISSIER : Et pour cause ! Ce sentiment de moralité fut le cadet de ses soucis ! Faut-il rappeler que Molière est un homme qui a été condamné par son médecin à ne boire que du lait parce qu’il était malade du foie à force de boire, de manger et de faire la fête ? Faut-il rappeler ses rapports avec l’homosexuel Chapelle et le très jeune Baron, rapports sur lesquels jasaient ses contemporains ?
GD : La Grange et Grimarest ont donc trompé leurs lecteurs en brossant un portrait idéal de Molière.
DENIS BOISSIER : Un pieux mensonge de plus ou de moins, quelle importance ? Entre 1682 et 1705 nous sommes en pleine dictature politique dévote. Molière ne peut être présenté que comme l’exigent Colbert et le Roi. La Grange et Vivot, qui était un officier du roi, ce qui a son importance, lui font même suivre une scolarité au collège de Clermont tenu par les Jésuites.
GD : Je sais que vous ne croyez pas à cette scolarité.
DENIS BOISSIER : Aucun document ne prouve une quelconque scolarité de Jean-Baptiste Poquelin. A cette époque, les fils de boutiquiers ne faisaient pas d’études qui les auraient éloignés de leur métier. Or un document prouve que Jean-Baptiste Poquelin, à l’âge de quinze ans, a pris la succession de son père et a prêté serment devant les représentants de sa corporation. En ce temps-là prêter serment ce n’est pas rien.
GD : Et rappelons que Jean-Baptiste, en tant qu’aîné, a hérité de la survivance de la charge de son père. Je comprends qu’il est crucial de savoir si Molière a fait des études supérieures, mais études ou pas études, pour être comédien Jean-Baptiste Poquelin n’avait pas besoin d’apprendre le latin.
DENIS BOISSIER : En effet. D’autant qu’il s’est spécialisé dès le départ dans la farce de tréteaux. Or, le métier de farceur n’obligeait même pas à savoir lire. Certes Molière, en bon fils de bourgeois, savait lire. Mais une graphologue moliériste, au vu de la soixantaine de signatures plus ou moins malhabiles et changeantes que nous avons de Molière, constate qu’il n’y a « presque pas de caractères constants dans son graphisme ». C’est en ces termes qu’elle conclut son analyse scientifique [« L’écriture de Molière a énormément varié, se montrant tour à tour anguleuse ou ronde, mouvementée ou automatique, nerveuse ou calme, empâtée ou fine, molle ou énergique… On ne retrouve presque pas de caractères constants dans le graphisme de cet homme si divers. », Suzanne Dulait, Inventaire raisonné des autographes de Molière, 1967, p. 122 ]. De plus, comme le remarquait le moliériste Roger Duchêne, si Molière avait fait des études, surtout prestigieuses, il ne l’aurait pas caché. On peut même être certain que pendant sa longue galère provinciale il aurait utilisé cet atout auprès des princes. Or ni lui ni personne, de son vivant, n’a jamais fait allusion à de prétendues études au collège de Clermont.
GD : Et son droit à la faculté d’Orléans ?
DENIS BOISSIER : La faculté de droit d’Orléans était connue pour vendre ses diplômes. Il est probable que son père en a acheté un à Jean-Baptiste. C’est logique pour un commerçant, non ? Une chose est sûre : son inscription n’a jamais été trouvée dans les registres d’aucun collège ni d’aucune faculté. Son dernier grand biographe, Roger Duchêne, est catégorique : Molière n’est jamais allé au collège ni à la faculté [« Molière, tôt destiné au métier de tapissier, n’est jamais allé au collège de Clermont, encore moins à la faculté. », Molière, 1998, p. 35]. Mais devant la postérité, un grand homme ne se doit-il d’avoir été un brillant élève ?
GD : C’est un minimum, en effet.
DENIS BOISSIER : C’était bien l’opinion du service de la propagande de Louis XIV. Toute cette obéissance à l’ordre nouveau atteindra son point d’orgue avec l’ouvrage éminemment politique de Charles Perrault, « porte-parole et homme de confiance du ministre » comme l’a défini l’historien Antoine Adam. Pour la gloire de Louis XIV, et afin de prouver que les Modernes sont supérieurs aux Anciens, Perrault publiera ses Vies des Hommes illustres [1692] dans laquelle Molière trouvera sa place juste à côté, comme par hasard, de Pierre Corneille.
GD : Avec un tel éloge, il y a de quoi être persuadé que Molière a été un « grand auteur ».
DENIS BOISSIER : Oui, si on ne porte pas un regard lucide sur le contexte politique qui a suscité ces écrits. L’analyse historico-critique que j’utilise dans ma thèse Molière, Bouffon du Roi et prête-nom de Corneille se propose de voir au delà des apparences et du consensus de façade. Les faits n’ont une signification que si on peut les intégrer dans un mécanisme historique. Or le moliérisme a pris pour argent comptant, parce qu’ils étaient flatteurs et pouvaient servir les idéaux de la Troisième République, les pseudo-portraits littéraires ou picturaux que la fin du XVIIe siècle et le début du siècle suivant ont brossés de tous les artistes du règne de Louis XIV.
GD : Nous retombons sur le « classicisme » dont nous parlions dans notre premier dialogue.
DENIS BOISSIER : Exactement. Ce que l’historien Raymond Picard appelait « le mythe du règne de Louis XIV ».
GD : Tâchons d’y échapper.
DENIS BOISSIER : Malheureusement les « dévots de Molière » admettent les petits arrangements historiques qui renforcent leur culte.
GD : Ils ont tous tellement foi au « mythe du règne de Louis XIV » ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Sans cette foi, adieu Molière ! Leur naïveté est souvent confondante. Cela dit, les premiers moliéristes avaient aussi leurs raisons pour jouer cette carte. Rappelons qu’en 1863 Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, charge le moliérâtre Eudore Soulié de mettre au point la biographie officielle de celui qui ne pouvait plus se permettre d’avoir été le bouffon du roi. Ne trouvez-vous pas que c’est très inquiétant pour l’indépendance de la recherche ?
GD : Plus que je ne pourrais l’exprimer. Mais vous m’avez dit que c’est la Révolution française qui a définitivement effacé l’aspect «bouffon du roi » de la biographie de Molière.
DENIS BOISSIER : Ce n’est évidemment pas un hasard si en 1789, en même temps qu’on fait de Molière « l’écrivain du peuple », on éradique la fonction de bouffon, car il restait encore des bouffons à titre d’office dans les salons princiers. En pleine crise républicaine la fonction de bouffon du roi devait disparaître de la biographie officielle de Molière.
GD : En résumé, en 1682 on a commencé par faire du « Héros des farceurs » un auteur « parfaitement honnête homme ». En 1705 on en fait un grand auteur. Ensuite la Révolution française fait de lui « l’écrivain du peuple » donc nécessairement un grand homme.
DENIS BOISSIER : C’est cela. C’est ce que l’historien Gérard Moret appelle « les débuts de la liturgie » [« Le XVIIIe siècle et Molière : les débuts de la liturgie » in rubrique ARTICLES DE FOND, site corneille-moliere.org.]. Comme au XVIIe siècle, la notion d’auteur était étonnamment floue et que les comédies, honnies par l’Eglise et les "gens de bien", ne pouvaient décemment pas avoir d’auteurs dans l’acception moderne de ce mot, comme il y a peu pour les romans pornographiques, Molière a pu être déclaré de façon posthume "auteur" de toutes les pièces – désormais jugées des chefs-d’œuvre – qu’il avait assumées en tant que comédien et signées en tant que responsable de troupe. C’est l’écrivain et homme politique Beaumarchais qui a créé en 1794 la notion moderne d’auteur, et de droits d’auteur. Et naturellement, Molière a bénéficié rétroactivement du statut d’auteur. Un siècle plus tard, avec la même candeur, on faisait de lui l’auteur anticlérical par excellence.
GD : Grâce à Tartuffe…
DENIS BOISSIER : Oui, il suffisait d’oublier la genèse de cette pièce – d’ailleurs qui s’en souciait en 1870 ? – pour pouvoir proclamer que Molière était un anticlérical. En y mettant de la bonne volonté, certaines répliques de ses autres spectacles pouvaient même passer pour antiroyalistes. Il fut donc assez facile aux historiens révolutionnaires puis républicains d’occulter que c’était Louis XIV qui avait ordonné à Molière d’écrire contre ceux qui lui reprochaient sa liberté sexuelle et ses goûts païens. Mais "auteur" comme nous le voudrions aujourd’hui, Molière ne l’était pas. Et "anticléricales", la comédie Tartuffe et la comédie Dom Juan ne l’étaient pas davantage.
GD : Tartuffe est tout de même par bien des aspects une pièce anticléricale.
DENIS BOISSIER : Pas de la façon dont nous autres modernes l’entendons. Louis XIV était un monarque de droit divin. Il était le « fils aîné » de l’Eglise catholique, le « lieutenant de Dieu sur la terre ». En ce temps-là, personne ne songeait à être contre l’Eglise. C’était sociologiquement impossible.
GD : Un peu comme aujourd’hui personne n’aurait l’idée d’être contre les Droits de l’Homme.
DENIS BOISSIER : Exactement. Bien sûr, les libertins émettaient des critiques, parfois virulentes, et publiaient des satires qui dénonçaient les excès du clergé. Plus encore, le bouffon du roi se devait de mettre en scène, avec la bénédiction de son maître, les travers ou les ridicules de tel ou tel prélat, et se moquer de certaines crédulités.
GD : N’est-ce pas le but de Tartuffe ?
DENIS BOISSIER : En effet, mais si cette satire fustige des pratiques humaines dévoyées, elle ne remet en cause ni le Pape, ni l’Eglise, encore moins les fondements de la religion chrétienne. Que l’on soit paysan, héros de guerre, bouffon ou monarque, on n’attaquait pas, au XVIIe siècle, l’église du Christ.
GD : Beaucoup de contemporains de Molière ont pourtant vu en lui un adversaire des dévots.
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Par tempérament, Jean-Baptiste Poquelin était tout, sauf un dévot. Mais les premiers spectateurs de Tartuffe ne donnaient pas à cette pièce l’importance que nous lui donnons. Pour eux, Tartuffe n’était pas une œuvre d’art, ni même une œuvre littéraire, encore moins un semblant de doctrine. Pour les contemporains de Molière, Tartuffe était une satire, qui plus est un spectacle mis en scène par le bouffon du roi. Ce qui explique que la reine-mère, réputée chrétienne (en fait, si elle l’était en tant que reine, pour sa part elle aimait beaucoup le carnaval) n’ait jamais été ni contre Molière ni contre Tartuffe. Ni la pièce Tartuffe ni Molière n’ont jamais couru le risque d’ébranler l’Eglise, encore moins une société qui en avait vu bien d’autres. A cette époque, une satire ne pouvait pas avoir de portée politique. Pas plus que de nos jours un film pornographique ou un jeu vidéo. Molière n’était rien, surtout pas un poète admiré comme Pierre Corneille. Ce n’était qu’un farceur de Cour qui ne devait son « bonheur » qu’à l’espèce de sympathie que le roi éprouvait pour ses pitreries. Un texte est très clair sur ce point :
Moliere à son bonheur doit tous ses avantages,
C’est son bonheur qui fait le prix de ses ouvrages ;
GD : Quel est ce texte ?
DENIS BOISSIER : C’est La Lettre satirique sur le Tartuffe publiée en 1669. Son auteur, comme presque toujours, est anonyme. Ces deux alexandrins sont importants car le mot « bonheur » est un euphémisme pour dire que Molière appartient corps et âme au roi. Quand on applaudissait Molière, c’est le goût de Louis XIV que l’on se flattait de partager. Inversement, ce n’est pas Molière que l’on haïssait, mais le penchant du roi pour la sensualité, la grivoiserie et le paganisme.
GD : S’il est assez évident que le théâtre de Molière fut l’un des organes de propagande du pouvoir, sur ce point beaucoup d’historiens sont d’accord avec vous, en revanche, et c’est ce que vous nous expliquez, Molière n’eut jamais par lui-même une influence sociale.
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non, c’était un comédien, et plus encore un farceur ! Certes il a fait beaucoup parler de lui, mais pas plus que Triboulet en son temps. Nous l’avons vu, du vivant de Molière, personne n’a jamais songé à étudier son théâtre comme on le fit pour Corneille ou Racine. On a seulement condamné le fait qu’il puisse, lui et lui seul, mettre en scène des thèmes relevant de la religion. Puisque le théâtre moliéresque n’était pas l’œuvre d’un écrivain il n’y avait pas matière à défendre une thèse ou une antithèse, comme les intellectuels du XVIIe siècle l’avaient fait pour Le Cid ou le feront en 1680 pour les tragédies chantées de Quinault-Lully.
GD : Et Molière n’a pas eu non plus de descendance littéraire. Il n’a pas fait école.
DENIS BOISSIER : Pour susciter une école, encore faut-il qu’il y ait au départ un maître. Personne après lui n’a fait du Molière parce que personne après lui n’en a eu les moyens financiers et techniques. Sans le roi et sans Corneille, je vous l’ai dit, pas de Molière. Au risque de me répéter, Molière n’était que l’instrument du roi. Et de même qu’il ne représentait aucun idéal littéraire, il n’a représenté aucun danger pour la Cour, les institutions ou l’Eglise. On était seulement agacé par les abus scéniques du farceur Molière.
GD : Un peu comme Coluche. Coluche n’a jamais fait courir un risque à la France lorsque, en 1981, il a prétendu se faire élire président. Ne trouvez-vous pas qu’il y aurait un parallèle à faire avec Coluche ?
DENIS BOISSIER : Coluche fut un bouffon de télévision comme Molière fut un bouffon de Cour. Ne croient aux déclarations et aux agitations d’un bouffon que les gens crédules.
GD : Donc, à aucun moment Tartuffe n’a représenté un danger pour l’ordre social ?
DENIS BOISSIER : Tartuffe fut un scandale pour les uns, un règlement de comptes pour les autres et dans tous les cas, le spectacle qu’on se devait d’aller voir. Mais un danger pour les autorités, jamais. Tartuffe fut seulement l’indice d’une nouvelle orientation du peuple français, qui commence alors à se détourner insensiblement de l’Eglise. Pour ramener le calme, il a suffi d’interdire momentanément Tartuffe, ce qui fut fait par le roi lui-même, puis de redonner cette pièce au public quand eurent cessé, en 1669, les tensions entre le pouvoir temporel représenté par Louis XIV et le pouvoir spirituel incarné par le Pape.
DG : Finalement, ce qui agaçait la Cour et plus encore l’Eglise, c’est que le roi encourage son bouffon à souvent dépasser les bornes.
DENIS BOISSIER : C’est du reste l’ « emploi » exact d’un bouffon du roi. Louis XIV n’était pas un rêveur, il savait que si l’élite intellectuelle détestait Molière, le peuple, lui, aimait celui qui lui ressemblait. Or, le roi avait besoin de contrôler son univers. Pour la Cour, il avait Saint-Aignan qui lui servait d’"indic". Pour le peuple, il utilisa Molière. D’où le rôle ambigu de Molière : être le porte-parole de son maître auprès du peuple et celui du peuple auprès du roi. D’où également son statut particulier dans une société où les extrêmes ne pouvaient se rejoindre qu’en lui le temps d’un spectacle. Evidemment, les théoriciens du classicisme exécraient Molière. Pour l’écrivain officiel Chapelain, la farce – donc le théâtre moliéresque – est tout juste bonne « à complaire aux idiots et à cette racaille qui passe en apparence pour le vrai peuple et qui n’en est en effet que sa lie et son rebut ». Dans sa Pratique du théâtre, d’Aubignac réserve « les méchantes bouffonneries de nos farces » à « la populace élevée dans la fange ». Et malgré de tels aveux, l’Université démocratique fait les yeux doux aux théories du classicisme !
GD : Mais puisque Molière était aux ordres du roi, pourquoi l’Eglise et l’élite condamnaient-elles son théâtre ?
DENIS BOISSIER : Ce n’est pas son théâtre à proprement parler qu’elles condamnaient. Elles considéraient les spectacles moliéresques comme une sorte de carnaval. C’est d’ailleurs pendant la période du carnaval qu’avait presque toujours lieu la création des nouveaux spectacles, comme celui de Dom Juan. Ce ne sont donc pas les spectacles de Molière, c’est l’homme, je veux dire le bouffon du roi, que l’Eglise, la Compagnie du Saint-Sacrement et une moitié de la Cour combattaient. Elles savaient qu’aussi longtemps que le roi ordonnerait à Molière d’être le maître d’œuvre de l’esprit carnavalesque, le roi oublierait de devenir ce que tous les Français d’alors espéraient le voir être : le « Roi très-chrétien ».
GD : Ce n’est donc pas sa personne ni son talent – ou son absence de talent – mais sa fonction de bouffon du roi qui déclenchait tous les applaudissements et cette haine envers Molière ?
DENIS BOISSIER : J’en veux pour preuve qu’après avoir commencé à éloigner de lui Molière dès 1671, le roi, sous les conseils de ses proches, a fait interdire à la Cour et dans les théâtres parisiens tous les autres farceurs célèbres, notamment les Italiens. En 1680 tous les bouffons professionnels avaient été chassés du royaume et les bonnes mœurs avaient gagné. La France se préparait à redevenir « la fille aînée de l’Eglise » selon l’expression du cardinal Langénieux. La France ne voulait plus du bouffon du roi. Elle ne voulait que son roi, et son roi repenti.
GD : Je vous remercie pour toutes ces précisions. Si vous le voulez bien, nous allons arrêter pour aujourd’hui ce deuxième dialogue, aussi instructif que le précédent.
DENIS BOISSIER : Nous allons faire une pause, mais n’oublions jamais que la vérité est en marche, toujours… (Rires).
TROISIÈME DIALOGUE
« "Moliere" vient du verbe molierer, utilisé dans le nord de la France pendant les XVe et XVIe siècles, qui signifie légitimer » (21 septembre 2008)
GERARD DURAND : Revenons, si vous le voulez bien, à l’attitude des Français envers Molière au lendemain de la Révolution française.
DENIS BOISSIER : En faisant de Molière, après 1789, un défenseur des droits du citoyen, les pères fondateurs de la République ont falsifié l’histoire du règne de Louis XIV. Molière n’a jamais défendu qu’un droit : celui que son maître avait de régner seul avec la bénédiction du saint Père, lequel est, dans la pensée traditionaliste, placé plus près de Dieu que le roi.
GD : On aurait donc créé avec Molière un héros qui puisse incarner les nouveaux idéaux.
DENIS BOISSIER : Les idéaux anti-cléricaux prônés par Voltaire, lequel fut le premier à mettre Molière sur un piédestal. Pour cela, il a allègrement sacrifié Corneille, car le dramaturge qu’était Voltaire jalousait beaucoup le bien meilleur dramaturge que fut Corneille.
GD : C’est le moins que l’on puisse dire… Donc Molière fut le contraire d’un héros républicain.
DENIS BOISSIER : Plus courtisan et plus amoral que Jean-Baptiste Poquelin, parmi le peuple, vous trouverez difficilement… D’ailleurs, pourquoi voulez-vous que Jean-Baptiste Poquelin avec son hoquet permanent, ses crises de toux fréquentes et sa femme qui l’a toujours cocufié, soit un héros ?
GD : Je n’y tiens pas particulièrement, mais c’est ainsi que le présentent les deux textes qui évoquent sa personnalité, la notice de La Grange publiée en 1682 et la biographie de Grimarest en 1705.
DENIS BOISSIER : Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire dans notre précédent dialogue, ces deux textes, écrits en plein totalitarisme politique chrétien, sont des hagiographies.
GD : Autrement dit, pour comprendre le vrai Molière…
DENIS BOISSIER : Dites plutôt Jean-Baptiste Poquelin…
GD : … il faut se départir de ce que vous appelez les préjugés moraux républicains et romantiques.
DENIS BOISSIER : Sinon vous ferez du moliérisme, ce qui revient à pratiquer la politique de l’autruche. Mais se départir des préjugés modernistes est si malaisé que l’opinion publique rejette par avance nos deux principales thèses : Molière bouffon du roi ; Molière prête-nom de Pierre Corneille.
GD : Reconnaissez que vous exigez une totale remise en question de nos habitudes de penser.
DENIS BOISSIER : Pour juger sereinement de qui fut Molière, c’est une nécessité.
GD : Ceux qui acceptent vos thèses sont-ils tous d’accord pour abandonner la vision romantique que nous avons de Molière ?
DENIS BOISSIER : Pourquoi pas ?… Rien n’est meilleur pour l’esprit que de changer d’habitude, d’autant que ce n’est jamais que le premier pas qui coûte... L’analyse historico-critique exige la mise en examen de tout ce que nous avons appris en classe et de tout ce que nous répètent, par consensus, les livres d’histoire littéraire, lesquels, par le biais de l’Université, sont aux ordres de l’Etat. Comme je vous l’ai dit dans notre deuxième dialogue, dès 1863, donc un peu avant la naissance de la Troisième République, Victor Duruy, Ministre de l’Instruction publique sous Napoléon III, demandait aux moliéristes de mettre au point une biographie de Molière qui satisfasse l’honneur français. Ce qui fut fait avec diligence. Et en 1879 paraissait l’organe de propagande Le Moliériste, revue qui servit d’Eglise aux « dévots de Molière », comme ils se définissent eux-mêmes.
GD : Revenons à Molière. Qu’est-ce qui nous empêche, aujourd’hui, de le voir « tel qu’il fut historiquement parlant », pour employer votre expression ?
DENIS BOISSIER : La mentalité du grand siècle étant ce qui nous manque le plus, nous ne pouvons plus comprendre ce que fut l’exacte fonction sociale du théâtre moliéresque, ni ce qui se passait dans les coulisses du Palais-Royal, ce théâtre dont Louis XIV avait donné la direction à son bouffon dès 1661.
GD : Mais pourquoi la carrière de Molière ne se réduirait-elle qu’à celle de bouffon du roi ? Même s’il le fut, rien ne l’empêchait d’être aussi un comédien et un écrivain. Il n’y a pas forcément incompatibilité.
DENIS BOISSIER : Si, il y a incompatibilité. Il est illogique que celui qui s’est voulu un farceur toute sa vie soit dans le même temps un auteur de génie. Il y a comme une impossibilité ontologique. Notre âme est le résultat de tous les efforts que nous faisons pour être nous-mêmes. Chaque vocation demande trop de temps et trop d’effort pour pouvoir être cumulable avec une autre. Que nous le voulions ou non, la vie nous spécialise et l’habit fait le moine autant que le bouffon.
GD : Le célèbre peintre Ingres était aussi un très bon violoniste et le poète Hugo un dessinateur remarquable.
DENIS BOISSIER : Ingres fut un excellent peintre mais seulement un bon violoniste amateur. Quant à Hugo, son talent de dessinateur n’a jamais fait de lui l’équivalent d’un Gustave Doré.
GD : Puisqu’il est établi que l’extraordinaire comique qu’était Molière était un comédien médiocre, pourquoi n’aurait-il pas été un comédien médiocre et un auteur de génie ?
DENIS BOISSIER : Précisément parce que Molière fut, de l’avis de tous ses contemporains, un farceur de génie doublé d’un metteur en scène efficace, triplé d’un directeur de troupe remarquable. Or, s’il y a une certaine cohérence à être à la fois un piètre comédien, un farceur inimitable, un bon chef de troupe et un directeur de théâtre efficace, il y a un hiatus infranchissable entre la nature de comédien et celle d’auteur dramatique. L’extraversion de l’un s’oppose tout naturellement à l’introversion de l’autre. A un niveau d’excellence ces deux vocations, si exigeantes, ne sont pas conciliables.
GD : Voir en Molière à la fois un grand comique et un grand auteur est, selon vous, une vision romantique ?
DENIS BOISSIER : Romantique et superficielle. Etre bouffon du roi est le couronnement d’une vie de farceur. Etre un auteur de génie est le couronnement d’une vie d’études, de réflexion, d’écriture et de corrections. Or à l’évidence, Molière n’a jamais eu le temps ni l’état d’esprit nécessaires pour être l’équivalent de Pierre Corneille.
GD : Mais rien ne l’empêchait d’être un disciple de Corneille !
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, comment expliquer que Molière ait bénéficié, seulement quand il en a eu besoin, du style de Corneille, jugé pourtant « inimitable » par Racine, et que dans toutes les autres occasions ses textes tournent très souvent au « galimatias » selon le mot de Fénelon, ou font preuve de « barbarismes » comme le constata La Bruyère ?
GD : Parce qu’il n’avait pas toujours le temps de travailler correctement.
DENIS BOISSIER : Vous croyez qu’il suffit d’avoir du temps pour écrire comme Pierre Corneille ?
GD : On nous dit qu’à force de jouer le théâtre de Corneille, le comédien qu’est Molière a acquis ses techniques.
DENIS BOISSIER : Vous en connaissez, vous, des comédiens qui à force de jouer Anouilh ou Sartre ont écrit des pièces identiques, quant à la tenue et la teneur, à celles de ces auteurs ? Et pensez-vous que c’est pour avoir souvent joué les tragédies de Corneille que Molière a acquis la culture de l’auteur de Cinna ? Car pour écrire Tartuffe ou Le Misanthrope, il faut une érudition particulière. Par exemple, pour écrire Tartuffe, il faut avoir lu un ouvrage latin du cardinal Bellarmin datant de 1615 [De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum, cité par Georges Couton dans Molière, Œuvres complètes, 1971, T. I, p. 1356], avoir lu Les Lettres aux Philippiens de Saint-Paul, La Somme des péchés du Révérend Père Bauny, L’Imitation de Jésus-Christ de Thomas a Kempis… un gros ouvrage que traduisit du latin, comme fait exprès, Pierre Corneille…
GD : Bien sûr, cela incite à douter… Mais pour jouer l’avocat du diable, je vous répondrai : Pourquoi pas ?
DENIS BOISSIER : Peut-on lucidement se représenter Jean-Baptiste Poquelin analysant de longues heures ces ouvrages ardus, obligé d’annoter du latin, langue dont on n’a aucune preuve qu’il ait su la lire, et encore moins la lire suffisamment bien ?
GD : J’ai lu pourtant que Molière a traduit une poésie de Lucrèce.
DENIS BOISSIER : Les moliéristes se basent sur deux témoignages, celui de l’abbé Marolles et celui de l’écrivain Chapelain. Mais ces deux prétendus témoins n’en sont pas car l’un et l’autre prennent bien soin d’écrire : « on dit que… ». Ils parlent donc l’un comme l’autre seulement par ouï-dire.
GD : L’abbé Marolles ne fait-il pas par deux fois allusion à une traduction faite par Molière ?
DENIS BOISSIER : En effet, la première fois c’est en 1659, il écrit à propos de d’une poésie de Lucrèce : « On m’a dit qu’un bel esprit en fait une traduction en vers… » [Les Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin]. Marolles ne connaît pas Molière et ne fait que rapporter un "on-dit". De plus, il ne nomme pas ce « bel-esprit », ce qui a fait dire à plusieurs spécialistes qu’il ne s’agissait pas de Molière.
GD : Mais la seconde fois Marolles est plus précis…
DENIS BOISSIER : La seconde fois, en 1677, Marolles écrit : « Ces vers n’ont vu le jour que par la bouche du comédien Molière, qui les avait faits. » [« Plusieurs ont ouï parler de quelques vers, après la traduction en prose qui fut faite de Lucrèce dès l’année 1649, dont il y a eu deux éditions. Ces vers n’ont vu le jour que par la bouche du comédien Molière, qui les avait faits. », Les Six livres de Lucrèce « De la Nature des choses »].
GD : C’est clair, me semble-t-il.
DENIS BOISSIER : Pas autant que vous le croyez. Car à moins d’extrapoler, Marolles rapporte seulement que le comédien a récité des vers traduits de Lucrèce. Il n’écrit pas que ces vers sont sortis de sa plume mais de sa bouche.
GD : Oui, mais il dit que c’est Molière « qui les avait faits ».
DENIS BOISSIER : Marolles croit si peu que le « comédien Molière » ait pu entreprendre une traduction du latin qu’il précise que cette versification repose sur une traduction préexistante et qu’il ne croit pas que Molière ait eu le temps ni les capacités intellectuelles pour faire une véritable traduction [« Je ne pense pas que son loisir (ou peut-être quelque chose de plus) le lui eût pu permettre, quelque secours qu’il en eût pu avoir d’ailleurs, comme lui-même ne l’a pas nié à ceux qui voulurent savoir de lui de quelle sorte il en avait usé pour y réussir aussi bien qu’il faisait : leur ayant dit plus d’une fois qu’il s’était servi de la version en prose, dédiée à la sérénissime reine Christine de Suède. »]
GD : Si Molière n’a pas traduit Lucrèce, il a, du moins, selon Marolles, versifié la traduction en prose.
DENIS BOISSIER : Marolles dit seulement que cette versification est sortie de la bouche de Molière. Ce sont ces termes. Et qu’un comédien récite de la poésie est tout à fait naturel. Il faut aussi tenir compte des spécificités du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle quand un comédien faisait connaître à un public une poésie, rien ne l’empêchait de s’en dire l’auteur car la paternité d’une œuvre était liée au fait de la rendre publique. Le lien intellectuel entre une œuvre et son auteur, le seul lien que nous reconnaissons aujourd’hui pour légitime, n’avait alors aucune importance sociale, aucune valeur morale.
GD : Vous n’arrivez vraiment pas à vous représenter Molière en train de versifier !
DENIS BOISSIER : Autant croire que Corneille passe ses soirées à peaufiner ses grimaces en compagnie du farceur Scaramouche ou à boire avec le jeune satiriste Boileau au cabaret libertin de La Croix-Blanche. Je vous l’ai dit, être Pierre Corneille ne s’improvise pas. Cela exige des milliers, des dizaines de milliers d’heures de lecture, de réflexion et d’annotations. Même Racine n’avait pas l’envergure technique de Corneille. Ce qui me gêne, dans le cas de Molière, c’est que ses prétendues grandes pièces sont toutes bâties sur un profond substrat rabelaisien, juridique et religieux – celui précisément que possédait Pierre Corneille. C’est là le problème avec Molière : tout chez lui, ou dans sa prétendue œuvre, ramène toujours à Pierre Corneille.
GD : Oui, j’ai vu que dans les Œuvres complètes de Molière publiées dans la collection de La Pléiade, Georges Couton passe son temps à faire référence à Corneille pour tel mot ou telle expression.
DENIS BOISSIER : Les moliéristes ne peuvent s’empêcher de faire des rapprochements constants entre leurs œuvres. Mais, dans le même temps, ils se refusent à en faire d’aussi significatifs en ce qui concerne leurs carrières pourtant si proches.
GD : Selon vous, c’est parce que Corneille est toujours dans l’ombre de Molière qu’il existerait un accord tacite chez les biographes de Molière de ne jamais évoquer Corneille ?
DENIS BOISSIER : Vous voyez une meilleure explication ? Cette règle est tellement ancrée chez eux que c’en est puéril. Il y a des milliers d’articles sur Molière et Racine, Molière et Chapelle, Molière et Mauvillain ou tel autre personnage obscur dont on n’a pas dix lignes biographiques. Il y a même des articles "Molière et Descartes", et même un "Molière et Rimbaud"…
GD : Amusant !
DENIS BOISSIER : … mais pas une seule étude universitaire sur "Molière et Pierre Corneille". Il y a là comme un blocage psychologique, une autocensure, et, au final, une hypocrisie insupportable. Un jour, j’ai eu la curiosité de recenser les qualités qui pouvaient faire de Corneille le collaborateur idéal de Molière. Bien sûr, je me doutais que j’allais en trouver plus que chez quiconque parmi les écrivains qui fréquentaient le « premier farceur de France », mais je ne pensais pas en trouver autant. Avec Donneau de Visé, Chapelle ou Boileau il y avait deux, trois, jusqu’à cinq caractéristiques qui pouvaient faire d’eux des collaborateurs efficaces… J’en ai relevées pas moins de vingt avec Pierre Corneille ! Vous pouvez lire cette liste dans l’article d’Hélène Fernac « Dossier d’un prof. de lettres sur Corneille-Molière » [site corneille-moliere.org., rubrique A LIRE EN PRIORITE].
GD : Vous êtes vous-même comme un professeur de français qui doit mettre la note de 18 sur 20 à un élève, et qui doute de cet élève parce que d’habitude il obtient à peine la moyenne.
DENIS BOISSIER : Reconnaissez qu’il y a là matière à suspicion, surtout si cet élève connu pour ses farces a été vu avec le premier de la classe, et si vous découvrez que cet élève ne possède qu’une petite bibliothèque d’une valeur cinquante fois inférieure à celle de sa vaisselle.
GD : Comment sait-on pour la bibliothèque de Molière ?
DENIS BOISSIER : L’inventaire après décès dresse la liste des livres que Molière possédait. Environ deux cents, ce qui n’est rien puisqu’un écrivain ou un bon bourgeois, à cette époque, en possédaient généralement plusieurs milliers. C’était alors un signe distinctif d’honorabilité. Un moliériste s’est même écrié, je crois que c’est Henri Lavoix : « Comment ! c’est là tout ? ».
GD : On peut être un grand écrivain et ne pas être bibliophile.
DENIS BOISSIER : Il ne s’agit pas d’être ou n’être pas bibliophile, mais de posséder les livres dont on a besoin pour travailler ou que l’on a plaisir à lire. Je ne suis pas bibliophile, mais j’ai plusieurs milliers d’ouvrages dans mes rayonnages. Mais il est vrai que je suis écrivain et que rien dans ma vie professionnelle n’indique le contraire...
GD : Molière a peut-être vendu sa bibliothèque avant de mourir ?
DENIS BOISSIER : Qu’allez-vous chercher ?! Vous savez comme moi que ce n’est pas une chose qu’un écrivain fait de gaieté de cœur et Molière n’avait pas besoin d’argent. Il n’a d’ailleurs jamais cessé de faire fortune. Le plus désillusionnant pour un moliériste, c’est de découvrir que non seulement Molière possédait peu de livres mais qu’en plus beaucoup lui ont été offerts ! Il ne s’est même pas donné la peine de les choisir…
GD : J’ai connu de ces personnes qui vivent dans le luxe et se flattent d’être cultivées mais qui, d’elles-mêmes, ne songeraient pas à se constituer une bonne bibliothèque. Ces livres, qui les lui a offerts ?
DENIS BOISSIER : Ses amis écrivains libertins.
GD : Et pour le reste ?
DENIS BOISSIER : Principalement des recueils de comédies italiennes, espagnoles et françaises dans lesquels lui et ses compagnons piochaient les scènes qu’ils voulaient reprendre à leur compte. Comme je vous l’ai dit, le théâtre collégial moliéresque (les œuvres vendues par Corneille mises à part) est fait pour l’essentiel de plagiats ou d’arrangements de scènes préexistantes et souvent applaudies depuis bien longtemps. Le moliériste Claude Bourqui a consacré cinq cents pages aux plagiats de Molière enfin, M. Bourqui préfère employer le terme plus neutre de "sources", terme par ailleurs incorrect car si on ne dévoile jamais un plagiat, on se doit, en revanche, de citer ses sources. Or, Molière ne cite jamais ses "sources".
GD : Molière s’adressait au peuple, pas aux érudits comme Corneille. Citer ses sources ne lui était d’aucune utilité.
DENIS BOISSIER : En effet. Mais il a tellement fait d’emprunts qu’il aurait pu citer les principaux, simplement par souci d’honnêteté intellectuelle.
GD : Ses confrères de la comédie le faisaient-ils ?
DENIS BOISSIER : Non, il est vrai…
GD : En somme, c’est la bibliothèque d’un homme pragmatique, avec d’un côté les livres offerts par ses amis et, de l’autre, les pièces dont il pouvait avoir besoin.
DENIS BOISSIER : Oui. Les relations et le travail. Ce n’est pas la bibliothèque de « Molière génie universel », mais celle de Jean-Baptiste Poquelin, entrepreneur de spectacles. Ah ! j’oubliais de vous dire que Poquelin avait aussi chez lui le théâtre complet de Pierre et Thomas Corneille.
GD : Voilà qui a dû en irriter beaucoup !
DENIS BOISSIER : On a aussi constaté qu’il ne possédait pas une seule pièce de Racine.
GD : C’est normal, Molière s’était fâché avec lui.
DENIS BOISSIER : Et alors ? En quoi le fait de s’être fâché avec Racine change-t-il la valeur de ses œuvres ? Vous trouvez naturel que Molière n’ait pas chez lui les chefs-d’œuvre de Racine ?
GD : Pas forcément, mais…
DENIS BOISSIER : Cette mesquinerie, si elle est sans doute digne d’un Jean-Baptiste Poquelin, ne l’est pas du grand, de l’admirable Molière, perfection du genre humain.
GD : Ne pas avoir une belle bibliothèque n’est pas une preuve que l’on est incapable d’écrire des chefs-d’œuvre.
DENIS BOISSIER : Je sais que dans l’univers moliériste rien n’est jamais une preuve contre Molière, même de ne pas laisser à la postérité une seule ligne écrite de sa main. Mais si rien n’est une preuve, accordez-moi que le fait de signer une pièce n’est pas non plus une preuve qu’on l’ait écrite.
GD : Tout à fait. Le nom d’Alexandre Dumas est sur la couverture des Trois mousquetaires, or nous savons que c’est son collaborateur Auguste Maquet qui en est le seul auteur, à quelques corrections près. On ne peut jamais être certain d’une signature : même Vingt mille lieues sous les mers, signé Jules Verne, est l’œuvre d’André Laurie, son discret collaborateur.
DENIS BOISSIER : En revanche, nous savons une chose de certaine sur Molière, et très significative : il a commencé sa carrière comme farceur sous le masque de Mascarille et l’a terminée comme farceur sous le masque de Scapin.
GD : … Sans oublier le masque presque mortuaire du Malade imaginaire.
DENIS BOISSIER : … Et cette continuité en dit long sur l’homme qui prit pour nom de scène « Moliere ». Une continuité qui s’accorde parfaitement avec cet autre fait historique : Molière n’a jamais été pour ses contemporains autre chose que le « premier farceur de France », comme le définit Somaize qui le connaissait et ne l’aimait pas.
GD : Ce sont pourtant ses contemporains qui ont souvent appelé Molière « l’illustre auteur ».
DENIS BOISSIER : Je vous l’ai dit, cela ne signifiait rien à cette époque. Tous les comédiens étaient "auteurs" des comédies qu’ils jouaient. Le mot auteur n’avait alors aucun sens moral ou juridique. Si un livre était publié non signé, l’éditeur en était ipso facto l’auteur, c’est vous dire le flou de la notion d’auteur, ce que les dix-septiémistes appellent dans leur jargon l’auctorialité. Sous Louis XIV, par crainte des représailles, celui auquel on attribue une comédie, à plus forte raison une satire subversive, est toujours le comédien-vedette qui la présente au public.
GD : Dans notre deuxième dialogue, vous avez dévoilé la signification de l’adéquation que ses contemporains faisaient entre Molière et le grand auteur comique latin Térence…J’aimerais que vous reveniez sur cette comparaison à première vue si flatteuse.
DENIS BOISSIER : En l’assimilant à Térence, les lettrés du XVIIe siècle pratiquaient l’"éloge ironique" si caractéristique des mœurs littéraires d’alors. Pour eux, Térence n’était pas l’auteur des pièces jouées sous son nom. Ils ne croyaient pas à son statut d’auteur parce que les contemporains de Térence eux-mêmes ne s’étaient guère fait d’illusions. Du vivant de Térence, le véritable auteur était Scipion Emilien. En comparant Molière à Térence, ses contemporains ne font que rappeler au public ce que les lettrés savaient parce qu’ils avaient lu Suétone ou Montaigne. Donc, en donnant à entendre que Molière est pareil à Térence ils sous-entendent que quelqu’un est nécessairement l’équivalent de Scipion.
GD : Lequel, comme vous me l’avez appris, se prénommait Cornélius… Donc chaque fois qu’ils font allusion à Térence, ils nous disent à demi-mot que Molière est le prête-nom de Corneille.
DENIS BOISSIER : Oui, d’autant que, si je ne me trompe, le premier à avoir dit que Molière « peut passer pour le Térence de notre siècle », c’est Donneau de Visé [Nouvelles nouvelles, 1663, T. III, p. 218 ; également dans Molière, Œuvres complètes, éd. Georges Couton, 1971, T. I, p. 1017]. Or, Donneau de Visé savait très bien qui était Molière. Depuis longtemps il était en affaires avec Molière et lui servait de relais promotionnel, comme il sera bientôt en affaires avec Thomas Corneille.
GD : Donc, si Molière signait les pièces qu’il donnait au public, c’est parce que les véritables auteurs ne pouvaient pas le faire par crainte des représailles de l’Eglise.
DENIS BOISSIER : De l’Eglise, de la Sorbonne et du Pouvoir. Un comédien qui était le « Héros des farceurs », comme l’appelle l’académicien Valentin Conrart, pouvait, sur scène, tout se permettre. Molière était un farceur et il sut tirer profit de sa situation. D’ailleurs c’est bien comme farceur, et non comme auteur, que le peintre Verio l’a représenté de son vivant, au milieu de ses confrères en farceries Turlupin, Arlequin, Guillot-Gorju, Polichinelle, Scaramouche...
GD : Scaramouche dont Molière a été le disciple…
DENIS BOISSIER : Cette filiation est un fait historique que plusieurs témoignages et documents attestent. Mais que Molière ait été le disciple de Corneille, voilà une illusion propre aux seuls moliéristes. Croyez-vous que si Molière avait été l’auteur, plume à la main, de L’Ecole des Femmes, par exemple, il aurait joué le personnage d’Arnolphe en farce, qu’il aurait ridiculisé son personnage alors que, dans le même instant, sa plume lui donnait une âme ? Il y aurait là une schizophrénie pour le moins inquiétante, ne trouvez-vous pas ?
GD : Les moliéristes ont dû constater eux aussi cette contradiction ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr, mais comme ils n’envisagent pas un instant que Molière ait pu être le prête-nom de Corneille (alors même que toutes les vedettes de la scène étaient des prête-noms), ils ne cherchent pas à découvrir le pourquoi de cette antinomie intellectuelle, pour ne pas dire psychologique. L’éminent Raymond Picard, par exemple, constate ce qu’il appelle des « ruptures de ton ». Il trouve cela « étrange », c’est le mot qu’il emploie, mais il s’arrête à cette seule constatation [« Il peut sembler étrange que Molière, en le faisant parler, ait comme oublié l’univers comique où se mouvait son héros, et que, ménageant ainsi de bien curieuses ruptures de ton, il lui ait donné un langage qui convînt aussi mal à la situation», « Molière comique ou tragique ? Le cas d’Arnolphe », dans Revue d’Histoire Littéraire de la France, 1972, n° 5-6, p. 779].
GD : Que lui diriez-vous ?
DENIS BOISSIER : Que ces « ruptures de ton » inhérentes aux grandes pièces de Molière sont le meilleur indice d’une collaboration. Au XVIIe siècle, les comédies étaient écrites collégialement, puis, si besoin était, un poète aux gages, comme on les appelait, donnait à la pièce son cachet définitif. Corneille s’est acquitté de ce travail. L’érudit Adrien Baillet écrivait en 1686 : « On prétend que Molière ne savait pas même son théâtre tout entier » [Jugement des savants, T. V, p. 313]. Tout est dit. Molière était un entrepreneur de spectacles et le bouffon du roi. Deux raisons majeures pour n’avoir pas à écrire durant des milliers d’heures les spectacles qu’il offrait dans le meilleur délai à un Louis XIV toujours pressé et qui exigeait, afin d’avoir le plus de chance d’être satisfait, la discrète collaboration des plus grands artistes.
GD : Molière ou l’auteur malgré lui…
DENIS BOISSIER : Pourquoi pas ? Il y a deux anomalies, l’une expliquant l’autre, à condition de ne pas vouloir s’illusionner. La première de ces anomalies est que nous ne possédons aucune preuve manuscrite que Jean-Baptiste Poquelin ait écrit de sa main quoi que ce soit. La deuxième anomalie est que nous savons que Jean-Baptiste n’a jamais rien produit, au sens littéraire de ce verbe, avant l’âge de trente-sept ans. Ces deux anomalies s’associent parfaitement pour nous montrer que nous n’avons pas affaire à un écrivain mais à un comédien.
GD : Molière ne pourrait-il pas s’être éveillé à l’écriture à trente-sept ans ?
DENIS BOISSIER : Et devenir génial en dix leçons ? Vous croyez que l’on s’improvise Pierre Corneille ? Que constatons-nous ? Qu’il produit ses seules bonnes pièces à partir de 1658, époque où il a fréquenté Pierre Corneille pendant six mois et avec lequel il restera en relations constantes.
GD : « Constantes », l’épithète n’est-elle pas trop forte ?
DENIS BOISSIER : A partir de 1658 on trouve à chaque étape de la carrière de Molière des connexions entre Corneille et lui, mais encore faut-il vouloir les remarquer. Des connexions de toutes sortes. Que ce soit par le biais de la comédienne de Molière, Marquise du Parc, dont Corneille s’amouracha, ou à l’occasion des pièces qu’ils présenteront ensemble au public comme Attila ou Tite et Bérénice, sans oublier Psyché qui sera, en 1671, leur plus grand succès de Cour commun.
GD : Selon vous, c’est Marquise du Parc qui a facilité l’association définitive entre Molière et Corneille que vous faites démarrer en 1658 ?
DENIS BOISSIER : En 1658 Pierre Corneille et Marquise ont flirté ensemble, des documents le prouvent. Mais la première à avoir fait se rencontrer Jean-Baptiste Poquelin et Pierre Corneille fut Madeleine Béjart, en 1643. Madeleine connaissait Corneille depuis longtemps puisque sa famille travaillait pour le duc de Guise qui était le protecteur de Corneille et chez lequel le poète logeait lorsqu’il était à Paris. Après Madeleine Béjart et Marquise du Parc, il y aura Armande Béjart, la jeune épouse de Molière
GD : … qui cocufiera souvent son mari.
DENIS BOISSIER : Oui… Corneille éprouvera pour Armande une « estime extrême » comme l’écrit son ami le gazetier Robinet. C’est pour Armande que Pierre Corneille écrira en 1672 sa tragédie Pulchérie.
GD : Les jolies femmes ont donc leur part dans le rapprochement entre Corneille et Molière.
DENIS BOISSIER : Pas seulement elles. Le comédien Jodelet a pu consolider leur association, car je ne doute pas que Corneille a été de mèche avec Molière pour le choix de ce farceur enfariné qui entrera dans la troupe en 1659 pour Les Précieuses ridicules.
GD : Qu’a à voir Corneille dans ce choix ?
DENIS BOISSIER : Pierre et Thomas Corneille ont écrit pour Jodelet des comédies au succès retentissant. Et, comme par hasard, ce comédien célébrissime entre en 1659 dans une troupe d’inconnus.
GD : Vous ne croyez pas au hasard…
DENIS BOISSIER : Il est probable que Pierre Corneille a confié à Jodelet qu’il comptait bien, avec Molière, ouvrir le troisième théâtre de Paris, projet qui ne se concrétisera qu’en 1661 mais qui ne pouvait qu’intéresser une vedette comme Jodelet.
GD : D’après vous, c’est aux frères Corneille que Jodelet a fait confiance ?
DENIS BOISSIER : C’est avec eux, qu’il connaissait bien et de longue date, plus qu’avec un comédien arrivé de province, qu’il s’est associé pour faire des Précieuses ridicules le grand succès de l’année 1659.
GD : Voyez-vous d’autres personnalités qui aient pu favoriser leurs relations ?
DENIS BOISSIER : L’écrivain arriviste Donneau de Visé qui fréquentait l’Hôtel du duc de Guise. De Visé devient en 1663 le défenseur de Molière et dans le même temps le défenseur de Pierre Corneille qu’il calomniait jusqu’ici avec une méchante humeur. Cette double amitié simultanée est révélatrice, ne croyez-vous pas ?
GD : Ne peut-on pas imaginer que Donneau de Visé ait rencontré Molière en dehors de Corneille et qu’il ait fait un net cloisonnement entre ces deux amitiés ?
DENIS BOISSIER : S’il y avait eu en 1663 deux camps adverses comme le prétendent les moliéristes, jamais Pierre Corneille ni Thomas n’auraient accepté de fréquenter un allié-collaborateur de Molière. Or Thomas va devenir un grand ami de Donneau de Visé, lequel va toujours rester un proche de Molière et de son épouse Armande avec laquelle, dit la rumeur, il aura une liaison.
GD : Quel labyrinthe, ces coulisses du Palais-Royal !
DENIS BOISSIER : Un labyrinthe dans lequel les « dévots de Molière » ne s’aventurent pas.
GD : Sans doute cela évite-t-il quelque désillusion.
DENIS BOISSIER : C’est certain. Un autre personnage a renforcé les liens unissant Corneille et Molière : le jeune Michel Baron qui fut à partir de 1666 le petit ami de Molière. Armande sera jalouse de lui, le giflera devant la troupe, puis Baron s’éloignera de Molière… Mais Molière et Baron se retrouveront et deviendront les meilleurs amis du monde. En 1673, Baron demandera à Pierre Corneille d’être témoin à son mariage.
GD : En disant que Baron fut le « petit ami » de Molière, ne jouez-vous pas la provocation ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non ! Les contemporains de Molière ont montré du doigt son « penchant détestable ». Ils ont comparé Molière à Socrate, lequel était laid, et Baron au jeune et beau Alcibiade. Voulez-vous plus de détails ?
GD : Revenons, si vous le voulez bien, aux connexions biographiques entre Corneille et Molière qui, dites-vous, sont nombreuses.
DENIS BOISSIER : Et permanentes entre 1658 et 1673, date de la mort de Molière.
GD : Soit durant toute sa carrière parisienne.
DENIS BOISSIER : En effet. Et ce lien professionnel, mais aussi personnel, explique pourquoi Corneille et son frère Thomas s’installent définitivement à Paris dès que Molière obtient du Roi la direction du théâtre du Palais-Royal.
GD : Molière dirige le Palais-Royal en 1661 et les frères Corneille arrivent à Paris en 1662.
DENIS BOISSIER : C’est cela. Pierre Corneille n’avait aucune raison officielle de s’installer à Paris en 1662. D’ailleurs, un corneilliste comme René Guerdan ne s’explique pas pourquoi il a ainsi quitté sa ville natale [« On ne sait ce qui décida Corneille à quitter une ville où il avait vécu cinquante-six ans – en fait, depuis sa naissance. » René Guerdan, Corneille ou la vie méconnue du Shakespeare français, 1984, p. 177]. Corneille avait peu d’argent. Or, Paris était la ville de France la plus chère de France.
GD : Quelles raisons les corneillistes avancent-ils ?
DENIS BOISSIER : Celle qui revient le plus souvent est que Corneille se serait enfin décidé à satisfaire aux exigences de l’Académie française qui voulait que tous ses membres habitent Paris.
GD : Oui, c’est une raison.
DENIS BOISSIER : Le problème est que Corneille a été élu en 1647 et que nous sommes en 1662. Quinze ans pour satisfaire à une exigence, c’est à la fois beaucoup trop et insuffisant pour constituer une explication convaincante. Et comme le remarquait son biographe André Le Gall, Corneille n’avait guère de raison de se montrer aimable envers ceux qui l’avaient par deux fois refusé [« Corneille n’était pas d’un tempérament à prendre aisément son parti de deux échecs publics à l’Académie. », Corneille, en son temps et en son œuvre, 1997, p. 288].
GD : Pour vous, Corneille s’installe à Paris parce que Molière y a désormais son propre théâtre.
DENIS BOISSIER : Oui, même si le Palais-Royal est et restera la propriété du roi. Mais si Corneille consent à abandonner sa tranquillité ce n’est pas seulement pour seconder le richissime Molière. Cette raison à elle seule n’aurait pas suffi à justifier ce qu’il devait considérer comme un grand sacrifice.
GD : Dans ce cas, qu’est-ce qui l’a décidé ?
DENIS BOISSIER : Il faut bien comprendre quel homme est Pierre Corneille. Il est tellement casanier qu’il n’a jamais quitté sa ville natale. Comme je viens de vous le dire, même lorsqu’il s’est présenté à l’Académie française, il a refusé d’habiter à Paris. Et il s’est présenté trois fois ! De plus, c’est un homme discret qui n’aime pas les affrontements directs. Or, Corneille a des ennemis depuis 1637 et ils ont désormais une grande influence, notamment l’abbé d’Aubignac. Et Corneille sait que ses ennemis l’attendent à Paris et sont prêts à se jeter sur lui. Ajoutez à cela que le public applaudit toujours moins à chacune de ses nouvelles tragédies.
GD : Oui, Corneille est passé de mode depuis Pertharite en 1652...
DENIS BOISSIER : … Or, nous sommes en 1662. Il ne peut même plus compter sur son protecteur, le surintendant des Finances Fouquet qui a été arrêté.
GD : Mais il peut compter sur Molière, lequel gagne beaucoup d’argent.
DENIS BOISSIER : La question d’argent, je vous l’accorde, a son importance pour un homme sans protecteur et qui n’exerce plus le métier d’avocat depuis 1652. Mais elle n’explique pas tout. Il faut y ajouter aussi le sens du devoir.
DG : Sentiment très cornélien.
DENIS BOISSIER : Corneille n’a aucune raison de quitter Rouen et de s’installer à Paris sauf qu’à Paris… il y a le roi. C’est LA raison qui a décidé Pierre Corneille. C’est parce qu’il va travailler aux ordres de Louis XIV qu’il se décide à s’établir dans la capitale. Car travailler pour Molière, c’est d’abord œuvrer pour la gloire du roi.
GD : Que Molière soit devenu le bouffon du roi a décidé Corneille à habiter Paris, et non le fait que Molière gagne beaucoup d’argent ?
DENIS BOISSIER : Oui. L’argent, selon ce que je crois savoir du caractère de Corneille, est passé au second plan en cette occasion. Corneille aurait pu fournir en satires nouvelles un Molière régisseur de théâtre tout en habitant Rouen. Mais seconder le bouffon du roi en étant loin de lui, c’est impossible. L’emploi de bouffon du roi est un travail de tous les instants, on agit toujours dans l’urgence. Molière a dû exiger sa présence et l’on peut supposer que le roi la souhaitait aussi afin d’être pleinement satisfait des spectacles de son bouffon. Et à partir de 1662, sitôt Corneille installé près de lui, Molière qui jusqu’ici n’avait rien écrit d’immortel, et qui n’avait rien donné de nouveau pendant toute l’année du déménagement de Corneille, va créer coup sur coup L’Ecole des Femmes, Tartuffe, Dom Juan, Le Misanthrope, Amphitryon, Les Femmes savantes.
GD : Si je comprends bien, Molière seul n’aurait pas suffi à le décider à s’expatrier, mais la volonté du roi l’a convaincu de la nécessité de venir combattre aux côtés de son associé.
DENIS BOISSIER : Associé et patron, car c’est ce qu’était Molière pour Pierre Corneille. Et peut-on refuser à un tel patron ? Et peut-on dire "non" au roi qui est son unique mais si exigeant et si généreux commanditaire ?
GD : Inutile de préciser que tout ceci n’est qu’une spéculation.
DENIS BOISSIER : Oui, comme les moliéristes, j’en suis réduit à faire un « roman ». Le Roman de Molière, c’est ainsi que le moliériste Edouard Fournier a intitulé sa grande étude. Mais ce "roman" que je vous propose, et qui contredit celui des moliéristes, a l’avantage de rendre logique ce qu’eux et les corneillistes n’ont jamais pu expliquer : pourquoi Pierre Corneille s’installe-t-il définitivement à Paris en 1662 ?
GD : Ne peut-on pas supposer que Pierre Corneille se soit décidé à vivre à Paris avant que Molière ne dirige le Palais-Royal ? Il aurait pu, par exemple, vouloir s’y installer dès 1658, quand il monte à Paris en même temps que Molière ?
DENIS BOISSIER : Vu le tempérament de Corneille, il me paraît plus probable que son association avec Molière a connu deux paliers : 1658 puis 1662, et que c’est précisément l’emménagement à Paris qui inaugure la seconde étape. Il faut se replacer dans le contexte. En 1658, Corneille n’a plus donné de pièces depuis sept ans. Il voit dans son association avec Molière l’opportunité d’être régulièrement joué à Paris par la troupe de ce dernier et, cerise sur le gâteau, de gagner sa vie en tant que fournisseur de cette troupe en comédies. Mais en 1662, quand il débarque à Paris, il sait que son emploi exact c’est d’écrire pour Molière les spectacles dont le roi a l’idée ou le désir. Des spectacles qui s’alourdiront très vite d’un substrat politique, ce qui n’est pas pour déplaire à Pierre Corneille dont les tragédies ont toujours été "politiques".
GD : J’aurais cru Corneille trop orgueilleux pour se contenter d’être un « fournisseur », comme vous dites.
DENIS BOISSIER : Vous pensez qu’être fournisseur de troupe est un emploi dégradant ?
GD : Cela n’a rien de prestigieux si votre nom n’apparaît jamais sur une affiche ni en couverture des livres.
DENIS BOISSIER : Vous savez, le nom de Corneille n’apparaît pas non plus sur les éditions de ses premières pièces. Il est d’ailleurs significatif que Corneille appose son nom sur les éditions de ses pièces précisément quand le nom de Molière apparaît en librairie, comme s’il avait voulu clairement scinder sa production. L’œuvre qu’il revendique, c’est celle qu’il signe, et c’est logique. L’autre production, c’est de "l’alimentaire" ou, quand le roi intervient, du "service commandé". Dans les deux cas, il est normal que le nom de Molière seul apparaisse puisque dans un cas, il est régisseur du Palais-Royal et chef de troupe, et dans l’autre, c’est lui seul que le roi légitime.
GD : Ah ! Le bon vouloir du roi !
DENIS BOISSIER : Exactement. Prenez par exemple Psyché [1671]. Bien que cette pièce ait été écrite pour l’essentiel par Corneille, elle paraîtra sous le seul nom de Molière. Les spectateurs n’ont même pas su que Corneille avait participé à ce prestigieux spectacle. Ce n’est pas que Corneille ait été sacrifié, ce n’est pas une injustice, c’est simplement qu’il était au Service du Roi et que le seul nom qui devait apparaître était celui de Louis XIV et, accessoirement, si le roi y consentait, celui de Molière. Ajouter un autre nom eût été crime de lèse-majesté. D’ailleurs, le nom de Molière n’apparaît même pas pour les comédies-ballets auquel le comédien metteur en scène participe.
GD : Pourquoi ?
DENIS BOISSIER : Pour la bonne raison qu’il ne peut y avoir qu’un seul auteur pour les spectacles royaux : le roi. Et puisque nous parlons de ballets, savez-vous quelle est, à mon sens, l’une des meilleures preuves, quoique indirecte, que nous ayons de la collaboration Corneille-Molière et du fait qu’elle soit demeurée si discrète ?
GD : Je préfère vous laisser répondre…
DENIS BOISSIER : Le 20 septembre 1672 Lully, musicien-danseur et baladin qui vient de prendre auprès du roi la place qu’occupait Molière, obtient de Louis XIV le privilège que Molière, directeur de troupe, a sur les auteurs de théâtre. De la même façon que la mise en scène l’emporte sur le texte, la musique l’emportera désormais sur le texte. Par volonté du roi, Lully peut faire publier comme siens les textes qui accompagnent ses partitions. Autrement dit, le nouveau bouffon du roi s’arroge le même privilège que son confrère déchu : tout ce qu’autrui fait pour moi m’appartient.
GD : Mais c’est de l’abus de pouvoir !
DENIS BOISSIER : C’est simplement la pratique éditoriale, propre au bon vouloir de Louis XIV, qui nous fait croire aujourd’hui à l’"œuvre" de Molière.
GD : Cela s’est passé en 1672 ?
DENIS BOISSIER : Oui. A cette époque, Louis XIV s’est déjà détourné de Molière. Il n’a d’yeux que pour Lully, lequel a toujours été un musicien doublé d’un bouffon. Sur ce point, les témoignages sont unanimes.
GD : Et les biographes de Lully sont d’accord avec vous et les témoignages ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr, tant qu’il ne s’agit pas de Molière tout le monde peut être bouffon du roi ! Pour son biographe Jean Gallois, Lully est un « bouffon » au même titre que Molière [Lully « s’installe d’emblée dans la farce : c’est bien le baladin tel que l’ont défini la Grande Mademoiselle et les dictionnaires du temps. Tout comme Molière à la même époque. Sa première apparition devant le public français sera donc celle d’un bouffon. », Jean-Baptiste Lully ou la naissance de la Tragédie Lyrique, 2001, p. 25]. Pour son dernier biographe Philippe Beaussant, Lully est, comme Molière, un « mime » [« Lully est danseur d’abord ; un homme des planches d’abord, homme des tréteaux, homme de théâtre. D’abord un mime. », Lully ou le musicien du soleil, 1992, p. 85].
GD : Louis XIV a donc deux bouffons !
DENIS BOISSIER : Et même trois ! Car il a aussi le bouffon à titre d’office L’Angely, mais oublions L’Angely puisqu’il ne joue aucun rôle social ou politique. Grâce au roi, Lully agit comme son ancien rival. Comme l’écrit Georges Couton, « une pièce de Molière dont Lully ferait la musique serait désormais la propriété de Lully. » [dans Molière, Œuvres complètes, 1971, T. I, p. LV].
GD : Si je comprends bien, Molière est devenu, malgré lui, le "Corneille" de Lully.
DENIS BOISSIER : On peut voir les choses ainsi, bien que le "Corneille" de Lully soit Philippe Quinault. La meilleure preuve, bien qu’indirecte, de la collaboration Corneille-Molière, c’est celle-ci : par la volonté de Louis XIV, le musicien d’un spectacle a préséance sur le metteur en scène qui a préséance sur l’auteur de la pièce.
GD : En d’autres termes Lully a préséance sur Molière qui avait préséance sur tous les écrivains travaillant pour lui.
DENIS BOISSIER : Exactement. Toute l’Affaire Corneille-Molière tient dans ce fait historique. Un fait historique qui n’a dépendu que du bon vouloir de Sa Majesté. Dans ces conditions, croire en Molière "auteur" relève plus de la foi que de l’Histoire.
GD : Tout de même, Corneille méritait mieux que d’être le collaborateur anonyme d’un comédien, même si ce comédien est Molière.
DENIS BOISSIER : Vous pensez en homme du XXIe siècle. Corneille, lui, était de son temps. Et au XVIIe siècle l’auteur n’est rien, à moins de triompher dans la tragédie et séduire ainsi la Cour. Car en dehors de la tragédie, il n’y a pas de carrière honorable – c’est d’ailleurs dans ce domaine que Corneille avait connu ses plus grands triomphes – mais sa gloire était passée... Que faire ?
GD : S’associer, à contrecœur…
DENIS BOISSIER : Pourquoi « à contrecœur » ? Madeleine Béjart, Molière et leurs compagnons aiment ses pièces et ils sont charmants avec lui.
GD : Surtout Marquise du Parc !
DENIS BOISSIER : Si vous voulez… Au moins, avec Molière, Corneille sait qu’il pourra écrire des comédies, et même des satires car la troupe s’est spécialisée dans ce registre. Comme je vous l’ai dit, elle continue la longue lignée des Enfants-sans-souci qui, durant tout les XVe et XVIe siècles et le début du XVIIe, avaient pour seule ambition de réagir aux scandales et de critiquer les mœurs.
GD : Ce qui n’est pas pour déplaire à Corneille, l’homme des plaidoyers et des réquisitoires.
DENIS BOISSIER : Exactement. Le Prince des Sots, qui assume fréquemment la fonction de bouffon du roi, était le chef des Enfants-sans-souci. Et, que fera Molière en devenant bouffon du roi ? Il sera à sa manière, disons plus moderne, le Prince des Sots ou, si vous préférez car c’est le même personnage, le Prince des Cocus, le rôle que Molière-Sganarelle jouera le plus souvent.
GD : Pour ma part, j’admets sans difficulté que Corneille ait pu juger que Molière était le seul moyen de continuer à gagner sa vie au théâtre. Pourtant si Fouquet n’avait pas été injustement condamné par Louis XIV, Corneille aurait peut-être pu relancer sa carrière d’auteur de tragédies et se dispenser de s’associer avec un comédien.
DENIS BOISSIER : Que croyez-vous ? Corneille a essayé de faire son come back sans Molière, mais il a échoué. En 1663, il a même proposé à Louis XIV d’être son poète officiel [cf. son « Remerciement au Roi »], mais le roi n’avait pas besoin d’un poète qui vante sa gloire – il en avait déjà suffisamment. Ce dont il avait besoin c’est d’un bouffon qui ait l’oreille le peuple. Et pour ce rôle il avait Molière. De plus, même s’il ne s’était pas associé avec Molière en 1658, Corneille se serait retrouvé tôt ou tard, comme Saint-Aignan ou Benserade, à travailler avec Molière afin que celui-ci puisse présenter à la Cour des divertissements de qualité.
GD : Vous pensez donc qu’en travaillant pour Molière sur Les Précieuses ridicules Corneille ne s’est jamais dit qu’il déméritait ?
DENIS BOISSIER : Il ne pouvait pas penser cela, pour la bonne raison qu’il suivait les traces de ses deux modèles littéraires : Alexandre Hardy et Rotrou. Eux aussi ont écrit de très nombreuses farces et comédies qu’ils n’ont jamais signées parce qu’elles leur auraient fermé les portes de la gloire.
GD : Vous pensez donc que c’est parce que Corneille espérait que la troupe de Béjart et de Molière pourrait ouvrir, grâce à lui, le troisième théâtre de la capitale qu’il monta à Paris en octobre 1658 avec Molière ?
DENIS BOISSIER : Oui, Corneille connaissait bien la reine mère et espérait qu’elle aiderait Molière à rencontrer le roi. Ce qui fut le cas. N’oubliez pas que Molière se présenta en 1658 comme l’interprète de Corneille. Devant le roi, sa troupe ne jouera que du Corneille. Comme l’a écrit Georges Couton, Molière veut être « l’interprète de Corneille, voire s’imposer à Corneille comme son interprète » [dans Molière, Œuvres complètes, 1971, T. 1, p. XXVII].
GD : De la part d’un moliériste si réputé un tel aveu doit vous faire plaisir.
DENIS BOISSIER : En effet, c’est si rare… Mais l’on ne fait pas assez attention à un fait historique tout aussi significatif : en 1658, les auteurs à succès sont Philippe Quinault ou Thomas Corneille, pas le "démodé" Pierre Corneille. Or, Molière et sa troupe ne jouent que du Pierre Corneille. C’est une façon typiquement théâtrale de dire qui est derrière eux.
GD : Et comment les moliéristes expliquent-ils cette volonté de ne jouer que du Corneille, alors qu’il est passé de mode ?
DENIS BOISSIER : Ils constatent cette volonté mais ne l’expliquent pas. Pour eux, il n’y a pas de lien entre Molière et Corneille.
GD : L’un et l’autre viennent pourtant de vivre ensemble à Rouen pendant plusieurs mois.
DENIS BOISSIER : Ils préfèrent ne pas évoquer ce séjour.
GD : Mais Corneille et Molière sont montés à Paris en octobre 1658.
DENIS BOISSIER : Ils préfèrent aussi ne pas parler de ce voyage.
GD : Mais ne sont-il pas obligés d’en parler ?
DENIS BOISSIER : Non, pourquoi ? Un biographe officiel de Molière n’a qu’à parler de Molière. Il lui suffit de dire que Molière monte à Paris en octobre 1658. De son côté, un corneilliste n’a qu’à écrire que Corneille monte à Paris en octobre 1658. A ma connaissance, aucun universitaire n’a jamais été assez téméraire pour écrire que les deux hommes, après avoir passé six mois à se fréquenter, sont montés ensemble à Paris et seront ensemble devant le roi lorsque la troupe jouera exclusivement du Pierre Corneille. Notons aussi que le comédien tragique Floridor, le grand ami de Corneille, sera présent.
GD : Il y a donc un cloisonnement entre les deux biographies.
DENIS BOISSIER : Et grâce à ce cloisonnement parfaitement étanche on fait l’économie de l’Affaire Corneille-Molière !
GD : Ce n’est pourtant pas un hasard si Molière ne joue que du Corneille devant le roi.
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non ! D’autant qu’en ne jouant que du Pierre Corneille, Molière met en pratique la signification même de son nom de théâtre. Car il est probable que le pseudonyme "Moliere" vient du verbe molierer, utilisé dans le nord de la France pendant le XVe et XVIe siècles, qui signifie légitimer [Frédéric Godefroy, Le Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècles, 1888, Tome V, p. 374] Un cultivateur pouvait molierer une terre, un roi pouvait molierer une femme qui vivait avec un homme. Tout autorisait donc le grand auteur Corneille à molierer le jeune comédien Jean-Baptiste Poquelin, d’autant que nous savons que Poquelin a utilisé ce pseudonyme pour la première fois en 1644, juste après son premier séjour de six mois à Rouen. En 1658, il est toujours, et plus que jamais, le moliere, le légitime, de Corneille…
GD : Qu’en pensent les moliéristes ?
DENIS BOISSIER : Ils ne s’intéressent pas de savoir pourquoi, comme l’indique son premier biographe Grimarest, Molière n’a jamais voulu s’expliquer, même à ses amis, sur l’origine et la signification de son nom de théâtre. Pour Georges Mongrédien, « l’essentiel n’est pas l’origine du nom de Molière, mais le haut point de gloire où Jean-Baptiste Poquelin l’a porté. » [La vie privée de Molière, 1950, p. 47]. Georges Forestier, lui, trouve que s’interroger sur la signification du nom « Moliere » est une « question tendancieuse ».
GD : Je vois.
DENIS BOISSIER : Voilà comment les « dévots de Molière » esquivent en général tous les problèmes, et celui-ci en particulier.
GD : Quoi que signifie ce pseudonyme, quel triomphe pour un jeune comédien inconnu, une troupe de province et un écrivain passé de mode de pouvoir approcher Louis XIV!
DENIS BOISSIER : Ni Corneille ni Molière ne pouvaient prévoir un si extraordinaire avenir à leur association. Comme auraient-ils pu imaginer que le très jeune Louis XIV choisirait Molière pour bouffon du roi ? Car Louis XIV moliere Poquelin comme Corneille l’avait lui-même molieré.
GD : En quelque sorte, Poquelin est doublement Moliere. Vous pensez que Louis XIV a fait ce choix dès qu’il a rencontré Molière ?
DENIS BOISSIER : Pourquoi pas ? Une chose est sûre, ce qui a décidé Louis XIV à prendre Molière, c’est de l’avoir vu faire le pitre dans une farce gauloise. Car Molière dans Nicomède de Corneille a ennuyé le jeune roi, mais celui-ci a beaucoup ri pendant Le Docteur amoureux.
GD : Dommage que cette farce soit aujourd’hui perdue...
DENIS BOISSIER : Détrompez-vous. En 1960 un moliériste a retrouvé Le Docteur amoureux dans une édition où il était avec deux autres comédies signées Molière [Le Mariage forcé et L’Amour médecin]. La première question que l’on s’est posée, bien sûr, fut de savoir si c’était bien Le Docteur amoureux que Molière avait joué devant le roi. Les spécialistes en furent vite convaincus. D’abord, nous ne connaissons pas d’autre Docteur amoureux pouvant correspondre à celui de Molière, ensuite celui-ci ne comporte qu’un acte, enfin certaines spécificités typographiques montrent que cette édition date de la fin du XVIIe siècle. A ces paramètres s’ajoutent plusieurs indices philologiques, aussi le fait que le personnage de Pancrace du Docteur amoureux se retrouvera dans Le Mariage forcé [1664], et que certaines répliques ou expressions réapparaîtront dans d’autres comédies moliéresques.
GD : Dans ce cas, pourquoi ne trouve-t-on pas Le Docteur amoureux dans les Œuvres complètes de Molière ?
DENIS BOISSIER : Les moliéristes n’en veulent pas.
GD : Pourquoi ?
DENIS BOISSIER : Ils l’avaient ajouté au corpus moliéresque lorsqu’un autre spécialiste découvrit que Le Docteur amoureux était à quatre-vingt-quinze pour cent le plagiat d’une pièce en cinq actes intitulée Le Déniaisé, écrite par un confrère rouennais de Corneille et publiée en 1648. Comme l’auteur du Docteur amoureux était un plagiaire, plus question que le Docteur amoureux retrouvé soit de Molière.
GD : Evidemment…
DENIS BOISSIER : Comme l’écrit Charles Mazouer, « l’hypothèse n’est pas admissible ».
GD : Et pourquoi juge-t-il l’hypothèse inadmissible ?
DENIS BOISSIER : Pour l’excellente raison, je le cite, qu’«il est invraisemblable que Molière ait commencé sa carrière devant le roi par une imposture. » [Farces du Grand Siècle, de Tabarin à Molière, farces et comédies du XVIIe siècle, 1992, p. 189].
GD : Je me doute que c’est précisément le fait que cette pièce soit un plagiat qui, pour vous, est un indice sérieux qu’il s’agit bien de la farce que Molière a jouée devant le roi.
DENIS BOISSIER : En effet, l’auteur du Déniaisé, Gillet de La Tessonnerie, était un auteur rouennais connu de Pierre et Thomas Corneille. Cet auteur, qui venait peut-être de mourir en 1658, avait connu le succès au Théâtre du Marais avec sa comédie Le Campagnard (1657) dont le personnage du valet était joué par le célèbre farceur Jodelet.
GD : …Celui dont vous me parliez à l’instant…
DENIS BOISSIER : Oui…Or, avant de jouer devant le Roi Le Docteur amoureux, Molière et sa troupe ont longuement fréquenté les frères Corneille, et Le Déniaisé venait, comme par hasard, d’être réimprimé à Rouen en 1658.
GD : Comme je sais que vous ne croyez pas au hasard en ce qui concerne Molière, je suppose que vous en avez déduit que la troupe a adapté cette pièce pour en faire une farce.
DENIS BOISSIER : Molière pouvait d’autant plus utiliser Le Déniaisé que cette comédie avait été publiée sans nom d’auteur, et qu’on ignore si elle avait été représentée. Je pense en effet que la Troupe a vu là une opportunité.
GD : Qui selon vous a adapté Le Déniaisé ?
DENIS BOISSIER : Le Déniaisé avait déjà été publié en 1648 et en 1652 par Thomas Quinet, l’éditeur des frères Corneille. Ces derniers connaissaient donc cette comédie. Au vu de ces éléments, il est probable que cette adaptation a été une entreprise collégiale, un amusement de toute la troupe réunie chez les Corneille, comme le sera, dans les mêmes conditions, l’élaboration des Précieuses ridicules.
GD : Les liens se sont donc tissés autour de ces deux farces.
DENIS BOISSIER : Oui, comme il est presque certain que Pierre Corneille a retravaillé la versification de L’Etourdi et du Dépit amoureux, les deux comédies que la Troupe représentera devant les Parisiens juste avant Les Précieuses ridicules. Ces deux pièces plagient elles aussi des œuvres italiennes à la fois plus complexes et plus longues.
GD : Molière a donc commencé sa carrière comme… disons "adaptateur".
DENIS BOISSIER : C’est le qualificatif le plus aimable que vous pourrez trouver… car sa quatrième pièce, Le Cocu imaginaire [1660], est également une comédie dont un dénommé Neufvillaine semble être l’auteur, en tout cas, il se comporte comme tel dans la préface de l’édition qu’il publie sous son nom.
GD : Molière aurait été le prête-nom de ce Neufvillaine ?
DENIS BOISSIER : Je le crois. Car il est tout de même curieux que Neufvillaine ait publié une édition plus correcte que celle de la troupe de Molière. C’est d’ailleurs l’édition de Neufvillaine que les moliéristes ont choisie pour la postérité… La question qui se pose est : pourquoi Molière n’a-t-il pas pu se procurer une édition correcte de sa pièce ? N’est-il pas mieux placé que Neufvillaine ? Il semble que non.
GD : Une autre question se pose : pourquoi Neufvillaine a-t-il publié la pièce sous son nom ?
DENIS BOISSIER : Sans doute à cause du succès inattendu du Cocu imaginaire. Il est probable que Neufvillaine a voulu avoir sa part du gâteau. Il dit dans la préface de son édition qu’il laisse volontiers à Molière les bénéfices des représentations mais veut l’argent de la publication.
GD : Et Molière comment réagit-il ?
DENIS BOISSIER : Il lui intente un procès, mais les deux hommes s’arrangent et Molière publie sous son nom le texte même de l’édition de Neufvillaine ainsi que les longs arguments/commentaires de ce dernier.
GD : Il a gardé les commentaires de Neufvillaine ? C’est contradictoire !
DENIS BOISSIER : Vous êtes aussi surpris que le moliérâtre Paul Lacroix [« Pourquoi Molière conservait-il les arguments dont il n’était pas l’auteur ? », Bibliographie moliéresque, 1875, p. 6]. L’explication est toute simple : puisque Molière n’est l’auteur ni de la pièce ni des arguments, il pouvait sans contradiction s’approprier l’ensemble.
GD : Autrement dit, ce sont des arrangements de coulisses…
DENIS BOISSIER : Oui, ce que Roger Duchêne appelle, avec un point d’interrogation superflu : « Des pirateries concertées ? » [Molière, 1998, p. 250]. Et c’est à peu près ce qui s’est aussi passée avec la farce du Médecin volant.
GD : Encore une autre « piraterie concertée » ?
DENIS BOISSIER : Je le crains… Le Médecin volant a été joué devant le roi en avril 1659 et représenté en public l’année d’après. Mais voici que l’Hôtel de Bourgogne joue la même pièce, mais en alexandrins alors que celle de Molière est en prose. L’auteur en est le jeune Edme Boursault.
GD : Dans nos précédents dialogues, vous l’avez cité comme l’un des collaborateurs potentiels de Molière.
DENIS BOISSIER : Oui, c’est bien le même Boursault. Mais ici, ce sont ses débuts littéraires. Et, pour la majorité des moliéristes, Boursault a démarqué la pièce de Molière. Mais Boursault a-t-il plagié Le Médecin volant, comme l’exige le dogme, ou a-t-il simplement versifié l’adaptation en prose qu’il a vendue à Molière ?
GD : Comment le savoir ?
DENIS BOISSIER : En étudiant le contexte. Boursault, qui à cette date est âgé de dix-neuf ans, est un familier de Pierre Corneille. Or, Molière crée Le Médecin volant en 1659, après avoir passé six mois avec Corneille. Il a donc pu être présenté à Boursault qui, au fil d’une discussion, lui aura proposé son adaptation en prose de la pièce italienne. Mais ensuite, devant les applaudissements que la pièce reçoit, Boursault aura voulu profiter d’un succès auquel il a largement contribué.
GD : Comme Neufvillaine pour Sganarelle ou le Cocu imaginaire…
DENIS BOISSIER : Exactement. Et Boursault a publié sous son nom sa version, mais en la versifiant, ce qui est logique pour un jeune écrivain en quête de gloire.
GD: Tout à fait. Molière lui a-t-il fait un procès comme à Neufvillaine ?
DENIS BOISSIER : Inutile. Comme ils ont Pierre Corneille comme point d’entente, les deux hommes parviennent vite à un arrangement, d’autant qu’en affaires Molière a un caractère très conciliant. Il s’associera même avec Jean Ribou, un « pirate de l’édition », comme le définit Georges Couton, celui-là même qui pendant des années a édité des contrefaçons de pièces moliéresques.
GD : Le moins que l’on puisse dire, c’est que la carrière de Molière est remplie d’étrangetés et même d’obscurités.
DENIS BOISSIER : Oui, c’est une vie de coulisses.
GD : Revenons aux Précieuses ridicules. Vous dites que dès cette époque, c’est-à-dire 1659, le roi a agréé Molière et sa troupe. Louis XIV avait-il déjà pris la décision de faire de lui son amuseur fétiche ?
DENIS BOISSIER : Peut-être bien. En tout cas, le contexte s’y prêtait. Louis XIV s’oppose au parti dévot dirigé par la reine mère. Ce parti dévot est contrôlé par la Compagnie du Saint-Sacrement. Il existe un autre parti : celui des Précieuses et des marquis. Que fait Louis XIV ? Il permet aux Précieuses ridicules d’être jouées malgré une interdiction de représentation. La route de Molière est déjà toute tracée : il aura à combattre les deux partis : celui des dévots et celui des Précieuses.
GD : Deux partis qui avaient souvent les mêmes partisans !
DENIS BOISSIER : Louis XIV a-t-il su ce qu’il allait faire de Molière dès 1659 ? Ce qui est sûr, c’est qu’en 1660 il paie Molière en prenant 500 livres tournois sur les fonds de l’Epargne. Le document précise bien que Molière est à Paris à cause du roi [« par son commandement pour le plaisir et la récréation de Sa dite Majesté »]. Et ce qui est avéré, c’est qu’en 1661 Louis XIV lui offre la gérance du Palais-Royal.
GD : Il semble évident que Molière appartient officieusement au roi.
DENIS BOISSIER : Et il lui appartiendra officiellement quand Louis XIV fera de Molière et de ses compagnons les « comédiens du Roi » en juin 1665.
GD : En plein scandale du Tartuffe !
DENIS BOISSIER : Oui, ce choix, cette décision et cette date sont significatifs.
GD : Il semble que Corneille ait eu un flair extraordinaire en choisissant Molière !
DENIS BOISSIER : Il n’a pas réellement choisi Molière. En fait, c’est la troupe qui choisi Corneille comme fournisseur en raison de ses étonnantes capacités professionnelles. Mais c’est vrai qu’il a eu raison d’écouter leurs projets ambitieux… Et quand le roi donne la gérance du Palais-Royal à Molière, c’est pour Corneille la certitude que s’ouvre une seconde carrière.
GD : On peut donc dire que c’est la fonction de bouffon du roi qui a sauvé et Molière et Corneille.
DENIS BOISSIER : A l’évidence car, comme nous l’avons vu, il s’agit bien de l’« emploi » que Sa Majesté réserve à Molière. A la fois une fonction honorifique et… une malédiction sociale.
GD : Cependant rien n’atteste que Louis XIV ait condamné Molière à n’être que son bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Au contraire, tout l’atteste. Dès le départ, Louis XIV cantonne Molière dans la farce. Lorsqu’il lui offre le Palais-Royal, c’est à la condition qu’il en partagera la scène avec son autre bouffon, l’Italien Scaramouche. Il faut rappeler que lorsqu’il était enfant, Louis XIV avait pour amuseur attitré le célèbre Scaramouche, lequel lui a d’ailleurs appris à jouer de la guitare. Et devenu monarque absolu, le jeune Louis XIV choisit Molière, tout cela est parfaitement cohérent.
GD : Pourquoi précisément Molière ?
DENIS BOISSIER : Parce que, à la différence de Scaramouche, Molière parle français. C’est une condition sine qua non pour la fonction de bouffon du roi de France. Et puis Molière a une troupe toute prête. Et il lui a été présentée par la reine mère et Pierre Corneille.
GD : Mais quel intérêt pour Louis XIV de prendre un bouffon ?
DENIS BOISSIER : Traditionnellement il n’y a jamais eu en France de grand roi sans un grand bouffon à ses côtés. Le bouffon du roi était consubstantiel au roi. A tel point qu’à la mort de son bouffon, le roi devait immédiatement en prendre un autre. De plus, pour contrebalancer l’autorité de sa mère et l’influence de son parti, rien de plus efficace que d’utiliser le rire subversif d’un bouffon, lequel entraînera le rire du peuple et des petits bourgeois. Car Louis XIV a besoin du peuple et des bourgeois pour lutter contre la noblesse qu’il redoute depuis l’époque de la Fronde.
GD : Et Corneille dans toute cette stratégie ?
DENIS BOISSIER : Etre près du Roi, même si c’est en coulisses, gagner beaucoup d’argent et pouvoir dire à ses nombreux détracteurs tout ce qu’il a dû leur taire si longtemps, ne pouvait que tenter celui qui avait commencé sa carrière comme poète comique et comme basochien.
GD : Rappelez-moi ce qu’est un basochien.
DENIS BOISSIER : Un basochien, c’est un auteur de théâtre, généralement un bourgeois ayant fait du droit, qui utilise l’actualité pour ridiculiser les travers de ses contemporains. Au Moyen Age les auteurs de la Basoche, presque toujours anonymes, régnaient sur le théâtre populaire français. Au XVIe siècle la Basoche pour donner ses lettres de noblesse à la sotie s’était associée avec les Enfants-sans-souci, autrement dit les comédiens des Halles de Paris.
GD : La sotie, c’est l’ancêtre de la satire…
DENIS BOISSIER : Oui…la sotie était une arme politique. Et c’est d’ailleurs pour cela que le bouffon du roi jouait des soties… Dans ces occasions-là, le bouffon du roi était appelé le Roi des Sots, c’est-à-dire le Roi des Cocus, lequel avec Molière s’est appelé Sganarelle. Ajoutons que le Roi des Sots était le chef des Enfants-sans-souci. Et que Molière et sa troupe, comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, sont les derniers Enfants-sans-souci…
GD : Pourquoi les derniers ?
DENIS BOISSIER : La société des Enfants-sans-souci sera abolie par ordre de Louis XIV en 1676, soit trois ans après la mort de Molière.
GD : Pour quelle raison ?
DENIS BOISSIER : Fatigués de la bouffonnerie, Louis XIV, Colbert et Louvois (plus encore que Colbert) aspiraient à plus de dignité.
GD : Il y a donc un lien direct entre le Roi des Sots et… Molière.
DENIS BOISSIER : Oui. Comme il y a un lien direct entre La Basoche, la sotie et Pierre Corneille. Car Rouen était la grande ville des soties et des satires, et l’avocat Corneille fut initié à la célèbre Basoche de la Table de marbre.
GD : Alors Corneille et Molière, en s’associant, ont continué une alliance vieille de plusieurs siècles.
DENIS BOISSIER : Et c’est pourquoi leur première pièce, Les Précieuses ridicules, est une sotie-satire. Les Enfants-sans-souci avaient pour habitude de se mettre en scène sous leurs véritables noms et de se livrer à la moquerie du public, ce que feront Molière et ses compagnons, non seulement dans Les Précieuses ridicules mais aussi dans L’Impromptu de Versailles.
GD : A votre avis, qui a eu l’idée des Précieuses ridicules ?
DENIS BOISSIER : C’est collégialement que la Troupe a mis au point Les Précieuses ridicules. Elle a pris l’idée générale de la pièce à l’abbé de Pure, ce grand ami de Pierre Corneille dont nous avons parlé. On sait que durant le séjour de la Troupe à Rouen, Pierre et Thomas Corneille lisaient La Précieuse de leur ami de Pure. Même pour le moliériste Roger Duchêne « la coïncidence est frappante » [Molière, 1998, p. 228]. Corneille connaissait bien ces intellectuelles que l’on appelait Précieuses alors que Molière ne les avait jamais fréquentées. Corneille avait des comptes à régler avec elles depuis Polyeucte [1642], pas Molière. Si Corneille s’est finalement décidé à s’installer à Paris c’est aussi pour régler ses comptes avec tous ceux et celles qui lui ont gâché sa carrière.
GD : Pour vous, il ne fait aucun doute que Corneille s’est installé à Paris parce que Louis XIV avait fait de Molière son bouffon. Mais pour les moliéristes, c’est le succès de sa tragédie Œdipe qui a décidé Corneille à s’installer à Paris.
DENIS BOISSIER : Le succès d’Œdipe date de 1659, et Corneille s’installe à Paris en 1662. En 1662 Sertorius ne fut pas un succès. Croyez-vous qu’un stratège comme Corneille, avant de s’installer définitivement à Paris, n’aurait pas attendu de vérifier si le succès d’Œdipe n’était pas davantage dû à la personnalité de son commanditaire, le Surintendant Fouquet, qu’à son propre talent ? Selon vous, Corneille aurait tout quitté sans savoir si ce retour d’engouement des Parisiens pour ses tragédies se confirmerait avec Sertorius ?
GD : Non, en effet, j’en doute. Corneille était un homme très réfléchi. Et même l’incroyable succès du Cid n’a pas réussi à lui faire perdre la tête.
DENIS BOISSIER : Depuis 1652 la carrière de Corneille est sur la mauvaise pente. D’ailleurs plus personne ne lui commandera de nouvelle tragédie et chacune de ses œuvres ultérieures connaîtra l’échec. De plus, les moliéristes oublient de dire qu’en 1662 on est en plein procès Fouquet et que l’auteur d’Œdipe est celui qui a le plus touché de cet argent que le Surintendant des finances a détourné pour ses plaisirs. Ce n’était vraiment pas le moment pour Corneille de s’installer à Paris.
GD : Parce qu’il avait tout à craindre de la police du roi ?
DENIS BOISSIER : Oui, comme tous ceux qui avaient été en affaires avec Fouquet. On perquisitionnait partout et l’on arrêtait ceux qui avaient des rapports d’argent avec Fouquet.
GD : Il fallait donc une force majeure pour décider Corneille à faire le grand saut.
DENIS BOISSIER : Exactement. Et quelle peut être à votre avis cette force majeure pour un misanthrope casanier qui adore son roi ?
GD : Que le roi lui ait demandé de venir à Paris seconder Molière.
DENIS BOISSIER : Gagné ! Seul le roi pouvait obtenir ce "sacrifice" de la part de Corneille. Ainsi que je vous le disais, même lorsque l’Académie française a exigé sa présence avant de l’élire, Corneille a préféré rester dans sa ville natale.
GD : Fichu caractère !
DENIS BOISSIER : C’est évident. Mais s’il pouvait dire non à ses confrères, même à quarante immortels, il ne pouvait pas mécontenter le roi.
GD : Vous pensez que Corneille a reçu de Louis XIV l’assurance qu’il n’aurait rien à craindre de sa colère envers Fouquet ?
DENIS BOISSIER : Par l’entremise de Molière, certainement. Et, en effet, Corneille ne fut pas inquiété à Paris.
GD : Il a donc fait le bon choix.
DENIS BOISSIER : Il s’est offert une nouvelle carrière, une sorte de retour aux sources.
GD : Pourquoi un retour aux sources ?
DENIS BOISSIER : On oublie trop que Corneille durant toute la première partie de sa longue carrière a été un satiriste. Il n’a jamais cessé de s’opposer aux institutions rigides et aux officiels pontifiants. En bon basochien, il est même allé jusqu’à se moquer de l’auteur vénéré du Cid.
GD : Corneille s’est moqué de lui-même ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Pendant qu’il travaille au Cid, il écrit L’Illusion comique [1635] dans laquelle le ridicule Matamore parle exactement comme Rodrigue. Corneille n’était pas dupe de la magie de son style et il n’a jamais cessé de porter un regard lucide sur ses œuvres. Le corneilliste André Le Gall écrit qu’il « a une capacité autocritique qui relève du dédoublement » [Corneille, en son temps et en son œuvre, 1997, p. 369], et il constate aussi que Corneille ne partage cette capacité avec aucun autre écrivain français. C’est grâce à cette capacité de dédoublement que l’auteur du Menteur va pouvoir écrire sous le masque de Molière. Il va retrouver la verve et la causticité de ses débuts lorsqu’il avait pour seule ambition d’être un auteur comique.
GD : On imagine mal Corneille « auteur comique ».
DENIS BOISSIER : C’est pourtant ainsi que ses contemporains l’ont d’abord défini. Lui-même écrit à son ami Zuylichem qu’il a longtemps cru « le rire indispensable au théâtre ».
GD : Quand écrit-il cela ?
DENIS BOISSIER : En 1650. Huit ans avant de s’associer définitivement avec Molière.
GD : Il était donc prêt pour seconder Molière.
DENIS BOISSIER : Corneille est un basochien. Il aime la chicane. Il est agitateur dans l’âme. Ce n’est qu’à cause du succès du Cid qu’il est devenu la « gloire de la France », ce qui a eu pour effet de le contraindre à rentrer ses griffes et à n’écrire que des tragédies. Molière et sa troupe font irruption dans sa vie au moment où ses tragédies n’intéressent presque plus personne, au moment où il commence à n’avoir plus assez d’argent pour entretenir sa nombreuse famille. Comment aurait-il pu dire non à des comédiens qui veulent ouvrir le troisième théâtre de Paris et qui désirent, par dessus tout, mettre en scène son œuvre ? Bien sûr qu’il s’est associé ! Madeleine Béjart est charmante, Marquise du Parc est adorable et « Moliere » est fier d’être son légitime depuis déjà quinze ans, même si, jusqu’à présent, ce titre n’a été qu’honorifique.
GD : Mais dès 1661, grâce au roi, Molière va promouvoir le théâtre de Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Exactement. Régisseur du troisième grand théâtre de la capitale, Molière représentera onze pièces de Pierre et Thomas Corneille que les moliéristes prétendent avoir été ses « ennemis ».
GD : Pierre Corneille est l’auteur que Molière interprètera le plus ?
DENIS BOISSIER : Oui, et il l’aurait joué bien davantage s’il n’avait pas été si médiocre dans la tragédie. Corneille est sa référence. D’ailleurs, quelle nouvelle grande pièce choisit Molière pour inaugurer le Palais-Royal ? Une comédie ? Non : une pièce noble. C’est avec la tragi-comédie Dom Garcie de Navarre que Molière espère triompher comme porte-voix de Corneille.
GD : Dans ce cas, pourquoi Molière n’a-t-il pas choisi une pièce de Corneille ?
DENIS BOISSIER : Mais c’en est une ! Dom Garcie de Navarre est une tragi-comédie de Corneille, qui date sensiblement de 1650, et que son auteur n’a pas donnée à l’Hôtel de Bourgogne sans doute parce que sa tragi-comédie précédente, Dom Sanche d’Aragon, a échoué, ou bien Corneille aura jugé que Dom Garcie ne valait pas Dom Sanche et il l’aura laissée dans un tiroir. Car il faut bien se rendre compte, ce que ne font jamais mes contradicteurs, qu’un auteur aussi prolifique que Corneille a nécessairement dans ses papiers des pièces en chantier, des pièces pas assez abouties pour être portées à la scène. Que sont devenues ces pièces ? Mystère. Mais il est probable que certaines ont été recyclées, réaménagées au gré des circonstances.
GD : Oui, cela paraît logique. Et puis l’on peut supposer qu’un excellent homme d’affaires comme lui devait mal supporter que son travail, même imparfait, ne lui rapporte pas la satisfaction de n’avoir pas perdu son temps.
DENIS BOISSIER : Comme fait exprès, toutes les grandes pièces de Molière seront des tragi-comédies. Je ne crois pas que cela soit un hasard.
GD : Donc Molière prend une tragi-comédie de Corneille pour inaugurer le Palais-Royal.
DENIS BOISSIER : Oui, j’ai la conviction qu’il a convaincu Pierre Corneille de lui laisser créer Dom Garcie de Navarre. Molière veut triompher dans une pièce noble, tous les moliéristes sont d’accord sur ce point.
GD : Mais Dom Garcie échoue !
DENIS BOISSIER : A l’évidence Molière est mauvais quand il joue des pièces nobles. Il n’est excellent que pour les pitreries. Avec l’échec de Dom Garcie, il comprend ce que ses camarades ont sans doute compris avant lui : il ne sera jamais le prête-voix de Corneille.
GD : Pourquoi dites-vous que sa troupe a compris cela avant lui ?
DENIS BOISSIER : Parce qu’elle a préféré débuter sa carrière parisienne avec uniquement des farces ou des satires. En 1661, Molière comprend qu’il ne sera jamais le porte-voix de Corneille, seulement son prête-nom.
GD : Triste consolation… Mais qu’est-ce qui vous fait être si sûr que Dom Garcie de Navarre est une pièce de Corneille ?
DENIS BOISSIER : Parce que cette pièce atteste du style précieux des années 1630-1640, un style passé de mode en 1661, mais que Corneille a souvent manié. Parce que l’on ne jouait plus des tragi-comédies depuis près de vingt ans et que l’on ne voit pas pourquoi Molière se serait lancé dans un registre que le public boudait. Le moliériste Claude Bourqui se demande même pourquoi « Molière s’aventure dans une voie originale et risquée ? » [Les Sources de Molière, 1999, p. 367]. Ce qui me fait être si affirmatif, c’est que Dom Garcie de Navarre et Don Sanche d’Aragon ont une atmosphère et un style communs. Et que, dans les deux pièces, les personnages ont pour noms Dom Garcie, Dona Elvire, Dom Alvar et Dom Lope. On trouve aussi des formulations identiques et plusieurs développements de Dom Garcie proviennent des tirades de Corneille sur l’amour platonique, ainsi que l’a constaté Georges Couton.
GD : Et que disent les moliéristes pour expliquer ce mimétisme ?
DENIS BOISSIER : Ils veulent croire que Molière a été influencé par Corneille. C’est la thèse de Molière disciple non avoué de Corneille. Mais je crois plutôt qu’à l’instar des peintres qui aiment exécuter plusieurs tableaux d’un même paysage, en modifiant le point de vue ou l’éclairage, Corneille a écrit deux variations, empruntant au répertoire espagnol pour Don Sanche, à une pièce italienne pour Dom Garcie. A moins que Dom Garcie ne soit une pièce de son jeune frère Thomas…
GD : C’est vrai qu’on a tendance à l’oublier ce pauvre Thomas Corneille…
DENIS BOISSIER : Pour Gustave Michaut, l’influence de Thomas est aussi évidente dans Dom Garcie que celle de Pierre [« On dirait que Molière s’est souvenu ici des pièces des deux Corneille, non seulement de Pauline entre Polyeucte et Sévère ou de Rodogune entre Antiochus et Séleucus, mais de Don Sanche d’Aragon et de Timocrate [Thomas Corneille] », Les Débuts de Molière à Paris, 1923, rééd. 1968, p. 100].
GD : Alors ? Pierre ou Thomas ?
DENIS BOISSIER : Nous ne saurons sans doute jamais si Dom Garcie est une œuvre de Pierre, ou de Thomas qui l’imite, ou une ébauche commune qui serait restée inédite si Molière n’avait pas cru pouvoir en faire un succès.
GD : Votre intime conviction ?
DENIS BOISSIER : Je crois que nous devons l’essentiel de cette œuvre à Pierre Corneille car beaucoup d’extraits se retrouveront dans plusieurs des pièces qu’il écrira pour le Comédien : Le Misanthrope [cf. acte IV, scène 3], mais aussi Tartuffe, Amphitryon, et jusqu’aux Femmes savantes. Et Corneille a toujours pratiqué l’autocitation. Il est le seul à le faire si méthodiquement, enfin…à l’exception de Molière…qui fait, là encore, exactement comme Pierre Corneille.
GD : Et que disent les moliéristes de cet autre mimétisme ?
DENIS BOISSIER : Rien. Ils préfèrent ne pas en parler. Comme le remarquait Henry Poulaille, Molière emprunte à Corneille jusqu’à ses tics d’écriture ! [« Il est bien rare que deux poètes aient la même conception du travail, les mêmes mètres, les mêmes artifices de métier. Encore plus rare qu’ils aient les mêmes tics. », Corneille sous le masque de Molière, 1957, p. 188].
GD : Au moins l’échec de Dom Garcie de Navarre a eu l’avantage de montrer à Molière quelle est sa voie : la comédie et non la tragédie.
DENIS BOISSIER : Ni même la tragi-comédie. Molière ne sera pas le porte-voix de Corneille, mais il va rendre le meilleur des services à son mentor en lui permettant de donner libre cours à son esprit satirique, à son goût de la chicane. Molière va incarner pleinement la signification de son pseudonyme Moliere /Légitime.
GD : A mon sens, ce pseudonyme est emblématique de l’Affaire Corneille-Molière. Si l’explication que vous en donnez est vraie, tout le destin de Molière s’explique !
DENIS BOISSIER : En 1644, c’est un nom de théâtre donné à un débutant, un encouragement. La troupe, de 1643 à 1658, jouera sans cesse Corneille en province, notamment Andromède…Mais si être le « Moliere » de Corneille ne signifiait pas grand chose en province, il n’en sera pas de même à Paris, en 1658. Car si Molière ne joue que du Corneille c’est parce qu’il veut être non pas un farceur, mais un grand comédien, et pas n’importe quel grand comédien ! Il veut être le comédien attitré de Pierre Corneille, comme l’est Floridor, la vedette incontestée de l’Hôtel de Bourgogne. Tout le monde a des rêves. Celui de Molière c’est de rivaliser avec Floridor, le grand ami de Corneille. Dans son théâtre prêté par le roi, il espère avoir bientôt l’exclusivité des nouvelles œuvres de la « gloire de la France ». Voilà, selon moi, ce que signifie ce pseudonyme auquel les moliéristes, bien sûr, ne veulent pas s’intéresser.
GD : Aucun d’eux n’a jamais fait le rapport entre « Moliere » et le verbe molierer ?
DENIS BOISSIER : Aucun.
GD : C’est plutôt étrange, vous ne trouvez pas ?
DENIS BOISSIER : C’est même inquiétant, mais c’est logique. Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l’heure… des dizaines d’articles sur "Molière et Racine", "Molière et Jodelet", "Molière et Montauzier" auquel il n’a sans doute pas adressé deux fois la parole, "Molière et Guillerargues" qu’il n’a peut-être jamais rencontré… mais aucun sur "Molière et Corneille". Bon, je suis injuste avec la confrérie des « dévots de Molière »… Il y en a un, Auguste Baluffe, qui avait bien plus d’intuition que ses confrères – c’est d’ailleurs à cause de cela qu’ils l’ont excommunié avec grand fracas – , Baluffe, donc, s’est un jour demandé si Jean-Baptiste Poquelin n’avait pas pris ce nom de théâtre comme un « page » du Moyen Age qui veut servir son maître [« Avait-il tenu à prendre ce nom de Molière par droit de possession domestique et comme un page – un page de Lettres – prend les couleurs de son maître ? », Molière inconnu, 1886, p. 32]. La formule me paraît pertinente.
GD : C’est en effet vraisemblable, d’autant que Corneille est plus âgé que Jean-Baptiste Poquelin.
DENIS BOISSIER : Il a seize ans de plus. A cette époque, c’est l’équivalent d’une génération. Corneille aurait pu être son père.
GD : Si l’on admet que Corneille a légitimé Jean-Baptiste Poquelin en 1643, lors du premier long séjour à Rouen, vous pensez que Corneille pouvait, dès cette date, espérer un quelconque bénéfice de cette légitimation ?
DENIS BOISSIER : Pourquoi pas ? Corneille a toujours voulu qu’il y ait plus de théâtres à Paris afin d’être davantage joué. En se montrant favorable aux débuts de carrière de la nouvelle troupe, alors dirigée par Madeleine Béjart, il pouvait espérer que son œuvre serait souvent représentée par cette Troupe et qu’un jour, au lieu de deux théâtres parisiens, il y en aurait trois. Mais en 1643 Madeleine Béjart et ses compagnons échouent à Paris et doivent se rabattre sur la province. Nous savons qu’en 1658, lors du second long séjour, Corneille et son frère conçoivent le projet que la troupe de Molière s’associe avec celle du Théâtre du Marais qui était en perte de vitesse. Mais, finalement, le roi ayant jeté son dévolu sur Molière, il était plus intéressant pour Corneille de s’associer directement avec son Légitime.
GD : Tout va donc pour le mieux du point de vue de Corneille.
DENIS BOISSIER : Cela aurait pu être le cas, mais Corneille sait que la troupe de Molière ne brille pas dans les tragédies. Pour Thomas, la Troupe n’est bonne qu’à jouer des « bagatelles », c’est-à-dire : tout, sauf les tragédies qu’ils écrivent, son frère et lui. Il en fait même la remarque désabusée à l’abbé de Pure.
GD : Cet abbé qui jouera un rôle dans la création des Précieuses ridicules…
DENIS BOISSIER : Oui, en accord avec Pierre Corneille, l’abbé ne dira rien lorsque Molière sera accusé d’avoir plagié sa Précieuse… En 1658, il est probable que Pierre Corneille, s’il est satisfait de son association avec une troupe ambitieuse, ne se fait pas d’illusions. Ce ne sont pas ces comédiens, trop rôdés à la farce italienne, qui donneront envie au public d’applaudir ses nouvelles tragédies. D’ailleurs, pourquoi chargerait-il Molière de créer une tragédie alors que l’Hôtel de Bourgogne le fait très bien, ou, à défaut, le Théâtre du Marais ?
GD : Corneille n’est donc pas trop déçu que la troupe de Molière ne puisse pas représenter ses tragédies.
DENIS BOISSIER : Il a toujours su que la troupe de Molière ne lui rapporterait de l’argent que dans la mesure où il écrirait pour elle des comédies, ou mieux, des satires. Grâce à sa virtuosité et sa polyvalence stylistique, versifier des comédies ou écrire des satires lui coûte peu de travail – et, qui sait ? un jour prochain cette troupe pourrait avoir son théâtre à elle et, si cela arrivait, elle lui serait bien utile, même pour les tragédies. Voilà ce que dut se dire Corneille lorsqu’il monte à Paris avec Molière en octobre 1658.
GD : Corneille, rappelons-le, veut remercier Fouquet qui lui a acheté très cher sa tragédie Œdipe…2.000 livres, c’est une très belle somme pour une tragédie !
DENIS BOISSIER : Certes, mais Œdipe les vaut. Et Molière, lui aussi, sait ce que vaut Corneille car il lui paiera la même somme pour des tragédies qui ne connaîtront peu d’applaudissements. Mais Corneille n’est pas monté à Paris uniquement pour remercier Fouquet. Il veut aussi recommander la troupe de Molière à la reine mère.
GD : Pourquoi à elle ?
DENIS BOISSIER : Parce qu’Anne d’Autriche apprécie beaucoup son œuvre et qu’elle lui a souvent témoigné de l’intérêt. Il est possible qu’il ait su qu’elle avait décidé, en accord avec Mazarin, de donner à son second fils Philippe d’Anjou, dit Monsieur, frère unique du roi, un train de vie à la hauteur du rôle politique qu’il va devoir jouer. Il vient d’avoir dix-huit ans. Il lui faut une demeure digne de son rang et, pour son standing, une troupe de comédiens. Corneille a sans doute convaincu la reine mère de choisir la troupe de Molière.
GD : Et la troupe de Molière devient celle de Monsieur, frère unique du roi.
DENIS BOISSIER : Seulement de nom. Car le roi, presque aussitôt, s’accapare Molière. Et aussitôt il se montre généreux envers lui, ce que ne sera jamais Monsieur.
GD : Revenons aux liens qui unissent Corneille et Molière. Alors qu’il dirige le Palais-Royal Molière jouera souvent Corneille et créera deux de ses tragédies.
DENIS BOISSIER : Attila en 1667 puis Tite et Bérénice en 1670. Molière aurait créé Pulchérie [1672], dont le rôle principal était écrit pour Armande, si la maladie ne l’en avait empêché.
GD : Cette association me semble plus avantageuse pour Molière que pour Pierre Corneille. A l’un les lumières et les applaudissements, à l’autre l’obscurité et le silence.
DENIS BOISSIER : Corneille a toujours rêvé d’un théâtre qui défendrait son travail. S’associer avec cette Troupe, même si c’est une troupe spécialisée dans la commedia dell’arte, c’est, d’une certaine façon, voir son rêve se concrétiser. Et c’est aussi s’assurer d’un revenu régulier, ce qui a pour Pierre Corneille une grande importance. Et puis, en restant dans les coulisses du « premier farceur de France », Corneille s’est donné une seconde jeunesse. Il a enfin échappé à la malédiction sociale qui l’obligeait depuis Le Cid à taire son talent de basochien et d’auteur comique.
GD : En somme, selon vous, c’est un partenariat plutôt équilibré.
DENIS BOISSIER : Oui. D’ailleurs les deux hommes ne se fâcheront jamais. Jamais Corneille n’écrira quoi que ce soit contre Molière. Il respectera le pacte qui les lie sous l’égide du Service du Roi, ou plus exactement, celui de la Chambre du Roi, à laquelle appartient aussi le duc de Saint-Aignan qui est chargé de l’organisation des soirées spectacles de la Cour.
GD : Molière et Saint-Aignan travailleront ensemble ?
DENIS BOISSIER : Très souvent. Saint-Aignan a la charge de premier gentilhomme de la chambre et il est l’intendant des ballets et spectacles. Il a aussi une fonction d’informateur. Par Saint-Aignan, le roi sait tout ce qui se passe à la Cour. De la même façon, avec Molière, Louis XIV sait ce que le peuple pense, et d’abord dans les milieux satiristes, qui sont les plus dangereux.
GD : Quand Molière rencontre-t-il Saint-Aignan ?
DENIS BOISSIER : Chaque matin dans la chambre où dort le roi, puisque leur fonction leur donne le privilège d’assister au lever du Soleil. Même quand Molière n’exerce pas sa charge de Valet de chambre et de Tapissier du roi, il peut, grâce à son « emploi » de bouffon du roi, rencontrer aussi souvent que nécessaire le duc de Saint-Aignan pour prendre avec lui les dispositions indispensables au bon déroulement des futurs spectacles.
GD : Ce Saint-Aignan, que pensait-il de Molière ?
DENIS BOISSIER : Nous n’en savons rien. C’était un duc, et Molière le bouffon du roi. Leur seul point commun était les spectacles de la Cour. Je doute que le duc ait eu des affinités avec un homme qui passait son temps à s’amuser avec des libertins et des farceurs. En revanche, nous savons qu’il s’intéressa de près à Racine.
GD : Quel dommage que Saint-Aignan n’ait pas livré quelques confidences sur Molière…
DENIS BOISSIER : Les grands noms de la Cour n’ont fait que de très rares allusions à Molière. Même l’écrivain Chapelain, qui tenait l’emploi de conseiller littéraire de Louis XIV n’a, dans sa très longue correspondance, fait allusion à Molière que deux fois, avec à chaque fois qu’une ligne, et ne le considérant que pour ce qu’il fut : un comédien.
GD : En ce temps-là on ne se commet pas avec un comédien…
DENIS BOISSIER : En effet. Et encore moins avec un farceur.
GD : Mais ce farceur-là est le protégé du roi !
DENIS BOISSIER : Et c’est bien ainsi que tout le monde a ressenti Molière. Car si pour la noblesse Molière n’est pas fréquentable, il est en revanche incontournable. Par exemple lorsque, à la demande du roi, Chapelain met le nom de Molière sur la liste des pensionnés, il a soin de préciser que Molière doit se garder de la scurrilité, un mot bien oublié qui signifie selon Le Robert « basse bouffonnerie ».
GD : A l’évidence, Chapelain n’aimait pas Molière. Mais un doute m’assaille… Pourquoi Louis XIV met-il Molière sur la liste des pensionnés ? Cette liste, si je ne m’abuse, était réservée aux gens de lettres.
DENIS BOISSIER : Précisément, cela a fait un tollé lorsque les pensionnés, et plus encore les non pensionnés, ont vu le nom de Molière sur la liste. Il y avait là, pour eux, quelque chose de scandaleux.
GD : Alors que pour nous, c’est tout le contraire ! Tous ces noms d’écrivaillons si près du grand Molière !
DENIS BOISSIER : Oui, parce que la Révolution française est passée par là. Mais le moliériste Gustave Larroumet a été assez lucide sur ce point. Il dit que Molière était aussi peu à sa place dans cette liste que l’aurait été le comédien Talma sur la liste des promus à l’ordre de la Légion d’honneur instaurée par Napoléon au bénéfice des seuls militaires [« Un bouffon, auteur de quelques grosses farces et de deux ou trois comédies mal intriguées, mis au rang des hommes de lettres les plus considérables ! En l’inscrivant sur sa première liste de pensions, Louis XIV heurtait le préjugé plus directement encore que ne l’eût fait Napoléon 1er en comprenant Talma parmi les premiers membres de la Légion d’honneur. », La Comédie de Molière, l’auteur et le milieu, 1903, p. 253].
GD : Vous ne m’avez pas répondu : pourquoi Molière est-il sur cette liste s’il n’est pas écrivain ?
DENIS BOISSIER : Il n’y figure pas en tant qu’écrivain ou poète, mais en tant que « bel-esprit ». Or « bel-esprit » est une étiquette mondaine, et il y a un abîme entre un « bel-esprit » et un écrivain.
GD : Dans ce cas, pourquoi Molière, s’il n’est qu’un bouffon, est-il pour Louis XIV un « bel-esprit » ?
DENIS BOISSIER : Parce que le roi en a décidé ainsi. Puisqu’il a choisi Molière pour être le créateur de ses soirées théâtre, comme nous dirions aujourd’hui, Molière est donc celui qui a le « bel-esprit » nécessaire à cette fonction. Molière est un bouffon « bel-esprit », c’est-à-dire qu’il n’est ni rustre ni frustre, je n’ai d’ailleurs jamais prétendu le contraire. Molière est un bouffon qui s’y entend en matière de spectacles comme L’Angely, autre bouffon de Louis XIV, était réputé pour ses réparties cocasses ou spirituelles. Le fait que Molière ait été pensionné dès la première liste corrobore qu’il était bel et bien, dès cette époque, le bouffon du roi car les bouffons du roi ont toujours eu, du moins depuis le roi Charles-le-Sage, un titre officiel et une pension parfaitement renouvelée, signes constitutifs de leur fonction honorifique.
GD : Revenons, si vous le voulez bien, aux connexions qui relient Molière à Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Des témoignages attestent que les deux hommes ont plusieurs fois dîné ensemble, ou bien avec Baron, le jeune protégé du Comédien. Et l’exemple de Psyché, en 1671, montre dans quelle estime Molière tenait Corneille car, si l’on en juge par son sujet "romantique" et au vu de la carrière ascendante du « tendre Racine », c’est à ce dernier que Molière aurait dû s’adresser pour écrire la pièce, et non au « martial Corneille », à cet auteur si romain que ne veut plus entendre la nouvelle génération de spectateurs.
GD : En conclusion, d’une façon globale, sans Molière, qu’aurait fait Corneille dans la seconde moitié de sa longue carrière ?
DENIS BOISSIER : Triste figure. Il était fini dès 1652. Sa tragédie Œdipe n’a été un succès que grâce à la personnalité de son commanditaire Fouquet.
GD : Sans Corneille, qu’aurait fait Molière durant la seconde moitié de sa carrière ?
DENIS BOISSIER : Il aurait continué à faire le pitre, il aurait raccommodé avec son équipe des comédies tirées d’un vaste répertoire. Et ces comédies, à cause de leur indigence, ne seraient pas passées à la postérité. Et jamais Molière ne serait devenu la gloire nationale de la France.
GD : Pour vous, Molière n’a jamais rien écrit de génial.
DENIS BOISSIER : Les seules pièces qui font entendre une musique des mots de laquelle s’élève une âme, ce sont celles dont les études statisticiennes des universitaires Cyril et Dominique Labbé démontrent qu’elles sont de Pierre Corneille. Pour le reste, ce sont des farces qui partent dans tous les sens et dont l’essentiel est démarqué du répertoire italien et espagnol, quand ce ne sont pas des plagiats d’auteurs français comme Boisrobert, Rotrou ou Cyrano de Bergerac. Si on ajoute que Corneille a fait l’aveu dans une de ses poésies qu’il avait écrit bien plus qu’on ne croit, si on ajoute que les meilleures pièces de Molière exigent un bagage littéraire, juridique et religieux important, beaucoup de temps et de corrections, que les ressemblances stylistiques et thématiques sont frappantes entre elles et l’œuvre officielle de Pierre Corneille, vous m’accorderez le droit d’être suspicieux envers le concept de l’Immaculée Conception du génie tardif de Molière.
GD : C’est votre droit le plus strict. Et je vous comprends d’autant plus qu’en ce qui me concerne, j’ai toujours eu pour principe de d’abord douter, et seulement après de croire. Mais avec Molière, je l’avoue, j’ai d’abord cru en son génie – tout le monde en est si convaincu – et ce n’est que depuis peu que j’ai commencé à douter…
DENIS BOISSIER : C’est très tonique de douter des consensus de surface. Dans ce cas, accordez-moi aussi le droit de dire qu’il n’est pas illogique, au vu de ces éléments, et de tant d’autres que nous n’avons pas eu le temps d’aborder, d’envisager la vie et la carrière de Molière comme celles d’un homme qui, de simple farceur de tréteaux provinciaux, est devenu « le fou du Roy », ou son « bel-esprit » comme on disait de tous ceux qui passaient pour des intellectuels mais qui ne se donnaient pas la peine de le prouver plume à la main.
GD : Quelle différence avec la thèse officielle qui affirme que Molière, de simple comédien, est devenu à trente-sept ans le plus grand auteur de son temps ! Ces deux thèses sont vraiment inconciliables.
DENIS BOISSIER : Je veux bien être conciliant et concéder que Jean-Baptiste Poquelin a essayé d’être un bon tragédien. Mais il n’y est jamais parvenu, comme en témoignent tous ceux qui l’ont vu en scène. Je concède aussi que Molière est devenu l’auteur le plus polyvalent de son temps et ce, dès son arrivée à Paris en 1658, mais que cette métamorphose qui plaît tellement aux biographes romantiques – et que le moliérâtre Georges Mongrédien appelle un « miracle » –, nous la devons à Pierre Corneille, ainsi qu’à quelques autres écrivains demeurés à jamais dans l’ombre de « l’illustre Molière ».
GD : Autrement dit, vous ne concédez rien à la thèse officielle.
DENIS BOISSIER : Bien sûr que si : je reconnais que c’est une thèse officielle, avec tout un arrière-plan politique et toute la démagogie et les arrangements historiques qu’elle exige pour perdurer en tant que dogme.
QUATRIÈME DIALOGUE
« Le théâtre moliéresque, que l’Université appelle une œuvre "classique", est un théâtre collégial d’essence carnavalesque. » (5 octobre 2008)
Gérard DURAND : Si la thèse officielle qui fait de Molière un grand auteur est historiquement fausse, pourquoi, jusqu’à Pierre Louÿs, personne ne l’a remise en cause ?
DENIS BOISSIER : C’est comme si vous me demandiez pourquoi pendant tant de générations personne n’a remis en cause la théorie de la terre plate, ou celle de la terre centre de l’univers – ou encore, plus proche de nous, la thèse du « miracle grec », étudiée dans toutes les universités européennes pendant plus de cent ans et qui est aujourd’hui complètement rejetée. Ne prétendait-on pas, hier encore, que l’homme de Neanderthal était un être stupide et dénué de tout sens artistique ? N’affirmait-on pas aussi qu’il avait disparu avant qu’apparût l’homme de Cro-Magnon ? Aujourd’hui l’on sait que c’est faux. Et la découverte en 2003 de l’Homme de Flores [Homo floresiensis] ne vient-elle pas d’apporter un démenti à tous ceux qui pontifiaient sur les mécanismes de l’évolution de l’Homme ? Chaque jour, en science, de nouvelles théories cassent d’anciens savoirs qui, brusquement, se révèlent n’être que des préjugés. Mais rien n’est plus difficile pour une société que de désapprendre ce que son élite lui a enseigné. Surtout lorsque la vérité est moins flatteuse que les mensonges. Cela dit, Pierre Louÿs ne fut pas le premier, en 1919, à réfuter le dogme moliériste. Des professeurs de Lettres l’avaient précédé, mais sans en faire un débat public. Notamment en 1912 un agrégé de l’Université, professeur au Lycée de Périgueux, enseignait à de futurs bacheliers que Molière n’avait pas écrit les grandes pièces qu’on lui attribuait et que leur auteur ne pouvait être que Pierre Corneille.
GD : Si, à quelques exceptions près, personne n’a douté de Molière, c’est que la thèse officielle a ses vertus.
DENIS BOISSIER : Vous avez raison. La thèse "politiquement correcte" a permis la mise en place d’un mythe national. Elle a donc joué un rôle non négligeable.
GD : Cependant vous la combattez.
DENIS BOISSIER. D’abord je ne suis pas seul, d’autres la combattent avec moi. Ensuite, l’Affaire Corneille-Molière pose à tous les intellectuels un problème moral : un mythe national est-il préférable à la vérité historique ?… Personnellement, je ne le pense pas.
GD : Je suis d’accord avec vous. La vérité, quelle qu’elle soit, est préférable à tout ce que l’homme peut inventer.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, vous me permettrez de remarquer que, par chance pour la vérité, la réalité historique, en ce qui concerne Molière, est plus réaliste, notablement plus complexe et, d’une certaine façon, plus romanesque que la biographie officielle enseignée en classe.
GD : Même si beaucoup de vos arguments convainquent, comment voulez-vous qu’on puisse opter en connaissance de cause pour l’une ou l’autre thèse si absolument opposée ? Des années d’études comparatives entre nos mœurs et celles du Grand Siècle sont nécessaires pour espérer pouvoir résoudre l’Affaire Corneille-Molière.
DENIS BOISSIER : S’imprégner du XVIIe siècle demande en effet un certain apprentissage et beaucoup de modestie, nous ne le savons que trop, nous qui passons notre temps à répéter que Molière n’est pas "notre contemporain" comme veulent nous en persuader les moliéristes, mais celui de Louis XIV.
GD : Depuis si longtemps Molière a si bonne presse que plus personne aujourd’hui n’est prêt à envisager que cette estime institutionnalisée serait la conséquence d’un endoctrinement parfaitement réussi.
DENIS BOISSIER : C’est bien là le problème. Chaque jour des chercheurs découvrent des vérités qui fâchent les institutions et sont mis à l’index. Dans chaque domaine la vérité ne s’impose que très lentement. Voyez le cas de Gilbert Walker…En 1923 il découvrit les effets étonnants du courant El Nino sur le climat mondial, et malgré les graves indices qu’il apportait à sa thèse révolutionnaire, il fut, jusqu’à sa mort, traité de charlatan. Aujourd’hui sa découverte est la pierre angulaire de la climatologie globale. Aussi nous ne nous faisons pas d’illusions, ce ne sont pas nos arguments qui convaincront le public, c’est la vérité elle-même qui fera ce travail. Une fois en marche, la vérité triomphe toujours car, comme l’avait constaté le scientifique Max Planck, ses adversaires finissent par mourir tandis que ses partisans prolifèrent. En effet, peu à peu les nouvelles générations se désintéressent des préjugés du "politiquement correct" et peuvent accepter les idées dont elles ont besoin.
GD : Je ne sais quel scientifique disait que l’on reconnaît qu’une théorie est vraie au fait qu’elle suscite davantage de découvertes et de développements que la théorie qu’elle combat.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, il est certain que la méthode historico-critique offre plus de sujets de découverte sur le XVIIe siècle que la théorie officielle. Mais au final, c’est le Temps, et lui seul, qui se chargera de départager les deux thèses. Déjà nos idées circulent un peu partout.
GD : Vous êtes donc optimiste ?
DENIS BOISSIER : Oui. Par la force des choses, les mentalités évoluent. Et ce qui était jugé inacceptable devient un jour la norme. Bientôt les plus lucides de nos dix-septiémistes réduiront à peu de chose le dogme moliériste établi vers 1870 et qui, à quelques nuances près, est toujours en place aujourd’hui. Une Danoise, Anne Elkjær Kristensen, vient de mettre en ligne, en langue française, le premier mémoire universitaire sur l’Affaire Corneille-Molière.
GD : Le site corneille-moliere.org lui a même consacré un article.
DENIS BOISSIER : En effet, dans la rubrique ACTUALITE. Si d’aventure Anne Elkjær Kristensen lit cet entretien, qu’elle n’hésite pas à nous contacter, nous serons heureux de lui communiquer nos dernières découvertes.
GD : Revenons à Molière, ou plutôt à son théâtre, enfin même pas puisqu’il n’en est pas l’auteur au sens moderne de ce mot.
DENIS BOISSIER : Molière est "auteur" seulement comme l’entendait le XVIIe siècle. En tant que directeur de théâtre et chef de troupe, il a assumé la responsabilité des pièces qu’il a signées sous son nom de comédien. Ce faisant, il a permis aux véritables auteurs des satires qu’il mettait en scène de ne rien avoir à redouter de la double censure religieuse et politique. Bien sûr, comme toutes les vedettes de son temps, Molière fut déclaré l’"auteur" de ses spectacles, mais cela ne signifiait rien juridiquement et socialement car, ainsi que vous le savez, les comédiens bénéficiaient alors d’un statut spécial qui les plaçait hors des lois sociales. Au XVIIe siècle la grande famille des comédiens constituait l’équivalent de la caste des intouchables telle qu’elle existe encore en Inde. On riait ou on pleurait à leurs spectacles mais, en dehors de la scène, le "bon bourgeois" pensait du mal des comédiens, et plus encore de cette promiscuité dans laquelle actrices et acteurs vivaient. L’Eglise leur reprochait aussi d’étouffer leur âme dans l’artifice et le mensonge, le déguisement et les faux sentiments.
GD : Expliquez-nous ce qu’est, en fonction de l’angle original de votre thèse, le théâtre de Molière.
DENIS BOISSIER : Le théâtre moliéresque, que l’Université appelle une œuvre "classique", est un théâtre collégial d’essence carnavalesque.
GD : Qu’entendez-vous par collégial ?
DENIS BOISSIER : Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, sous Louis XIV les comédies et les farces étaient écrites par les comédiens, chacun apportant sa contribution en fonction de son rôle. Mais lorsque, pour des raisons de prestige ou d’opportunité, ils voulaient un résultat plus ambitieux, ces comédiens payaient des écrivains, lesquels, parce que la comédie était un genre honni par l’élite, préféraient demeurer anonymes. Alexandre Hardy et Rotrou, deux écrivains qui furent les modèles de Pierre Corneille, écrivirent une grande quantité de comédies qu’ils ne signèrent pas car ils ne voulaient être connus que pour leurs tragédies. Pierre Corneille n’a pas agi différemment.
GD : Molière a très bien pu écrire de concert avec ses compagnons puis, grâce à son talent, avoir la préséance et finir par écrire seul ses pièces.
DENIS BOISSIER : Nous avons déjà évoqué cette hypothèse qui, selon moi, est une impossibilité ontologique. Toute sa vie, Molière a montré dans sa façon de vivre et ses choix artistiques à quel point il était un farceur. Et ce sont très précisément ses choix artistiques qui l’ont fait être choisi par Louis XIV comme bouffon du roi.
GD : Molière pouvait avoir plusieurs cordes à son arc.
DENIS BOISSIER : Plusieurs cordes à son arc, c’est évident, mais pas plusieurs arcs. Des cordes à son arc, il en a eu six ou, si vous préférez, six métiers n’en formant qu’un seul : celui de comédien-vedette.
GD : Pourquoi dites-vous « six métiers » ?
DENIS BOISSIER : Un : bouffon du roi et l’un des organisateurs des Divertissements de la Cour. Deux : Valet de Chambre et courtisan « très assidu » comme le précise son premier hagiographe La Grange. Trois : tapissier du roi, autrement dit décorateur-assemblier pour les cérémonies et les déplacements royaux. Quatre : Directeur du Palais-Royal, le théâtre le plus rentable de Paris. Cinq : Chef de troupe et metteur en scène prolifique. Six : Vedette qui joue les plus longs rôles.
GD : Cela fait beaucoup pour un seul homme.
DENIS BOISSIER : Et à cette sextuple activité déjà bien harassante, il faudrait ajouter « génie spontané et omniscient » ! C’est tout à fait impossible !
GD : C’est peu probable, mais non impossible.
DENIS BOISSIER : Pour cela il faudrait admettre qu’un farceur, qui s’est présenté comme tel à ses contemporains pendant près de trente ans, puisse simultanément avoir été un écrivain exceptionnel de la trempe d’un Corneille, auquel, comme fait exprès, il ressemble techniquement parlant jusqu’à avoir ses tics d’écriture, sa culture des anciens Grecs et Romains ainsi que sa connaissance du lexique juridique et des dogmes religieux. Et il faudrait alors aussi trouver normal que Molière soit le seul à pratiquer l’autocitation si caractéristique de Pierre Corneille, et trouver logique que les œuvres que Molière réutilise soient toujours celles qui ont le style de Corneille. Et, comble de mimétisme, ces autocitations, Molière les replace toujours dans une pièce que nous attribuons à Pierre Corneille !
GD : J’ai conscience de me faire l’avocat du diable, mais n’est-ce pas le privilège des grands hommes de pouvoir faire ce que les autres ne croyaient pas possible ?
DENIS BOISSIER : Je ne peux pas croire que Molière ait pu être à la fois un farceur et un érudit. Un comédien et un auteur. Un mécréant et un intellectuel concerné par le sacré. Un serviteur zélé de Louis XIV et un libre penseur !
GD : Est-ce si impossible ?
DENIS BOISSIER : Pas pour ceux qui ont foi en Molière, comme d’autres ont foi en Celui qui a changé l’eau en vin, multiplié les petits pains, marché sur l’eau et ressuscité au bout de trois jours.
GD : Et, selon vous, comme la foi déplace les montagnes c’est la foi des « dévots de Molière » qui a "déplacé" Molière et a fait d’un farceur… le plus illustre des écrivains français !
DENIS BOISSIER : Historiquement, tout le démontre. Il suffit simplement d’étudier les grandes étapes de sa carrière posthume. Nous autres modernes pouvons croire Molière doté de tous les dons et de toutes les vertus, car l’éloignement est toujours source d’erreur de perspective, mais que faites-vous de tous les témoignages ? Rayez-vous d’un trait de plume, comme le font les moliéristes, tous les contemporains qui affirment que Molière fut le « bouffon » de leur temps ?
GD : Les contemporains sont souvent mauvais juges.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, il est à craindre que dans deux cents ans on prenne le comédien Louis de Funès pour le plus grand auteur de comédies du XXe siècle et que l’on s’étonne qu’il n’ait laissé, lui non plus, aucun texte de sa main.
GD : Ceux qui combattaient Molière étaient mal placés pour le comprendre intimement.
DENIS BOISSIER : Mais pourquoi tous ces gens, qui n’étaient ni plus intelligents ni plus stupides que nous, combattaient-ils Molière ? Par lubie ? Par désœuvrement ? Ou parce qu’ils savaient pertinemment que Molière, dans son « emploi » de bouffon du roi, entraînait la France vers le bas ? A leurs yeux, Molière rabaissait le niveau d’excellence qu’avait atteint le théâtre sous Richelieu. L’historien Antoine Adam l’a dit très clairement : « Toutes les polémiques du temps ont accusé Molière d’avoir compromis l’œuvre morale entreprise au théâtre depuis Richelieu. » [Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, 1968, T.IV, p. 326, note 1].
GD : Les intentions de Molière ont pu être mal comprises.
DENIS BOISSIER : Parce que vous pensez que nous qui ne l’avons pas connu sommes mieux placés pour juger de ses véritables intentions ? La première règle en Histoire c’est d’accorder la préférence aux témoignages et aux documents d’époque. Si nous suivons cette règle, force est de constater qu’au XVIIe siècle tout le monde considérait sans l’ombre d’une discussion que Molière était un mécréant qui s’amusait avec les homosexuels du Club des « Neufs épulons » et ceux de Lully, qui a beaucoup bu et mangé avec les libertins et qui a passé nombre de ses soirées, sans son épouse, en compagnie de Scaramouche et sa troupe de farceurs. L’imaginer attablé à son écritoire durant des dizaines de milliers d’heures – car il faut cela pour être de l’étoffe des auteurs dont on fait un Corneille – est une vue de l’esprit. Une vue de l’esprit moderne, autrement dit petit-bourgeois.
GD : On peut être libertin, paillard… et bon écrivain.
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Mais vous me demandez de croire qu’un farceur qui a toujours montré la nature faible de son caractère (obéissant envers Madeleine, servile avec le roi, cocu avec Armande) a pu, dans le même temps, être un écrivain viril et puissant. Un écrivain viril qui serait le contraire du personnage de femmelette qu’il a souvent joué et qui, habillé en femme, illustre certaines éditions de son théâtre. Autrement dit, vous voulez un Molière idéal, sans commune mesure avec la seule représentation populaire authentique que nous avons de lui, l’estampe de Simonin, laquelle le représente en 1662 en Sganarelle, dans son habit de bouffon vert et jaune, les cheveux noirs frisés, les sourcils noirs et épais, la mâchoire très accusée – se penchant vers le public, son bonnet à la main.
GD : Nous avons là le vrai Molière, selon vous ?
DENIS BOISSIER : Le Molière historique, oui, sans aucun doute. Et le moliériste Victor Fournel a été assez honnête pour reconnaître que Molière de son temps ne passait pas pour autre chose qu’un farceur [« On voit par la manière dont on le fait figurer avec eux [les farceurs italiens] qu’on le tient bel et bien pour leur pareil. De son temps, en effet, il ne passait point pour autre chose. », Chansons de Gaultier Garguille, 1858, p. VI].
GD : Et le Molière aux longs cheveux blonds bouclés ?
DENIS BOISSIER : Du cinéma ! Le public se représente Molière comme un bel homme parce qu’il est incurablement romantique et naïf. Et les moliéristes voient en Molière un « parfaitement honnête homme » parce qu’ils sont petits-bourgeois et prennent pour argent comptant toute la propagande dévote de la fin du XVIIe siècle. Et aussi parce qu’ils ne peuvent pas supporter, en l’état actuel de leur formation intellectuelle, de découvrir un Jean-Baptiste Poquelin s’enivrant avec ses compagnons de beuverie et, au petit matin, se rendant chez Pierre Corneille afin de prendre copie du prochain spectacle prestigieux attendu par le roi.
GD : Le célèbre portrait peint par Mignard, celui de la Comédie-Française, qui montre un si beau Molière, est donc trop flatteur…
DENIS BOISSIER : Trop flatteur ? C’est un euphémisme. D’abord nous n’avons aucune preuve que ce tableau, que les médias reproduisent systématiquement, est bien de Nicolas Mignard. Ensuite, nous ne savons même pas s’il représente Molière. Il pourrait très bien montrer le beau et célèbre comédien tragique Floridor.
GD : Ne trouvez-vous pas ironique que le plus célèbre des portraits de Molière le montre interprétant le rôle de César dans une pièce de Corneille ?
DENIS BOISSIER : En effet. C’est Molière tel que l’aurait voulu Corneille, tel que tout le monde l’aurait voulu. Mais, vous le savez aussi bien que moi, la réalité a un tout autre visage. Tous les spécialistes sont unanimes : nous ne possédons aucun tableau authentique de Molière. Un seul portrait peut prétendre l’être, celui de Lefèvre, dit « aux trois crayons », dessiné en 1652.
GD : Que vous avez mis en ligne dans le site...
DENIS BOISSIER : Oui… article « Le vrai visage de Molière », rubrique A LIRE EN PRIORITE. Aussi dans « L’Affaire Corneille-Molière, dossier pédagogique ».
GD : C’est vraiment un tout autre Molière !
DENIS BOISSIER : Ce portrait au naturel montre qu’à trente ans Molière, ou plutôt Jean-Baptiste Poquelin, a le teint mat, le cheveu noir et frisé, les sourcils broussailleux, le nez épaté et les lèvres épaisses. Nous savons aussi par d’autres sources qu’il était plutôt petit avec un large torse. Son biographe Georges Bordonove dit que sa démarche était « sans grâce » [« il lui manque, faute de cou, de porter noblement la tête et sa démarche est sans grâce », Molière génial et familier, 1967, p. 72].
GD : Molière ou l’homme aux deux visages. Molière ou l’homme à la double vie…On n’en a jamais fini avec l’éternelle ambivalence de Molière !
DENIS BOISSIER : Cette dichotomie, et même cette schizophrénie, romantique à souhait, ne me convainc pas. Car si Molière avait été l’égal d’un Corneille ne pensez-vous pas que Louis XIV s’en serait rendu compte ? Or, il n’a jamais considéré Molière autrement que comme son amuseur favori. Il l’a d’ailleurs toujours cantonné à partager la scène avec Scaramouche, le plus célèbre des farceurs italiens. Je suis convaincu que si Molière avait été tel que notre culte national l’exige, Louis XIV lui aurait offert un théâtre bien à lui et ne l’aurait pas condamné à la promiscuité avec des farceurs italiens dont les mœurs étaient de perpétuels sujets de scandale. De même, si Molière avait été un homme de plume, Louis XIV l’aurait pris pour conseiller lorsqu’il a voulu s’essayer à la poésie. Or il n’a jamais songé à son bouffon. Il a choisi Benserade ou Dangeau qui, eux, étaient des écrivains. Enfin, vous ne pensez pas que si Molière avait été un grand écrivain, le roi se serait empressé de le faire entrer à l’Académie française ?
GD : Les comédiens n’entraient pas à l’Académie française.
DENIS BOISSIER : Les satiristes piliers de tavernes non plus et pourtant, malgré l’opposition des académiciens, Louis XIV leur a imposé Boileau. Si Louis XIV l’avait voulu, il aurait imposé Molière à l’Académie comme il a imposé Pellisson, dont la candidature ne fut même pas mise au vote. Et comme il imposera Furetière, qui était pourtant l’ennemi de presque tous les académiciens.
GD : Dans ce cas, puisque rien n’empêchait Louis XIV de faire entrer Molière à l’Académie française, pourquoi n’a-t-il pas fait de Molière un académicien ?
DENIS BOISSIER : En effet, rien ni personne ne pouvait l’en empêcher. Sauf lui-même. Louis XIV avait trop conscience des devoirs d’un roi pour aller contre le principe même de la royauté. Car si un roi doit être tout en haut, le bouffon du roi, lui, doit être tout en bas. L’univers mental dans lequel Louis XIV et Molière vivaient était structuré ainsi depuis des siècles. Et ni l’un ni l’autre ne pouvait aller contre le tabou qui empêchait de songer au bouffon du roi pour un honneur institutionnel. Le moliériste Paul Lacroix a donc raison plus qu’il ne croit de souligner que « personne n’aurait eu l’idée de voir Molière entrer à l’Académie française » [Iconographie moliéresque, 1876, p. 331].
GD : On dit que Boileau a proposé à Molière d’y entrer.
DENIS BOISSIER : C’est un "on-dit" tardif, fabriqué après 1700, en pleine période de crise politique dévote, et au moyen duquel on a essayé de rendre Molière le plus présentable possible. Mais même dans cette anecdote de propagande où Boileau lui propose un fauteuil d’académicien, Molière lui répond qu’il est un comédien qui doit rester avec les comédiens. C’est bien la preuve que même lorsqu’on a voulu faire de Molière un « honnête homme », on n’y est pas arrivé, car, à l’époque, je vous le rappelle, les comédiens sont « gens malhonnêtes », et personne ne pouvait se flatter de les fréquenter, sauf un satiriste repenti et adoubé par le roi.
GD : Pour vous, les rapports qu’a entretenus Louis XIV avec Molière sont la meilleure preuve que Molière n’a jamais été autre chose qu’un comédien promu bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Oui. Comme l’ont constaté tous les moliéristes, Louis XIV n’a jamais eu avec Molière les relations intellectuelles qu’il aura avec Boileau ou Racine, ou même Benserade qu’il traitait comme devait l’être un poète ou un homme d’esprit. A l’évidence, jamais Molière n’a eu avec Louis XIV cette relation-là. En revanche, son intimité avec Louis XIV ne peut être comparée à aucune autre. Manger avec Louis XIV, lui parler au naturel, voir le roi rire en se tenant le ventre, c’est le privilège du bouffon du Roi et de lui seul. Une anecdote montre que le roi tutoie son bouffon. Or Louis XIV n’a jamais tutoyé personne. Cette familiarité ne s’explique que parce que le bouffon du Roi est l’alter ego métaphysique de son maître.
GD : Oui, je ne sais plus quel roi appelait son bouffon attitré « mon cousin » [renseignement pris, il s’agit de Louis XII envers Triboulet]. Si je comprends bien, grâce à Louis XIV nous savons qui fut réellement Jean-Baptiste Poquelin.
DENIS BOISSIER : En effet, leurs relations si exceptionnelles nous fournissent de bons indices.
GD : Il y a une chose cependant que je ne m’explique pas. Si Molière n’était pas un écrivain, pourquoi Boileau a-t-il dit à Louis XIV que Molière avait été le plus grand des écrivains de son règne ?
DENIS BOISSIER : Dans l’anecdote tardive et propagandiste à laquelle vous faites allusion, relatée en 1747 par Louis Racine, fils du poète, Boileau ne dit pas que Molière a été le plus « grand » des écrivains, mais qu’il a été le plus « rare », ce qui est très différent. Et en effet, Molière a bien été « rare », lui qui fut le seul à tenir auprès de Sa Majesté cet « emploi » de bouffon, si vous préférez de « bel-esprit ».
GD : L’expression « bel-esprit » ne veut pas dire « bouffon ».
DENIS BOISSIER : Au XVIIe siècle la catégorie « bel-esprit » englobe « bouffon » et « plaisant » qui sont synonymes. Dans son Registre, La Grange dit de Molière qu’il est pensionné en tant que « bel-esprit ». Or, « bel-esprit » est une étiquette mondaine, et il y a un abîme entre un « bel-esprit » et un écrivain. La preuve, dans Les Précieuses ridicules, La Grange dit de Mascarille/Molière : qu’il « passe, au sentiment de beaucoup de gens, pour une manière de bel-esprit ; car il n’y a rien de meilleur marché que le bel-esprit maintenant. » [scène 1].
GD : Tout de même, être un « bel-esprit », ce n’est pas rien !
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Puisque Louis XIV a choisi Molière pour l’amuser, celui-ci a donc tout naturellement le « bel-esprit » nécessaire à cette fonction. Au XVIIe siècle, qu’est-ce qu’un « bel-esprit » ? C’est quelqu’un qui connaît les usages de la Cour, auxquels il se plie. Cette définition correspond parfaitement à l’ « emploi » de Molière.
GD : Dans l’anecdote de Boileau, Molière est donc qualifié de « rare ».
DENIS BOISSIER : Evidemment, puisque le roi avait élu Molière, celui-ci ne pouvait qu’être « rare ».
GD : L’épithète est flatteuse.
DENIS BOISSIER : Oui… Grâce au bon plaisir du roi, Molière fut « rare », et même unique. Mais Boileau a toujours été un ironiste et un courtisan. Ce n’est pas pour rien que Voltaire l’a surnommé « le flatteur de Louis ». Boileau veut flatter le roi. Mais il ne veut pas non plus lui mentir, le roi n’est pas si naïf. Aussi a-t-il joué sur l’ambiguïté de l’adjectif « rare ». Toutefois Louis XIV, qui goûte l’ironie de Boileau, répond sur le même ton : « Je ne le croyais pas, mais vous vous y connaissez mieux que moi. » Ils se sont donc compris à demi-mot. De tous temps les courtisans ont encensé les bouffons du roi, inutile de préciser pourquoi. Au XVIe siècle, le célèbre poète Ronsard, obligé de faire l’éloge de Thony, le bouffon du roi Charles IX, l’a défini comme le « plus sage personnage de France ». Sous Louis XIV les choses n’ont pas changé. Boileau, devenu poète officiel, sera aussi hypocrite que Ronsard, lui aussi poète officiel.
GD : Quand j’ai lu cette anecdote, j’ai pensé que Louis XIV n’était qu’un imbécile qui n’avait rien compris à Molière.
DENIS BOISSIER : C’est normal. Nous subissons tous la propagande démago-moliériste. Mais il est injuste de faire de Louis XIV un imbécile sous prétexte qu’il ne pouvait pas adhérer, et pour cause, à un dogme qui sera créé un siècle plus tard et qui exige une admiration aveugle pour Jean-Baptiste Poquelin, dit « Moliere ». De plus, Molière ne pouvait pas être un « grand écrivain » parce que le roi n’avait pas besoin auprès de lui d’un auteur, mais d’un comédien capable de le faire rire et d’entraîner le public à rire comme lui le voulait. Louis XIV a toujours très bien su choisir ses collaborateurs, que ce soit Colbert, Louvois ou Saint-Aignan. Pourquoi voulez-vous qu’il se soit trompé sur Molière ? Depuis qu’il est enfant il sait très bien ce qu’est un bouffon de Cour, il a d’ailleurs eu le meilleur d’entre eux : Scaramouche. Et vous voulez croire qu’au moment où il monte sur le trône et se choisit un bouffon, Louis XIV se trompe et prend pour un bouffon celui qui était « l’homme le plus admirable de son siècle » comme le définissent les moliéristes ?
GD : Je ne sais que vous répondre...
DENIS BOISSIER : Il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes ni Molière pour un « grand écrivain ». C’est la moralité qu’enseigne l’Affaire Corneille-Molière.
GD : Je suis d’accord, je ne crois pas que Louis XIV ait pu se tromper à ce point sur la nature intime de Molière.
DENIS BOISSIER : Vous imaginez bien que si Molière avait été tel que le rêvent les moliéristes, cela serait su dès son époque, et les opposants à la politique du roi, sans oublier les chansonniers, n’auraient pas manqué de montrer combien Louis XIV était un monstre d’avoir ainsi condamné Molière à patauger matin et soir dans la basse bouffonnerie. On aurait plaint Molière, on se serait révolté à l’idée que l’absolutisme d’un seul détruise l’âme d’un « si parfaitement honnête homme » [La Grange et Vivot, 1682]. Mais non, personne n’a jamais pris la défense de Molière, personne n’a jamais fait la moindre remarque sur les rapports que Sa Majesté entretenait avec son bouffon, les jugeant ces rapports, au contraire, tout à fait normaux, pour ne pas dire traditionnels. Dans un siècle où l’on avait un si grand respect des catégories sociales, il ne fait aucun doute que si Molière avait eu la valeur intellectuelle d’un Pascal ou d’un Vincent de Paul, le génie d’un Racine ou d’un Corneille, ou la dignité d’un Montauzier, jamais une telle erreur sur la personne ne se serait produite, surtout pendant treize ans, c’est-à-dire jusqu’à la mort de Molière ! C’était alors une règle absolue que chacun restât à sa place. Or si l’on a reproché à Molière bien des choses, jamais on ne lui a fait le reproche de n’être pas à sa place.
GD : On imagine mal Louis XIV, dont on dit qu’il était très intuitif, ne pas sentir, avec Molière qu’il rencontrait si souvent, à quelle sorte d’homme il avait à faire.
DENIS BOISSIER : Et c’est parce que Louis XIV était intuitif qu’il ne s’est jamais fait d’illusions sur ses collaborateurs, et en particulier sur les artistes qui ont illustré son règne. C’est pourquoi il a toujours exigé que les meilleurs artistes travaillent ensemble à ses divertissements. Corneille a secondé Molière parce qu’au plus grand des rois il fallait à la fois le plus grand des poètes et le plus grand des farceurs. C’est l’union de leur talents complémentaires qui a permis au jeune Louis XIV d’avoir, ainsi qu’il l’a exigé dès qu’il a pris le pouvoir absolu, un bouffon du roi à sa mesure.
GD : C’était si important pour lui d’avoir un bouffon « à sa mesure » ?
DENIS BOISSIER : Très important. Le bouffon du roi a toujours été un signe extérieur de royauté. Un bouffon du roi, c’est le fouet avec lequel un monarque dresse sa Cour. Et lorsque le choix est bon, le bouffon du roi devient une arme politique. En choisissant le sien, Louis XIV ne faisait que suivre l’exemple de son père.
GD : Louis XIII avait son propre bouffon du roi ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Un danseur-mime qui ne le quittait pas et sur lequel on jasait beaucoup. Louis XIII avait plusieurs autres bouffons dont le célèbre Langely. Il existait tout un "bouffonnariat" qui travaillait vingt-quatre heures sur vingt-quatre à distraire Sa Majesté. Dès qu’il a pris le pouvoir absolu, Louis XIV s’est offert son propre "bouffonnariat" avec Molière pour le rire et la propagande politique, Lully pour la danse et la musique de Cour, mais aussi Benserade pour les ballets et la galanterie, sans oublier le vieux Langely pour les bons mots. Mais Langely ne l’amusait pas alors que Molière, sur scène, savait faire rire le roi à gorge déployée. C’est d’ailleurs attesté par de nombreux témoignages. Toutes ces personnalités travaillaient harmonieusement pour le Service du Roi.
GD : En quoi consistait au juste le « Service du Roi » ?
DENIS BOISSIER : C’était une organisation discrète et efficace qui n’avait qu’un but : satisfaire la volonté du roi, et dont le mot d’ordre était la discrétion, souvent même le secret.
GD : Pourquoi le secret ?
DENIS BOISSIER : Les témoignages sont unanimes : Louis XIV exigeait le secret pour toutes les affaires qui le concernaient. Il voulait être le seul à savoir ce qui se tramait à la Cour, ce qui se passait en coulisses. Il tenait à pouvoir surprendre… Mais son goût du secret peut avoir une autre cause… Il se méfiait de ceux qui désapprouvaient sa conduite et qui, pour le contrôler, se réunissaient sous l’autorité de la reine mère ou du prince de Conti. Louis XIV avait également beaucoup d’opposants parmi les religieux qui l’entouraient. Dans ce contexte, le Service du Roi, qui flattait sa vanité et ses plus bas instincts, opérait le plus discrètement possible. Et c’est ce qui explique pourquoi personne n’a jamais cru judicieux de discourir sur les prérogatives du bouffon du roi, d’y trouver à redire ou de critiquer ce qui se passait dans les coulisses du Palais-Royal, ce théâtre que Sa Majesté avait offert à Molière.
GD : Notre point de vue est bien différent aujourd’hui. Aujourd’hui nous mettons Molière avant Louis XIV. La valeur morale de Molière surpasse - et de beaucoup - celle du Roi-Soleil !
DENIS BOISSIER : Le point de vue moderniste est aux antipodes de la façon de voir des sujets de Louis XIV, comme l’est notre société par rapport à la leur. Autant Molière était alors tout en bas de la société, autant nous l’avons mis tout en haut. Le moliériste Henry Lyonnet a mille fois raison de dire que « ce sont les siècles suivants qui ont placé Molière sur le piédestal où nous le trouvons » [Mademoiselle Molière, 1932, p. 101]. On l’a mis sur un piédestal alors qu’il ne demandait qu’un tréteau.
GD : Et c’est sans doute aussi ce renversement des valeurs qui a fait que la « gloire de la France » après s’être longtemps appelée Pierre Corneille se nomme aujourd’hui Molière.
DENIS BOISSIER : Oui, c’est le système des vases communicants. A cause, ou grâce à la Révolution française, c’est selon, nous avons effectué ce que vous appelez un renversement des valeurs. Molière est devenu pour nous un « dieu », comme l’appellent d’ailleurs ses « dévots » [Louis Loiseleur : « Puisque Molière est en train de passer dieu parmi nous… », Les Points obscurs de la vie de Molière, 1877, p. 13 ; Eugène Noël : « Pour un moliériste attentif à tout ce qui se publie sur son dieu…. », dans Le Moliériste, 1887, n° 99, p. 92 ; etc.]. Mais pour ses contemporains, Molière est la "chose" du roi. Il lui doit tout son « bonheur » ironise La Lettre satirique sur le Tartuffe [1669]. A la mort de Molière, l’écrivain Pierre Bardou écrira que Louis XIV « n’a plus son Moliere ». On ne peut être plus explicite.
GD : Louis XIV avait son Molière, et Molière avait son Corneille !
DENIS BOISSIER : Absolument ! Comme jamais les bouffons du roi n’ont eux-mêmes écrit les innombrables satires et pamphlets publiés sous leur nom, nous sommes en droit d’en déduire que lorsque la comédie moliéresque est de bonne facture, c’est qu’elle a été écrite par un ou plusieurs poètes de troupe, ainsi qu’on les appelait, et quand les alexandrins d’une pièce de Molière, censée avoir été écrite à la va-vite, ressemblent à la perfection à ceux de Pierre Corneille, nous pouvons être encore plus certains qu’ils sont de Pierre Corneille, comme le prouvent d’ailleurs le calcul de la distance intertextuelle entre les comédies signées Molière et la comédie du Menteur de Corneille.
GD : De quand date Le Menteur ?
DENIS BOISSIER : 1642. Et La Suite du Menteur de 1644. En prenant ces deux comédies comme références, les universitaires Cyril et Dominique Labbé ont démontré que seize pièces signées Molière sont de Pierre Corneille [lire dans le site corneille-moliere.org la rubrique « Le CNRS et l’Affaire Corneille-Molière », in DOSSIERS].
GD : Racine a donc eu raison d’avouer que le style de Corneille est « inimitable », même dans la comédie.
DENIS BOISSIER : On peut même discerner dans cet aveu une allusion à la collaboration Corneille-Molière. Car Racine savait de quoi il parlait pour avoir lui-même essayé d’imiter Corneille… sans y parvenir.
GD : J’aimerais que nous revenions sur la nature même du théâtre moliéresque, lequel, selon vous, est d’essence carnavalesque…
DENIS BOISSIER : A l’exception des pièces sérieuses écrites par Corneille, et encore… Molière a toujours farci ses spectacles. C’est ce qui donne à Dom Juan son allure baroque. L’équivalent de trois actes sont de Corneille, le reste, environ deux actes, est un plagiat de scènes des répertoires comiques espagnol, italien et français. Le tout a été cousu, mais maladroitement puisque les coutures sont restées très apparentes.
GD : Pourquoi n’a-t-on pas essayé de les cacher ?
DENIS BOISSIER : Comme presque tous les spectacles de Molière, Dom Juan a été joué dans le cadre du carnaval. Or le carnaval n’est ni le lieu ni le moment d’être puriste. De plus, le public du Palais-Royal n’était pas réputé pour son exigence. Qu’une pièce soit faite de bric et de broc n’avait pour lui aucune importance car le théâtre moliéresque n’était pas un théâtre d’auteur, mais un théâtre collégial de nature carnavalesque au service du roi et de ses divertissements de Cour.
GD : En d’autres termes, Molière dirigeait une sorte d’entreprise théâtrale d’intérêt royal. Est-ce à dire que le Palais-Royal était une succursale du Service du Roi ?
DENIS BOISSIER : Tout à fait. Chaque comédie signée Molière a servi d’illustration à la politique absolutiste de Louis XIV.
GD : Par exemple ?
DENIS BOISSIER : Les Fâcheux et L’Impromptu de Versailles assassinent les marquis qui font perdre son temps au roi. Les Précieuses ridicules, La Comtesse d’Escarbagnas, Les Femmes savantes ridiculisent ces femmes qui agacent Louis XIV parce qu’elle ont la prétention de s’émanciper. La Critique de l’Ecole des Femmes et Les Femmes savantes s’en prennent aux intellectuels non pensionnés qui, parce qu’ils ne sont pas inféodés au pouvoir, représentent une menace pour l’ordre établi. Tartuffe et Dom Juan attaquent les dévots et ceux qui empêchent le roi de s’amuser comme il l’entend. La Princesse d’Elide et Amphitryon mettent en garde les maris qui ne veulent pas prêter leurs épouses à leur roi.
GD : Cela va jusque-là ?
DENIS BOISSIER : Plus que vous ne pouvez le croire ! D’ailleurs cette « servilité » embarrassait beaucoup l’éminent Gustave Michaut [« Certains l’ont accusé de servilité et ont vu en lui un flagorneur de Louis XIV ou même (dans Amphitryon) un agent assez méprisable de peu honorables besognes » Œuvres complètes de Molière, 1947, p. 64].
GD : Molière aurait été en quelque sorte un mercenaire.
DENIS BOISSIER : Il fait ce qu’on lui dit de faire. Sans état d’âme. Jean-Baptiste Poquelin n’est pas un romantique. Il est de son siècle. Il obéit afin d’être dans les meilleures grâces de son maître et n’a qu’à s’en féliciter puisque, grâce à ce laxisme moral qui est propre à son temps, il fait fortune. Dans notre premier dialogue nous discutions si le XVIIe siècle avait été un siècle "classique". Je vous disais que je me méfiais de cette étiquette à mon goût trop scolaire. En ce qui concerne Molière, je suis sûr d’une chose : loin d’être "classique", Molière est l’inventeur de ce que nous avons fini par appeler l’art commercial.
GD : Je vous entends déjà me dire que c’est une des grandes raisons qui font que notre société aime tellement Molière.
DENIS BOISSIER : Si nous le déifions à ce point, c’est que nous ressentons, d’une façon non avouée, que Molière est celui qui a montré la voie aux artistes arrivistes de tous bords. Comment plaire à la fois à son producteur, lequel ne pense qu’à ses intérêts (même si c’est un roi), et au grand public, lequel pense peu ? Molière a montré comment. Et de nos jours faire de l’audimat est toute l’ambition des artistes qui veulent réussir à tout prix. Molière pourrait à juste titre être leur saint patron.
GD : Dois-je comprendre que Molière a vendu son âme au diable ?
DENIS BOISSIER : Pas au diable : au roi. Et aussi au parterre, ce que lui a d’ailleurs vivement reproché Boileau [« C’est par là que Molière illustrant ses écrits/Peut-être de son art eût remporté le prix,/Si, moins ami du peuple en ses doctes peintures,/Il n’eut point fait souvent grimacer ses figures,/Quitté pour le bouffon, l’agréable et le fin,/Et sans honte à Térence allié Tabarin./Dans ce sac ridicule où Scapin s’enveloppe,/Je ne reconnais plus l’auteur du Misanthrope. » Art poétique, 1674]. Dès 1661 Molière se spécialise dans les rôles d’imbéciles et n’apparaît plus dans aucune pièce sérieuse. Par tempérament, et donc, nécessairement, par manque d’âme, Molière s’est enfoncé toujours plus dans la bouffonnerie…Comme le lui reproche Boileau, il a quitté Térence – comprenez Corneille [sur l’équation Térence/Scipion = Molière/Corneille voir Troisième dialogue] – pour Tabarin, lequel était l’un des plus célèbres farceurs du Pont-Neuf.
GD : Molière est devenu bouffon à plein temps à cause du roi ?
DENIS BOISSIER : Oui, il y a entre ces deux hommes un étonnant lien de vassalité. Tout seigneur, surtout le plus humble, se doit d’être aux ordres de son roi. Et ce fut le cas de Molière.
GD : Molière n’était pas un seigneur !
DENIS BOISSIER : Détrompez-vous. Molière était valet de chambre. Or, le terme "valet", au XVIIe siècle, est synonyme de « varlet », lequel était le plus petit des seigneurs. Grâce à ce titre, quoi qu’il fasse de répréhensible, Molière ne dépendait pas de la justice des tribunaux mais du seul roi.
GD : Un indéniable avantage, surtout pendant le scandale suscité par Tartuffe !
DENIS BOISSIER : C’est certain. Si Molière n’avait pas appartenu à la Maison du roi, et, plus encore, s’il n’avait pas été le bouffon du roi, il aurait risqué à cause de Tartuffe un procès ecclésiastique. L’attendaient une exécution en place publique, ou, pour le moins, une interdiction de jouer et, forcément, la faillite.
GD : Mais, fort heureusement, il n’y a eu aucune sanction.
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non ! Il était intouchable en tant que comédien, et invulnérable en tant que bouffon du roi. Il était donc doublement protégé. En revanche, et pour les mêmes raisons, ce lien de vassalité si étroit a été aggravé par un esclavage de tous les instants.
GD : Malgré tant de protection, on a envie de s’écrier : Pauvre Jean-Baptiste !
DENIS BOISSIER : Et vous auriez raison, car malgré tous les prestiges et les richesses de la Cour, Molière sait, par les moqueries ou les insultes qu’il reçoit des grands du royaume, qu’il est fils de boutiquier…
GD : Etre « fils de boutiquier » n’est pas une tare !
DENIS BOISSIER : Non, mais ce n’est pas non plus forcément un atout pour côtoyer les grands de ce monde ou pour comprendre intimement Corneille et Racine. Il y a pire : Si dans la vie, Jean-Baptiste Poquelin est fils de boutiquier, au théâtre il est né Mascarille. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est son biographe Georges Bordonove qui reconnaît que Jean-Baptiste Poquelin a été enchaîné à vie au personnage de Mascarille [« Il est né Mascarille et ne doit aucunement sortir du rôle comique, prenant, au contraire, force et attrait de ses défauts mêmes (son débit extrêmement rapide, et coupé de hoquets) », Molière, génial et familier, 1967, p. 137).
GD : Mascarille porte un masque, comme son nom l’indique…
DENIS BOISSIER : Oui. Ne trouvez-vous pas emblématique que pour ses contemporains Molière ait été associé à un masque ? De plus Mascarille, qui trompe son monde, veut passer pour un « bel-esprit ».
GD : Vous y voyez une relation avec le fait que Molière passait pour « bel-esprit » ?
DENIS BOISSIER : L’identification Mascarille/Molière va plus loin qu’on ne le croit, car si, avec le personnage de Mascarille, Jean-Baptiste Poquelin n’a trompé aucun de ses contemporains, il n’en est pas de même de façon posthume. Car, bien malgré lui, Molière/Mascarille a trompé la postérité. On croit voir en lui un grand seigneur de l’esprit alors qu’il n’était qu’un « varlet », un « vavasseur » comme on disait, c’est-à-dire le plus petit des courtisans ayant un accès direct au roi. Et c’est cet homme qui, toute sa vie, fut un fils de boutiquier puis un domestique dont on a fait, deux siècles plus tard, un républicain, et dont on prétend qu’il est notre « contemporain » ! L’idéologie et l’hypocrisie auront fait dire beaucoup de sottises !
GD : Ne pourrait-on pas supposer que Molière, même s’il fut vassal, avait en lui de quoi transcender cette vassalité ?
DENIS BOISSIER : Supposez tout ce que vous voulez, vous n’empêcherez pas que Poquelin fils n’a pas eu d’autre but que celui de servir son maître, sans la moindre remise en cause, sans le moindre état d’âme.
GD : Vous oubliez le Premier Placet au Roi.
DENIS BOISSIER : Pas du tout.
GD : Il est plein d’état d’âme, ce Placet…
DENIS BOISSIER : Vous plaisantez ? Le seul regret sincère de Molière dans ce Premier Placet est d’être momentanément empêché d’en faire encore plus pour son maître vénéré ! C’est un bouffon à qui on a enlevé l’instrument qui lui sert de fouet et qui se plaint ! Si la Révolution française n’était pas passée par là, nous verrions en Molière tout ce que nous nous refusons de voir : un parvenu, un profiteur, le servile factotum d’un grand roi prédateur. Vous connaissez la chanson "Tout va très bien, Madame la Marquise !" Eh bien, de la même façon on peut dire : Molière, ou tout va très bien, Sire !
GD : N’êtes-vous pas injuste envers lui ?
DENIS BOISSIER : L’avez-vous vu se plaindre de sa servitude ? Jamais. L’avez-vous vu se pencher sur la misère du peuple ? Jamais. Il gagnait 12 000 livres annuelles à une époque où un ouvrier gagnait une quarantaine de livres par an pour un travail quotidien de onze heures.
GD : En ce temps-là les ouvriers était souvent nourris et logés.
DENIS BOISSIER : Le bel argument ! C’est vrai, les ouvriers étaient nourris et logés. Mais nourri et logé, Molière le fut aussi. Combien de bons repas et de beaux draps aux frais du roi ! Et oubliez-vous que pour son théâtre du Palais-Royal il n’a jamais eu à payer de loyer. L’avez-vous vu regretter que les autres comédiens, notamment ceux de l’Hôtel de Bourgogne, aient eu, eux, un gros loyer à payer ? Jamais.
GD : Que faites-vous des confidences si touchantes qu’il a faites sur sa condition d’homme à Chapelle et à je ne sais plus lequel de ses amis…
DENIS BOISSIER : … Le mathématicien Jacques Rohault … Mais toutes ces confidences, écrites en 1705, appartiennent à un genre littéraire très connu : celui du roman, et pas du meilleur. Rien de vrai, rien d’historique dans ces aveux confits en dévotion et élaborés par un Grimarest aux ordres de la censure royale. Avez-vous seulement vu Molière se préoccuper de ses compagnons ? Avez-vous lu quoi que ce soit où il parlerait de sa grande amie et partenaire de scène Madeleine Béjart ou de La Grange, ce comédien si discret dont les moliéristes disent qu’il fut son plus fidèle disciple ? Jamais.
GD : Les documents peuvent manquer…Par exemple, pour Pierre Corneille a-t-on des preuves de son intérêt pour les comédiens ?
DENIS BOISSIER : Plusieurs. Il a avoué qu’il a créé le personnage de l’Infante, dans Le Cid, uniquement pour donner un rôle à une excellente comédienne. Dans une lettre à l’abbé de Pure, il raconte comment il veut aider la carrière d’une jeune débutante de la troupe de Molière.
GD : Nous n’avons pas une seule lettre de Molière…
DENIS BOISSIER : Oui, quelle chance, n’est-ce pas ? Même un moliériste comme François Rey se dit « troublé » par l’égoïsme de Molière [« Il m’est pénible de lire ces préfaces, placets et autres avis au lecteur, dans lesquels pas une fois ce modèle de toute une profession n’écrit les mots "nous", "troupe", "comédiens". Il évoque ses amis, ses protecteurs, ses adversaires, jamais ses camarades. […] Que cet homme toujours dépeint comme généreux n’ait jamais fait imprimer ne fût-ce qu’un mot de gratitude à l’égard de ses camarades, a tout de même de quoi troubler. », Molière et le Roi, l’affaire Tartuffe, 2007, p. 373).
GD : Et cet égotisme, selon vous, est significatif ?
DENIS BOISSIER : C’est celui d’un bouffon du roi. Un bouffon du roi ne pense qu’à son maître et, par ricochet, qu’à lui-même. On comprend qu’Armande se soit vite lassée de lui et l’ait cocufié à tour de bras.
GD : Selon vous, Molière – enfin, plutôt Jean-Baptiste Poquelin, méritait ce qui lui est arrivé ?
DENIS BOISSIER : Sans doute la jeune Armande n’a-t-elle pas supporté les rapports exclusifs que Jean-Baptiste avait avec Sa Majesté. Poquelin, c’est l’ancêtre de nos cadres, de tous ces gens qui nuit et jour triment et se sacrifient pour le Big Boss et qui, sitôt qu’ils ont cessé d’être performants, sont jetés comme des jouets qui n’amusent plus. En 1670 Louis XIV se détourne de Molière et le congédie en 1672, année où il ne sera même plus sur la liste des pensionnés.
GD : J’avais raison : pauvre Molière !
DENIS BOISSIER : Pourquoi « pauvre » ? Molière fit fortune et sans doute est-ce ce qu’il voulait par dessus tout, comme avant lui son père et tous ses oncles paternels. Finalement, Molière n’a jamais aimé que le roi – même pas lui-même, seulement le roi. Dans Les Amants magnifiques il sert les intérêts de son maître en grondant celles qui douteraient de l’amour que Sa Majesté éprouvent pour elles. Avec George Dandin, il s’attaque à tous ceux qui veulent accéder à la noblesse pour échapper à l’impôt, ce qui déplaît fortement au roi et à son bras droit Colbert. Etc. C’est un fait patent que jamais Molière n’a défendu une noble cause ou n’a abordé un sujet par son côté positif. Il a tout vu par le prisme du roi, lequel était un esprit médiocre, ou par le biais du ridicule, ce qui n’est pas la bonne méthode pour se donner du cœur et de l’âme. Cette attitude de toujours tout ridiculiser est celle d’un bouffon de Cour. Ce n’est pas celle d’un écrivain, encore moins celle d’un grand écrivain, que dis-je ?… d’un génie incommensurable !
GD : Molière était donc pieds et mains liés au roi.
DENIS BOISSIER : Oui, et suspendu à ses lèvres. Or, un artiste digne de ce nom a besoin de son indépendance intellectuelle pour exister. Diriez-vous de Lully, qui fut le second bouffon du roi, qu’il avait une âme admirable ?
GD : Bien sûr que non ! Lully était un monstre d’égoïsme et un fieffé coquin, tout le monde est d’accord sur ce point.
DENIS BOISSIER : Eh bien, dites-vous que Molière et Lully, question immoralité, se ressemblaient comme deux larrons en foire. Les « deux Baptistes » disait-on. L’un comme l’autre écœuraient ceux qui les fréquentaient par l’étalage des privilèges qui étaient les leurs. Certes, à ce qu’il semble Lully montra un caractère pire que Molière, mais s’ils furent de si bons amis, et si longtemps, avant de devenir ennemis jurés, ce n’est pas sans raison.
GD : Je suis d’accord avec vous, voir en Molière un libre penseur et même un esprit libre est abusif.
DENIS BOISSIER : Pour ne pas dire hollywoodien ! D’ailleurs, les moliéristes le savent pertinemment puisqu’ils cachent cette vassalité le mieux qu’ils peuvent. Il y a heureusement des exceptions. Pour l’éminent Edouard Thierry, Molière et ses compagnons appartenaient au roi qui en disposait comme il voulait. [« la Troupe appartenait au Roi de fait comme de nom. Il la prêtait aux Parisiens, quand elle n’était pas retenue pour son service. C’était encore une générosité. », dans Le Moliériste, 1884, n° 61, p. 4]. Et le grand Gustave Michaut, comme je viens de vous le dire, était le premier à regretter certaines bassesses de Molière.
GD : Et c’est cette spécialisation de devoir rire de tout qui fait que le théâtre de Molière est carnavalesque ?
DENIS BOISSIER : Exactement. Les spectacles moliéresques sont tous tournés vers la dérision, le burlesque ou la satire. La seule chose que Molière ait jamais louée, c’est l’incomparable vertu inhérente à la nature même de son maître.
GD : Quand je pense au nombre de fois que j’ai pu lire que Molière a été le censeur des mœurs de son temps !
DENIS BOISSIER : Le XIXe siècle de Sainte-Beuve a tout tenté pour faire de Molière un moraliste et un censeur des excès de son époque. Mais c’est un mensonge politique, et même un pieux mensonge. Le grand historien Antoine Adam était catégorique sur ce point : « Les historiens qui refusent d’admettre ce goût de Molière pour la satire la plus personnelle, sont sans doute de belles âmes, mais ils se moquent de nous. » (Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, T. II, p. 812). C’est uniquement parce que les moliéristes de la Troisième République étaient eux-mêmes obsédés par la notion de "progrès", de "vertu bourgeoise" qu’ils ont fait de Molière, au prix de bien des contresens, un "homme du progrès", un "homme de la mesure et de la raison".
GD : Comme on peut encore le lire dans les manuels scolaires : "Molière, l’honnête homme"…
DENIS BOISSIER : Ce qui, traduit en langage moderne, signifie l’homme des compromis et de l’hypocrisie sociale. Mais même ainsi comprise, cette expression qui fit fortune au XVIIe siècle est fausse. C’est faire du bouffon du roi un moraliste ! Il y a là une belle exagération et les contemporains de Molière auraient bien ri de notre candeur ! La moralité d’ailleurs n’était pas à l’ordre du jour en 1660. La moralité ne viendra qu’après que se sera imposée la dévotion comme régime politique. Heureusement, de moins en moins de spécialistes voient en Molière un "honnête homme". Les moliéristes eux-mêmes essaient d’être moins naïfs que leurs vénérés maîtres. Certains croient même découvrir en Molière un élément permanent de perturbation sociale.
GD : Ce qui rejoint votre point de vue.
DENIS BOISSIER : Tout à fait. Un bouffon du roi n’a pas pour « emploi » de donner des bons points de conduite à ses contemporains, mais de court-circuiter toute pensée qui se veut soit la norme soit l’exception. Dans la pensée d’un bouffon du roi, il n’y a qu’une pensée : celle du roi. Les moliéristes disent que Molière fut un moraliste. Mais en disant cela, ils oublient que Molière n’était pas un homme de cabinet, un érudit en chambre. C’était un régisseur de théâtre et un directeur de troupe. J’en appelle au bon sens…Quelle entreprise commerciale a-t-elle jamais eu l’ambition de travailler pour le bien de l’humanité ou dans le but de corriger ses contemporains ? Le prétendre deux cents ans plus tard à propos de Molière, c’est faire preuve d’une hypocrisie redoutable !
GD : Que Molière ait été un entrepreneur de spectacles, plusieurs contemporains de Molière l’ont dit, il me semble.
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Prenez l’auteur des Observations… Il témoigne que ce qui intéresse Molière ce ne sont pas les questions de morale mais, par ses scandales, de faire le plus d’entrées possible [« Je connais son humeur, il ne se soucie pas qu’on fronde ses pièces, pourvu qu’il y vienne du monde. », Les Observations (1665) du sieur de Rochemont (pseudonyme)]. Cela dit, l’hypocrisie aidant, ne nous étonnons pas que son bras droit La Grange ou, plus tard Charles Perrault, qui fut un notoire propagandiste de Louis XIV, aient laissé croire à partir de 1682, parce qu’au fond cela arrangeait leurs affaires, que Molière avait l’ambition de corriger ses contemporains... Comme si un farceur pouvait avoir en tête une telle idée ! D’ailleurs, Molière lui-même s’est-il corrigé de quoi que ce soit ? Jamais.
GD : Les moliéristes vous diront que Molière n’avait pas à se corriger, puisqu’il était parfait. Mais sans doute avez-vous raison : la part de l’homme d’affaires chez Molière était prépondérante puisque, dans un milieu hostile et rempli d’adversaires, il a si bien su faire fortune.
DENIS BOISSIER : De la même façon qu’un crocodile n’est pas un animal de compagnie, le bouffon du roi n’est pas un moraliste ; c’est un prédateur, c’est la mâchoire du roi lorsque celui-ci veut rire aux dépens d’autrui. Grâce aux institutions et aux infrastructures qui portaient aux nues Sa Majesté, Molière est devenu, de son vivant, une sorte de mythe urbain. Or un tel mécanisme n’a jamais touché que trois sortes de professions, si je puis dire : 1) certains héros comme Roland, Bayart ou Jeanne d’Arc. 2) certains rois comme Charlemagne ou Louis XIV. 3) leurs bouffons, comme Triboulet, Angoulevent ou Molière. Le XVIIe siècle, parce qu’il était encore rempli des traditions du Moyen Age, avait besoin du bouffon du roi, comme il avait besoin d’un roi glorieux. Louis XIV a compris cela, comme il a compris trois autres choses fondamentales : au niveau de la Cour : l’importance de la Danse et des fêtes comme spectacles de l’harmonie du royaume ; au niveau du pays : l’importance de la notion de progrès et de profit dans la mentalité bourgeoise ; au niveau du peuple : l’importance du rire et des scandales comme opium du peuple.
GD : Diriez-vous que Louis XIV était déjà, par certains côtés, un homme "moderne" ?
DENIS BOISSIER : C’est indéniable. Notre société est obsédée par le ludique, la plupart de nos concitoyens ne pensent qu’à eux-mêmes et font de l’égoïsme un mode de vie, ou plutôt de survie. Une telle mentalité descend en droite ligne de l’absolutisme de Louis XIV, lequel n’a jamais recherché que ses plaisirs. Toutefois, en tant que monarque Louis XIV a eu l’intelligence instinctive de concilier, aussi souvent que possible, son égoïsme avec les intérêts de la France. C’est de cette façon, par exemple, qu’il a lancé, pour le bien de tous, le concept d’urbanisation lorsqu’il a entrepris pour sa seule satisfaction l’interminable chantier régional que fut la ruineuse réalisation du château de Versailles. Louis XIV avait une mentalité de producteur mégalomane. Un producteur absolu comme un dit un roi absolu. S’il l’avait pu, il aurait créé la télévision et les magazines people. D’ailleurs, avec Molière et Saint-Aignan, il s’en est beaucoup rapproché…
GD : Diriez-vous que Louis XIV redoutait le peuple autant qu’il craignait les grands seigneurs de la Fronde ?
DENIS BOISSIER : Il se méfiait tellement des Parisiens que durant son long règne il n’est allé que vingt-quatre fois à Paris.
GD : Vous pensez que c’est cette peur du peuple qui lui a fait être un si vigilant protecteur de Molière ?
DENIS BOISSIER : Bien des faits tendent à le prouver. Dès qu’un livre est publié contre Molière, Louis XIV le fait aussitôt interdire. C’est arrivé au moins deux fois : la première fois avec l’ouvrage de l’abbé Roullé, membre éminent de la Sorbonne ; la seconde fois avec le pamphlet de Le Boulanger de Chalussay. Le roi étouffe dans l’œuf toute critique envers son bouffon.
GD : Il y a aussi cette accusation d’inceste…
DENIS BOISSIER : Oui, et ce n’est pas rien qu’une accusation portée publiquement jusque devant le roi ! Il faut que l’accusateur soit particulièrement sûr de lui. Eh bien, en 1663, Louis XIV n’écoute même pas l’accusation d’inceste contre Molière.
DG : Pourtant rien n’était plus grave à cette époque. On risquait le bûcher !
DENIS BOISSIER : Mais Louis XIV ne réagit pas. La moralité n’est pas son fort, lui-même a été accusé d’inceste avec l’épouse de son frère [la charmante Henriette d’Angleterre qui fut sa maîtresse], et il a trop besoin de Molière pour ne pas le mettre à l’abri des petits tracas de la vie quotidienne. Il sait que Molière, d’une certaine façon, est son seul ambassadeur auprès des Parisiens. Il sait aussi qu’on tient le peuple avec du pain – souvent très peu – et avec beaucoup de bouffonnerie et de carnaval. C’est le panem et circenses des Romains version Grand Siècle. Grâce à Molière, Louis XIV peut livrer en pâture certains de ceux qui le côtoient afin de nourrir le peuple affamé. Le scandale et la moquerie peuvent servir de nourriture… et, politiquement parlant, de soupape de sécurité. Molière et sa troupe, ce sont les Guignols de l’Info de l’époque.
GD : La nature carnavalesque du théâtre moliéresque est niée par les moliéristes.
DENIS BOISSIER : Il y a tout de même des exceptions notables, je pense en particulier aux dix-septiémistes Claudine Nédélec ou Guy Spielmann ou, bien avant eux, à Gustave Lanson qui fut le premier à affirmer qu’il fallait étudier le théâtre moliéresque sous l’angle de la farce. En 1901 une telle lucidité fit scandale. Pourtant, tout le théâtre de Molière a sa source, sa signification et son débouché social dans l’esprit carnavalesque.
GD : D’un côté, la Basoche avec Corneille [sur la Basoche et ses liens avec Molière voir Troisième dialogue]. De l’autre, le Carnaval.
DENIS BOISSIER : Oui, et au-dessus, un roi attentif à ne jamais s’aliéner le peuple et à toujours restreindre l’arrogance de la noblesse. Vous avez là les trois composantes essentielles du théâtre moliéresque, ce théâtre du ridicule qui est, historiquement, la dernière floraison du théâtre des Enfants-sans-souci des Halles de Paris, quartier où sont nés et où ont vécu Molière et Madeleine Béjart [sur les Enfants-sans-souci et leurs liens avec Molière voir Troisième dialogue].
GD : Nous revoici presque au Moyen Age.
DENIS BOISSIER : Quand je vous disais, dans notre premier dialogue, que le XVIIe siècle ne pouvait pas être compris sans le substrat moyenâgeux qui le structure… La longue période du carnaval constituait l’univers et le mode de vie des troupes de farceurs. La troupe dirigée par Madeleine Béjart et Molière était une troupe de farceurs à l’italienne, sa composition le montre bien. Que Molière ait été choisi par Louis XIV pour être l’intendant de ses fêtes quasi hebdomadaires a accentué cette spécialisation, voilà tout. Pour le roi, Molière s’est transformé en bouffon permanent, et il est devenu pour la Cour l’équivalent de Momus, le bouffon de Jupiter. D’ailleurs, ses contemporains ont plusieurs fois comparé Molière à Momus, car personne ne s’illusionnait sur son emploi d’intendant des plaisirs païens du roi. La couverture d’une édition de son théâtre complet parue en Belgique en 1694 le présentera d’ailleurs sous l’aspect d’un satyre piétinant les livres, sinon du grand dieu Pan lui-même.
GD : Le dieu qui perturbait l’équilibre du monde civilisé si cher aux anciens Grecs.
DENIS BOISSIER : Eh bien, dites-vous que les Français de 1670 avaient les mêmes espérances que les Grecs d’Aristophane, et ils souhaitaient comme eux l’harmonie sociale. Voilà pourquoi, bien qu’un bouffon soit inhérent à la fonction royale, cela exaspérait l’élite chrétienne que Louis XIV laisse à son bouffon toute liberté de remplir son « emploi ».
GD : Un emploi pourtant salutaire.
DENIS BOISSIER : Mais dangereux.
GD : Heureusement pour ceux qui aiment l’ordre que le carnaval ne dure que le temps d’une parenthèse.
DENIS BOISSIER : Le problème avec un bouffon du roi, c’est qu’il déstabilise en permanence. Louis XIV avait chargé Molière d’être à plein temps le maître- d’œuvre d’amusements en tous genres : théâtre, ballets, mascarades, carrousels, soirées nocturnes, fêtes et cérémonies, sans parler des pièces qu’il présentait aux Parisiens lorsque le roi lui en laissait le loisir. Toute sa carrière parisienne, Molière l’a passée à satisfaire les caprices ou les exigences de son maître. Comme on dit : les deux font la paire. Molière et Louis XIV, par la force des choses et le poids des traditions, apprirent à danser ensemble et à savoir sur quel pied danser. Ce n’est pas une figure de style, c’est l’un des privilèges du bouffon du roi que de danser avec le roi à l’occasion de ballets prestigieux où, symboliquement, l’harmonie du royaume est en jeu. Et aussi de pouvoir s’asseoir à la table du roi, ce que n’a jamais obtenu aucun grand seigneur. C’est la fameuse anecdote de l’En-cas qui contrarie tellement les moliéristes.
GD : Des prérogatives qui devaient susciter de grandes jalousies, j’imagine...
DENIS BOISSIER : Au point que Molière fut agressé physiquement et faillit plusieurs fois être bastonné. Mais Louis XIV veillait sur lui de la même façon que Louis XII veillait sur Triboulet.
GD : Vous m’avez dit que presque toutes les pièces de Molière avaient été créées pour le carnaval.
DENIS BOISSIER : Oui, Molière régnait sur le carnaval, et d’une certaine manière le carnaval fut sa prison. L’interprétation "classique" que l’Université donne de son théâtre, le fait même qu’elle appelle « chefs-d’œuvre » ce qui ne fut pour ses contemporains que des farces et des amusements (sur ce point tous les témoignages sont unanimes) fausse la signification des rares pièces sérieuses qu’il fut amené à mettre en scène. Car même dans ces grandes pièces, il n’y a rien de "classique" : nous sommes toujours dans l’obscène théâtre de tréteaux des XVe et XVIe siècles.
GD : Pourquoi obscène ?
DENIS BOISSIER : Aujourd’hui aucun metteur en scène n’oserait montrer ce que Molière offrait à son public. Pour en avoir une toute petite idée, regardez dans le film de Gérard Corbiau, Le Roi danse [2000], la séquence où l’on voit Molière dans le Malade imaginaire sonner sa servante Toinette et, tout en faisant drelin-drelin, secouer son sexe à travers sa longue chemise de nuit. Aujourd’hui nous édulcorons le théâtre moliéresque, mais Molière a été plusieurs fois accusé d’obscénité. Dans Les Précieuses ridicules Mascarille montre aux spectateurs ses fesses. D’ailleurs quand Louis XIV pensionna son amuseur comme s’il était un Pierre Corneille ou un Jean Chapelain, ce fut un tollé. Mais le roi se fichait de ce qu’on l’on pouvait dire. Il payait royalement Molière pour qu’il lui offre la meilleure distraction possible. Molière avait carte blanche et cela devait flatter le jeune monarque de savoir que Corneille, le grand Corneille dont son père était si fier, travaillait en coulisses à l’excellence des grands spectacles moliéresques.
GD : Louis XIV semble n’avoir jamais réellement apprécié Corneille.
DENIS BOISSIER : Les moyens intellectuels pour l’apprécier lui manquaient. Il a donc trouvé légitime de rabaisser sa superbe d’auteur. Voilà pourquoi il lui demanda publiquement, un jour de 1659, de travailler « à ses divertissements ». Corneille dit que le roi employa le terme « divertissements » [dans la Préface d’Œdipe]. Voilà qui ressemble peu à l’auteur d’Horace et bientôt d’Othon, ne trouvez-vous pas ? Mais le roi a très bien su se faire comprendre de Corneille qui, en fidèle serviteur, lui obéira scrupuleusement. Avec Molière, Corneille ne travaillera qu’aux divertissements du roi, que ce soit en solo, avec La Toison d’or [pièce à machines arrangée pour le mariage de Louis XIV], ou avec Molière pour tous les autres spectacles prestigieux qui seront donnés devant la Cour, notamment Psyché [1671].
GD : Corneille a-t-il été flatté de travailler aux « divertissements » du roi ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. C’est un immense honneur. Et une chance inespérée de pouvoir être agréable au roi, même si pour cela il doit rester en coulisses.
GD : Cela ne le gênait pas ?
DENIS BOISSIER : D’abord, Corneille était un homme d’un tempérament discret, et même secret. Ensuite, il savait qu’auprès du Roi-Soleil, tout le monde devait rester dans l’ombre. C’est tellement vrai que dans les spectacles de comédies-ballets, quel est le seul nom qui apparaît sur les programmes ? Celui de Louis XIV.
GD : J’imagine que cela force à l’humilité.
DENIS BOISSIER : Par ailleurs, Corneille savait qu’écrire pour le bouffon du roi était un privilège car seul le bouffon du roi a les qualités requises pour amuser son maître. Il a donc pour lui l’oreille du roi, et toute sa bienveillance. Nous avons maints témoignages que Sa Majesté aimait rire à gorge déployée à la vue des grimaces de son bouffon.
GD : Dans ces conditions, pourquoi Molière a-t-il donné des pièces prestigieuses comme Amphitryon ou Psyché ?
DENIS BOISSIER : Parce que Louis XIV a exigé des spectacles de prestige pour illustrer devant toute la Cour sa gloire de monarque à nul autre pareil. Sans cela, en effet, nous n’aurions presque jamais eu la preuve stylistique que Corneille a été le collaborateur de Molière ou plutôt, comme l’écrivait l’écrivain François Davant, que Molière fut « le second » de Corneille et son « associé ».
GD : Ce sont ses termes ?
DENIS BOISSIER : Très précisément, dans sa quatrième lettre à Pierre Corneille, datée de mars 1673. Non seulement c’était une chance inespérée pour Corneille de continuer une carrière arrêtée, faute de public, en 1652, mais il était tout naturel pour celui qui était encore le premier poète de France d’unir son talent à celui du bouffon du roi pour produire les plus beaux spectacles, et ainsi contenter Sa Majesté qui exigeait le concours des meilleurs artistes pour espérer ne pas être déçue. Et puis, disons les choses comme elles sont : des écrivains ont toujours travaillé dans l’ombre du bouffon du roi, dans l’unique but de servir la politique royale. En bon traditionaliste, Corneille n’a pu que trouver logique que le meilleur des auteurs travaille pour le meilleur des rois.
GD : Leur collaboration n’est toutefois avérée que pour Psyché qui date de 1671.
DENIS BOISSIER : Nous sommes avec Psyché au cœur de l’Affaire Corneille-Molière. Son Avertissement au Lecteur est le seul document qui fait allusion à leur association. Pourtant, lorsque la pièce fut éditée ce fut au bénéfice du seul Molière, l’ « illustre auteur ». Devons-nous alors considérer que leur collaboration commence et s’arrête à Psyché, ou trouver raisonnable, au vu des nombreux indices ainsi que des pratiques théâtrales de leur temps, qu’ils aient pu travailler en commun de nombreuses fois ? Si pour vous, seuls comptent les documents, vous nierez leur collaboration régulière. Si vous préférez l’enquête historico-critique et la cohérence sociologique vous serez vite convaincu que ces deux artistes se sont mutuellement et fréquemment aidés.
GD : Je pense que les documents ne sont pas et ne font pas, à eux seuls, toute l’Histoire. De plus, vous avez tout de même décrypté le témoignage de Boileau et celui de d’Aubignac, témoignages qui jusqu’ici n’avaient pas été lus avec la bonne grille [lire dans le présent site « Boileau, d’Aubignac et La Fontaine dévoilent la collaboration Corneille-Molière »]. Et deux témoignages qui se répondent et se corroborent, ce n’est pas rien !
DENIS BOISSIER : Et je vous ferai remarquer que ceux qui ne veulent connaître l’Histoire que par les documents qu’elle nous laisse et qui, pour cela, croient devoir refuser nos thèses, sont en contradiction avec leurs propres principes puisqu’ils nous disent que Molière a écrit ses pièces alors que nous ne possédons aucune ligne de sa main prouvant qu’il était réellement capable d’écrire correctement.
GD : Son nom figure tout de même sur la couverture des pièces qu’il a publiées.
DENIS BOISSIER : Cela ne signifie rien. Le monde de l’édition du XVIIe siècle était encore plus mystificateur que le nôtre. Combien de romans écrits par ceux qui ne les ont pas signés. Combien de pièces publiées sans qu’apparaisse le nom de leurs auteurs, comme l’atteste Psyché. Ne commettons pas la négligence de nous faire plus naïfs que nous ne le sommes, sous le prétexte que nous n’avons pas envie de voir la réalité en face. De son temps, le nom de Molière a été imprimé sur plusieurs pièces qui ne sont pas de lui, comme par exemple L’Avocat savetier. De même, le nom du célèbre comédien Montfleury orne l’édition de son théâtre, mais nous savons aujourd’hui que ces comédies sont l’œuvre de son fils, basochien comme Pierre Corneille. Dois-je citer aussi le comédien à succès Villiers ? Il a signé plusieurs pièces célèbres. Ces pièces, les spécialistes les ont rendues à leur véritable auteur : Donneau de Visé.
GD : Lequel fut un collaborateur de Molière.
DENIS BOISSIER : Tant et si bien que Molière fut le prête-nom de Donneau de Visé.
GD : Son prête-nom ?
DENIS BOISSIER : La Veuve à la mode et Zélinde, qui sont des comédies de Donneau de Visé, ont été éditées sous le nom de Molière. Et ce qui montre bien qu’il y a eu entente entre les deux intéressés, c’est que nous n’avons jamais eu écho du moindre désaccord entre eux. Au contraire, leurs liens se sont resserrés.
GD : Il faut donc rendre à Donneau de Visé ce qui appartient à Donneau de Visé.
DENIS BOISSIER : C’est déjà fait… Les moliéristes lui ont tout rendu. Ils ne veulent pas que l’arriviste De Visé nuise à l’image de marque de Molière « parfaitement honnête homme ».
GD : …Et à Corneille ce qui appartient à Corneille…
DENIS BOISSIER : C’est là que manquent les bonnes volontés.
GD : Vous êtes là pour les encourager !
DENIS BOISSIER : Rendre à Corneille ce qui lui appartient est la première étape du procès posthume de Molière, à condition que l’on accepte de se débarrasser définitivement de ce que l’historien Raymond Picard appelait le « mythe de Louis XIV », mythe avec lequel on ne cesse de s’illusionner.
GD : Il ne fait donc aucun doute pour vous que Molière fut un « entrepreneur de spectacles », et non un auteur au sens que nous donnons aujourd’hui à ce mot, que Molière fut le bouffon du roi et non un moraliste persécuté, et qu’il est le fruit des siècles précédents et non le premier des écrivains modernes.
DENIS BOISSIER : Je me contente de porter sur Molière le même jugement que ses contemporains. Ils l’ont bien connu, ils ne peuvent pas tous s’être trompés. Molière fut le grand perturbateur de son temps. D’ailleurs, voyez les rôles qu’il joue dans les prestigieux spectacles pour la Cour : toujours des rôles d’excentriques ou de bouffons et même, dans un ballet, celui du dieu Pan en personne ! Ce n’est pas parce que la société française a, avec une révolution sanglante, renversé sa hiérarchie des valeurs intellectuelles et morales que l’historien moderne doit se leurrer. Et ce n’est pas parce que l’adage veut que "le dernier qui parle a toujours raison" que nous avons forcément raison sur les intellectuels du XVIIe siècle.
GD : Oui, il est certain que chaque siècle a ses préjugés.
DENIS BOISSIER : Mais préjugé n’est pas loi et bien que les moliéristes soient très largement majoritaires dans le monde des dix-septiémistes, tous les spécialistes ne s’aveuglent pas sur la prétendue "modernité" de Molière et ne commettent pas l’erreur de transporter nos préjugés au cœur du XVIIe siècle, ni de considérer comme infamante l’assimilation de Molière à un bouffon du roi. Le célèbre Michelet par exemple a clairement affirmé que Molière a été « un puissant bouffon ». Pour André Bazin, grande autorité des moliéristes de la Troisième République, Molière était « un bouffon émérite ».
GD : Ce sont ses termes ?
DENIS BOISSIER : Je peux vous l’assurer [« Les dernières années de Molière », La Revue des Deux-Mondes, tome 21, 15 janvier 1848, p. 186].
GD : Cette définition chez un moliériste a de quoi étonner.
DENIS BOISSIER : Uniquement si vous jugez la fonction de bouffon du roi d’un point de vue moderniste. Considérer le XVIIe siècle comme le siècle "classique" dans le sens de "grand et authentique" est, comme j’ai eu l’occasion de le dire dans notre premier dialogue, une tricherie qui flatte notre vanité de petits-bourgeois. Et voir en Molière le premier des auteurs modernes est un contresens historique. Cette double erreur de perspective a pour conséquence d’enlever au théâtre moliéresque sa véritable valeur sociologique et d’affaiblir son témoignage politique.
GD : Selon vous, faire du théâtre moliéresque une œuvre littéraire, c’est s’enlever la possibilité de l’appréhender pour ce qu’il fut réellement.
DENIS BOISSIER : Oui, un théâtre carnavalesque joué pour le roi, avec la bénédiction du roi et les applaudissements d’un public à quatre-vingts pour cent analphabète, mais parfaitement rôdé aux facéties des bouffons publics et aux sacro-saintes règles du carnaval.
GD : Il est tout de même surprenant de trouver en plein XVIIe siècle intacte la fonction de bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Pourquoi ? Le XVIIe siècle est l’héritier du XVIe siècle. Louis XIII avait son bouffon du roi en la personne du danseur-bouffon Marais. Louis XIV a eu le sien en Molière, voilà tout. Comme je vous l’ai dit, il est significatif que le premier acte d’autorité que fit Louis XIV en accédant au pouvoir fut de créer l’Académie de danse et, dans le même temps, de se choisir un bouffon. Ces deux décisions montrent combien Louis XIV était attaché aux traditions héritées de ses ancêtres et plus particulièrement de son père qui aimait s’entourer de bouffons dont le célèbre Scaramouche.
GD : Qui sera le maître et le modèle de Molière avec lequel il partagera la scène du Petit-Bourbon puis celle du Palais-Royal.
DENIS BOISSIER : Exactement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que Louis XIII assista en 1621, le même mois, à dix représentations d’un spectacle de Scaramouche et d’Arlequin, et le mois suivant il y assista quatorze fois. Devenu roi, son fils fera la même chose, mais avec Molière.
GD : Selon vous, Louis XIII prépare Louis XIV comme Scaramouche prépare Molière.
DENIS BOISSIER : C’est évident. Sous cet angle, Louis XIV est bien le fils de celui qui, comme l’écrivait Georges Mongrédien, « goûtait fort les vieilles farces gauloises ». Puisque Louis XIV, enfant, adorait rester en compagnie du bouffon Scaramouche, il est naturel et logique qu’il ait choisi Molière, une fois seul maître à bord.
GD : Si je vous ai bien compris, avoir à ses côtés un bouffon du roi était pour Louis XIV faire preuve d’autorité.
DENIS BOISSIER : Faire preuve d’autorité - et faire preuve d’ironie. Car l’ironie, dans la bouche d’un roi ou de son bouffon, est la plus cruelle des armes de Cour. C’était aussi s’opposer à sa mère et à son cousin Conti, et à leur parti qui prônait la vertu et les bondieuseries. Son père avait comme bouffons Marais et Scaramouche, Louis XIV a choisi Lully et Molière.
GD : Mais, précisément, pourquoi Molière ?
DENIS BOISSIER : Parce qu’il est arrivé au bon moment et que c’est lui qui, en octobre 1658, a su le faire rire avec une farce bien gauloise… Par ailleurs, il lui avait été présenté, ironie du sort, par la reine mère qui voulait offrir Molière et sa troupe à son second fils, Monsieur, frère du roi.
GD : Sans oublier que Corneille se portait garant de son « Moliere ». Vous croyez que la garantie de Corneille a beaucoup compté ?
DENIS BOISSIER : Non. Louis XIV se moquait bien des prétentions poétiques de Corneille… En revanche, il a dû être sensible au fait que les oncles de Jean-Baptiste Poquelin étaient des financiers et bailleurs de fonds, en affaires avec Colbert.
GD : Sans doute aussi Molière avait-il l’avantage d’être de bonne bourgeoisie, puisque fils de Tapissier du roi.
DENIS BOISSIER : Et aussi qu’il avait ce qu’ont eu rarement les bouffons du roi dès le premier jour : une troupe bien rôdée, et prête à servir Sa Majesté.
GD : Cela fait beaucoup d’atouts.
DENIS BOISSIER : Grâce à ces atouts, Molière a pu assumer les trois principaux aspects de la fonction de bouffon du roi : 1) faire rire son maître… 2) organiser les spectacles royaux… 3) influencer le peuple. Pour la bouffonnerie et la pantomime, Molière n’avait besoin que de lui. Pour les farces et les comédies, il avait sa troupe. Pour les grandes satires sociales, Molière pouvait compter sur Pierre Corneille.
DG : Et vous pensez qu’en acceptant de Louis XIV la fonction de bouffon du roi, Molière avait vraiment conscience de ce qu’il faisait ?
DENIS BOISSIER : En 1660 tout le monde est encore parfaitement imprégné des traditions de la Cour de Louis XIII. Chaque grand seigneur sous Louis XIV a son bouffon attitré. En devenant celui du roi, Molière sait qu’il va nécessairement être le plus célèbre de tous les bouffons et farceurs de France. Et c’est ainsi que le définit l’écrivain Baudeau de Somaize : « le premier Farceur de France ».
GD : Le règne de Louis XIV prolonge donc celui de Louis XIII.
DENIS BOISSIER : Il le prolonge et le développe. Louis XIV intensifie la politique de son père en faveur de la bourgeoise montante. Par tendresse envers son père, Louis XIV fait d’un modeste logis en brique, pierre et ardoise, qui était le rendez-vous de chasse favori de son père, le château de Versailles. Oui, Louis XIV lui succède en bien des points. Les mœurs, quant à elles, n’ont guère évolué. Corneille en est la preuve, lui qui est à la fois une gloire du règne de Louis XIII et un artiste de Louis XIV. Les vrais changements de mœurs débuteront vers 1690. Mais en 1660, nous sommes encore, pour la perception qu’a le peuple du monde dans lequel il vit, dans un climat social identique à celui du siècle précédent. Voilà pourquoi, pour ses contemporains, Molière n’est qu’un farceur issu des tréteaux de province qui doit au roi tout « son bonheur » : c’est, nous l’avons vu, l’expression que l’on emploie. Pour tout le monde alors, le roi a choisi Molière pour être le « bouffon du temps », ici je cite Montfleury fils qui connaissait bien Molière. De là viennent, par le biais du peuple, toutes les anecdotes légendaires qui ponctuent sa carrière et, revers de la médaille, toutes ces insultes et cette haine de la part de l’élite, insultes et haine qui ont continué même après sa mort ainsi qu’il arrive souvent aux bouffons du roi, lesquels entrent de façon posthume dans la légende.
DG : Qu’est-ce que le peuple aimait dans Molière ?
DENIS BOISSIER : Le peuple se reconnaît toujours dans le bouffon du roi, quel qu’il soit (n’oubliez pas que celui-ci est toujours issu du peuple). Les Parisiens ont donc adopté Molière parce qu’il les faisait rire en s’en prenant aux marquis et aux Précieuses, ainsi qu’aux médecins, dont il était alors beaucoup question. Mais même parmi le peuple, bien des gens l’ont détesté parce qu’il s’attaquait aussi à l’autorité des parents, à la religion chrétienne, aux préceptes moraux qui leur venaient de leurs pères. On avait alors un grand respect des traditions et Molière, tout comme Louis XIV, commençait à détruire l’esprit féodal qui jusqu’ici avait fait la grandeur de la France. Voilà pourquoi L’Eglise et la grande bourgeoisie, les intellectuels, la plupart des princes et plus encore certains proches du roi, ont combattu Molière ou, pour être plus exact, ont répondu aux sarcasmes du bouffon du roi. Mettez-vous à leur place : ne pouvant critiquer ouvertement le roi, il leur restait l’exutoire de maudire le bouffon du roi qui était son porte-parole. Lorsque l’abbé Roullé condamne Molière à brûler en enfer [dans Le Roi glorieux au monde ou Louis XIV le roi le plus glorieux de tous les rois du monde, 1664] et recommande dès à présent les flammes d’un bûcher bien réel, il parle au nom de tous ceux que l’on appelle aujourd’hui la "majorité silencieuse".
GD : Molière instrument du roi, voilà qui va déplaire à beaucoup !
DENIS BOISSIER : D’autres que moi l’ont pourtant dit. Par exemple, le dix-septiémiste Philippe Beaussant qui écrit qu’il fut son « porte-parole officieux » [« Que Molière ait joué le rôle d’un porte-parole détourné, officieux, d’une pensée politique de Louis XIV semble aujourd’hui une évidence. […] Il faut noter l’incessante convergence de ce qui est dit dans chacune de ses comédies avec la pensée du roi sur le sujet traité : je crois bien qu’on ne trouverait pas une seule exception. », Louis XIV artiste, 1999, p. 143]. Et bien avant lui l’historien et érudit Charles Nodier aurait voulu que l’on donnât au théâtre moliéresque le titre de Œuvres de Molière et de Louis XIV car, selon lui, « cela serait juste et vrai. »
GD : Vous dites qu’une grande partie de la noblesse n’aimait pas Molière, pourtant la Cour riait à ses spectacles.
DENIS BOISSIER : Bien obligé pour des courtisans de rire aux spectacles de Molière puisque tel était le bon plaisir de Sa Majesté. Mais les princes détestaient Molière parce qu’en servile factotum de son maître, il annonçait le règne des financiers et des marchands et qu’il prônait plus souvent l’esprit bourgeois mercantile que le code d’honneur chevaleresque. L’élite exécrait Molière parce qu’il incarnait la face obscure et bourgeoise du Roi-Soleil. Il était le plus zélé de ceux qui entraînaient Louis XIV à se méfier du système féodal. Jean-Baptiste Poquelin, fils et petit-fils de boutiquiers, a toujours caressé le roi dans le sens du poil, et Louis XIV n’avait pas le poil mérovingien, mais bourgeois. D’ailleurs, qui sait quel était le vrai géniteur de Louis…
GD : Il est vrai qu’on l’appelé aussi Dieudonné, et qu’on a tellement désespéré de sa naissance qu’elle en parut soudain miraculeuse. Une analyse génétique pourrait peut-être expliquer bien des choses.
DENIS BOISSIER : Et une analyse psychanalytique ne serait pas superflue pour démêler ses rapports avec Molière, rapports basés sur la capacité qu’ont le rire et la satire de déstabiliser l’ordre établi.
GD : Même sans psychanalyse, nous savons qu’à cause de divers traumatismes survenus durant la Fronde, donc durant toute son enfance, Louis XIV a appris à redouter les princes qui l’entouraient.
DENIS BOISSIER : Eh bien, grâce à Molière, il a pu agir sur eux par le biais de la dérision. C’est en cela que Molière fut un parfait bouffon de Cour. En une phrase comme en cent, Molière fut pour Louis XIV ce que Triboulet fut pour Louis XII.
GD : Mais Louis XIII ne fut pas le Roi-Soleil. Et Triboulet n’a pas eu de Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : En effet. Et c’est le seul Molière que la France a élu pour gloire nationale.
GD : On prétend souvent que notre propre époque est "bouffonne". Dans ce cas, nous devrions accepter sans trop rechigner que Molière, notre « gloire nationale », ait été un bouffon.
DENIS BOISSIER : Dans un certain sens c’est ce qui est en train de se passer, même si, à cause de la Comédie-Française et de la Sorbonne, personne n’ose encore publiquement assimiler Molière au bouffon du roi. Par exemple, pourquoi la couleur verte est-elle aujourd’hui taboue au théâtre ? Parce qu’elle était celle des bouffons de Cour, et que le fait que Molière soit aujourd’hui le saint patron du théâtre français conduit inconsciemment les acteurs à redouter cette couleur qui fut pourtant la préférée de Molière, et celle qu’il arborait sur scène.
GD : Sans doute la mémoire collective a-t-elle fait un lien entre cette couleur et la triste condition du bouffon du roi ? Dans le cas de Molière, le fait qu’il soit mort sur scène, enfin presque, aura accentué ce lien.
DENIS BOISSIER : En effet, Molière n’est pas mort sur scène, mais là encore le mythe est plus fort que la vérité historique.
GD : Parce que c’est plus spectaculaire.
DENIS BOISSIER : Pas uniquement pour cela. Il est probable que l’imaginaire collectif est sensible au fait que, ce soir-là, sur une scène de théâtre, Molière a en quelque sorte expié sa condition de « premier fou du roy », comme le définit son contemporain Le Boulanger de Chalussay.
GD : Vous pensez que le public a ressenti ainsi la mort de Molière ?
DENIS BOISSIER : Oui. Après avoir ri des dévots avec Tartuffe, après avoir provoqué Dieu avec Dom Juan, Molière avec Le Malade imaginaire se moquait de la mort elle-même. Pour beaucoup c’en était trop. On ne peut pas toujours rire de tout et bien des spectateurs virent dans cette mort soudaine une intervention divine. Les épigrammes qui circulèrent sur sa mort attestent que les contemporains y ont vu un châtiment mérité.
GD : C’est étonnant à quel point nous avons oublié cet aspect des choses… Le Molière des temps modernes n’a vraiment rien de commun avec celui du règne du Roi-Soleil.
DENIS BOISSIER : Du fait que Molière est devenu un mythe, n’importe qui aujourd’hui peut dire tout et son contraire sur lui, c’est ce que font d’ailleurs ses dévots à longueur de livres. Au final, comme le constatait le moliériste Georges Toudouze, « il existe à présent plusieurs Molière, dont aucun n’est le vrai » [Molière, Bourgeois de Paris et Tapissier du Roy, 1946, p. 9].
GD : Et tout cet amalgame de faits historiques mal compris, qui sont devenus des légendes, explique pourquoi Molière est aujourd’hui si idolâtré.
DENIS BOISSIER : C’est certain. Voyez ce qui s’est passé pour un autre mythe historique… Zorro. Le personnage de Zorro, si populaire et si sympathique, a réellement existé : c’était un bandit californien aimé du peuple. A la façon dont le bandit Zorro s’est changé, grâce à des romans et des films, en un héros justicier, on comprend pourquoi le bouffon du roi de Louis XIV, à cause de la politique chrétienne d’un Louis XIV vieillissant, et grâce à la propagande des philosophes des Lumières puis celle des fonctionnaires de la Troisième République, s’est métamorphosé en un héros de théâtre et de cinéma.
GD : Il s’est passé la même chose avec Triboulet. C’était un farceur de bas étage qui s’est changé en un poète plein de panache grâce à la magie de Victor Hugo et celle de ses confrères romantiques en diable.
DENIS BOISSIER : En effet : Triboulet, qui n’était pas un intellectuel, c’est le moins que l’on puisse dire, fut de façon posthume crédité de quatre cents moralités.
GD : Déjà ce penchant dont vous parliez, de faire du bouffon du roi une sorte de moraliste…
DENIS BOISSIER : Oui, cela part d’un bon sentiment, mais terriblement naïf. C’est avec Triboulet qu’on a commencé à faire ce que le spécialiste Maurice Lever appelle « le roman de l’Histoire » [« De son vivant déjà Triboulet inspira une foule d’anecdotes dont l’authenticité plus que douteuse ne facilite guère la tâche de l’historien. Il en va d’ailleurs de même pour tous ceux qui succèderont à Triboulet. Plus que jamais, à partir de la Renaissance, le fol devient une sorte de héros mythique, à mi-chemin de la fiction et de la réalité. Si tout le monde connaît le nom de Triboulet, nul ne peut savoir avec certitude ce qu’il fut, car il faudrait pour cela faire le partage entre l’Histoire et le roman de l’Histoire », Le Sceptre et la marotte, 1983, p. 167]. Déjà en 1870 l’historien Alfred Canel regrettait que le public préfère la légende de Triboulet à la vérité historique [« La littérature moderne a mis tant de bonne volonté à embellir la physionomie de Triboulet, que non seulement tout le monde, mais encore la plupart des historiens qui en ont parlé, ont donné, je le répète, sa légende bien plutôt que son histoire. », Recherches historiques sur les fous des rois de France, 1873, p. 121].
GD : Si j’en juge par l’évolution de notre société, la prochaine génération pourrait trouver acceptable et même "normal" que Molière ait été le bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Sur divers médias j’ai déjà entendu des historiens commencer timidement à le dire. Il y a dix ans, un tel jugement était impensable. Des enseignants m’ont même appris que l’expression "ce bouffon de Molière" revient souvent chez les lycéens. Il est donc probable que le XXIe siècle, enfin débarrassé de l’endoctrinement des siècles précédents, acceptera de considérer Molière non plus comme un "génie classique" mais comme le dernier des grands bouffons de Cour. Et la question de la paternité de ses œuvres sera résolue.
GD : En attendant, il n’y a pas d’auteur aussi joué en France.
DENIS BOISSIER : Faut-il s’en étonner ? Par son côté bouffon, Molière est véritablement notre « contemporain ». Parce que le Roi l’a voulu, il est le premier à avoir systématiquement ridiculisé la pensée noble et à surévaluer la pensée bourgeoise. Molière est le parangon de l’esprit petit-bourgeois et, par chance pour sa carrière posthume, les ficelles qui attachaient les spectateurs de Louis XIV attachent de la même façon le grand public d’aujourd’hui.
GD : La grosse farce plaît toujours autant.
DENIS BOISSIER : Parce que la mentalité TF1 est l’héritière de celle du château de Versailles. Et de même que les artistes commerciaux sont aux ordres du Pouvoir, de même Molière était aux ordres de Louis XIV. Quelle politique croyez-vous que servait Molière en jouant L’Avare ? Il ridiculisait ceux qui thésaurisaient leur argent au lieu de le faire circuler. Notre société partage les fruits de la politique mise en scène par Louis XIV. Avec lui, c’est la fin de l’esprit de la Tradition et le début de l’esprit moderne, la mort des corporations et la naissances des académies. C’est aussi le déclin de l’artisanat et la naissance des manufactures qui n’auront aucun mal à devenir des usines. Les injures et les attaques que Molière reçut de l’élite de son temps prouvent à quel point il préfigurait, sans en avoir évidemment conscience, l’esprit petit-bourgeois des siècles à venir.
GD : Diriez-vous que le théâtre de Molière a donné naissance au théâtre de boulevard ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Et le plus révélateur dans cette filiation, c’est de voir comment l’écriture collégiale de son théâtre s’est transformée avec le théâtre de boulevard en atelier de création. A l’instar de Molière, Labiche et Feydeau, pour ne citer qu’eux, sont devenus des entrepreneurs de spectacles, engageant pour chacune de leurs comédies un ou plusieurs auteurs restés pour la plupart anonymes.
GD : Je connais assez bien le cas de Labiche. Sur les 174 pièces que Labiche a signées, il n’en a écrites que quatre. Et pas un seul de ses collaborateurs ne lui a fait de procès. Et pourtant, si l’on en croit les spécialistes, quarante-six collaborateurs se cachent sous la signature « Labiche »!
DENIS BOISSIER : Les moliéristes prétendent que Molière n’a pas eu de postérité. C’est faux. Molière a donné le théâtre de Boulevard et Louis XIV a donné Hollywood, où, comme au XVIIe siècle, le droit moral n’existe pas : une œuvre artistique appartient à celui qui l’achète et la produit. Molière n’est pas un "classique" mais le promoteur de cet art du spectacle que nous appelons le showbiz.
GD : Ce pourrait être le mot de la fin, mais si vous le voulez bien, ce ne sera que le mot qui conclut notre quatrième et avant-dernier dialogue.
CINQUIÈME ET DERNIER DIALOGUE
« Le "Molière" de l’Après Révolution et plus encore le "Molière" de la Troisième République est un mythe littéraire et le parangon de l’esprit petit-bourgeois. » (15 octobre 2008)
GERARD DURAND : Parlez-nous du métier de bouffon du roi qu’exerçait Molière, ce qui va en agacer plus d’un.
DENIS BOISSIER : Cette fonction de bouffon du roi qui fut le lot quotidien de Molière durant toute sa carrière parisienne, nous ne sommes aujourd’hui plus en mesure de l’apprécier à sa juste valeur. Mais cet « emploi » honorifique est une réalité du règne de Louis XIV au même titre que l’esprit carnavalesque des trois premiers quarts du XVIIe siècle.
GD : L’un et l’autre vont de pair.
DENIS BOISSIER : Exactement. Si l’on veut bien admettre que le XVIIe est resté, jusque vers 1670 lié à la pensée féodale, il n’est pas difficile de prendre conscience combien chaque pièce mise en scène par Molière se réfère à un archétype de tréteaux ou un mécanisme carnavalesque préexistant. Bien compris, c’est-à-dire historiquement compris, la fonction de bouffon du roi tenue par Molière n’est pas anachronique, comme veulent s’en persuader les moliéristes, mais au contraire essentielle au règne absolutiste de Louis XIV. De plus, il est incontestable que Molière a parfaitement assumé cette fonction qui l’a, d’emblée, placé en dehors de la caste des écrivains, mais aussi en dehors de la caste des comédiens, et a fait de lui un « être à part », comme le constatait l’historien Gérard Moret [Molière : portrait de la France dans un miroir, thèse, 2004, p. 195].
GD : Vous nous avez dit lors de notre Deuxième dialogue que ni les écrivains ni les comédiens ne l’ont jamais soutenu, et qu’ils n’ont jamais témoigné en sa faveur.
DENIS BOISSIER : Oui, ce qui étonne les moliéristes, mais qui s’explique aisément : le bouffon du roi est un paria, jusque dans le monde du théâtre pourtant si bigarré. Toute proportion gardée, il est aux comédiens ce qu’était pour les soldats grecs le Héros. A la fois le plus célèbre d’entre les guerriers, mais aussi le plus dangereux car il était, même pour ses compagnons, un être incontrôlable. Ma comparaison n’est pas outrée car Molière fut défini de son vivant comme le « Héros des farceurs ».
GD : C’est donc sa position exceptionnelle qui caractérise le bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Oui, son action sociale dépasse largement le cadre du théâtre, bien qu’il lui emprunte beaucoup. Son action dépasse même le cadre de la fête proprement dite, bien qu’il en soit souvent le moteur. Pour tout dire, son univers est autant la rue que la Cour.
GD : Son rôle est à la fois social et métaphysique.
DENIS BOISSIER : Exactement. Le bouffon du roi, qu’il se nomme Triboulet, Angoulevent ou Molière est emblématique de son époque. C’est un catalyseur des sentiments populaires. C’est pourquoi on a tellement écrit et inventé d’anecdotes sur eux pendant leur vie et même après leur mort. La fonction de bouffon du roi crée d’elle-même ce mécanisme amplifiant. Comme le remarquait Maurice Lever, spécialiste de la question, le bouffon du roi vit « simultanément une double existence, l’une bien réelle, l’autre légendaire » [Le Sceptre et la marotte, 1983, p. 120]. Il y a tant d’anecdotes sur Molière que le grand Gustave Michaut a eu besoin de trois volumes pour les recenser, et encore il en a oubliées.
GD : De son vivant, Molière était déjà une figure légendaire.
DENIS BOISSIER : La fonction de bouffon du roi crée spontanément un légendaire, comme aujourd’hui le fait d’être une rock star ou une princesse style Lady Di. Le bouffon du roi est la pierre angulaire du règne de Louis XIV, mais aussi sa pierre de touche. C’est le seul personnage du royaume à avoir les yeux du peuple et l’oreille du roi.
GD : Cela expliquerait pourquoi Jean-Baptiste Poquelin a très tôt disparu de la biographie de Molière.
DENIS BOISSIER : Pas seulement Jean-Baptiste Poquelin. Molière lui-même s’est effacé derrière le personnage de bouc émissaire qu’il est devenu, surtout après 1665.
GD : Vous appelez « bouc émissaire » celui par qui les grands scandales arrivent, l’homme de Tartuffe et de Dom Juan…
DENIS BOISSIER : Et aussi celui que l’on doit châtier. 1665 est une date importante. Son bouffon est attaqué de toutes parts mais Louis XIV, à mille lieux de le châtier, va le protéger en l’adoubant « comédien du Roi ». Une façon tout à fait officielle de le mettre à l’abri de toute attaque, lui et ses compagnons. Cet « emploi » de bouffon (je vous rappelle que c’est le terme qu’utilise Molière), était l’équivalent aujourd’hui de l’immunité parlementaire. Et à partir de 1665 plus personne n’osera s’en prendre à Molière.
GD : Jean-Baptiste Poquelin a été effacé par Molière qui lui-même a été éclipsé par le bouffon du roi.
DENIS BOISSIER : Oui, et ce mécanisme vieux comme le monde a fait que le bouffon du roi, de façon posthume, a laissé la place à une sorte de héros idéologique dont s’est servi l’après Révolution française, puis ce héros est devenu un demi-dieu que la Troisième République a imposé par le biais de l’Ecole publique.
GD : C’est la grande époque du moliérisme militant.
DENIS BOISSIER : Un militantisme qui n’est toujours pas mort, même s’il est exsangue. Enfin, ultime étape du processus de déification, ce demi-dieu populaire est devenu après 1890 un véritable mythe littéraire grâce aux efforts des dévots de la nouvelle Sorbonne républicaine dont les bâtiments furent inaugurés en 1889, pour le centenaire de la Révolution.
GD : Et tout cela parce qu’à l’origine, Pierre Corneille a jeté son dévolu sur Jean-Baptiste Poquelin et que Louis XIV a favorisé Molière au-delà du raisonnable.
DENIS BOISSIER : Voilà pourquoi, de son temps, personne ne s’est occupé de savoir qui était vraiment Jean-Baptiste Poquelin ni de savoir ce qui se passait dans les coulisses du théâtre dont sa Majesté lui avait offert la gérance. Son « emploi » de bouffon du roi lui donnait l’immunité.
GD : Il y eut toute de même à l’encontre de Molière cette accusation d’inceste. Rien n’est plus grave qu’une telle accusation portée jusque devant le roi.
DENIS BOISSIER : Vous avez raison, mais Louis XIV n’en a pas tenu compte. Et la Cour fit, bon gré mal gré, comme le roi.
GD : Nous admirons aujourd’hui un homme que l’on a accusé, très sérieusement, d’avoir épousé sa propre fille ! Et le plus étonnant, c’est que beaucoup de moliéristes sont convaincus de la véracité de cette accusation portée par le célèbre comédien Montfleury.
DENIS BOISSIER : Oui, on peut dire que cette accusation entache leurs carrières de « dévots de Molière » [Georges Monval in Le Moliériste, 1879, p. 3].
GD : Et malgré cet incontournable soupçon d’inceste, on continue à voir en Molière un homme admirable, l’incarnation même de l’humanisme.
DENIS BOISSIER : On accumule sur lui tellement de clichés et de préjugés romantiques....
GD : J’ai été étonné d’apprendre que de très grands moliéristes jugent acceptable que Molière ait épousé sa fille… Ils lui accordent les circonstances atténuantes… Molière était un homme, après tout… C’était un comédien qui vivait dans un milieu où les mœurs étaient plus laxistes que partout ailleurs… Et ils accusent Armande de tous les pêchés du monde afin d’innocenter Molière le plus possible.
DENIS BOISSIER : La plupart des moliéristes utilisent un moyen plus efficace : ils se contentent de ne pas parler de ce qui fâche. Par exemple, ils font l’impasse sur le fait que leur « dieu » était un cocu notoire. Comme vous l’avez constaté, ils se contentent d’accuser Armande d’être une garce, sans jamais prendre la peine de réfléchir que cette jeune femme avait sans doute ses raisons pour traiter son mari ainsi, et que, parmi ces raisons, il devait en avoir d’excellentes.
GD : Mais admettre qu’Armande, dans cette affaire de mœurs, pourrait être la victime serait pour eux accuser Molière.
DENIS BOISSIER : Or, vous le savez, Molière « est l’homme le plus admirable de son siècle » ainsi que l’a défini le moliériste surdiplômé Désiré Nisard.
GD : Nisard, c’est le XIXe siècle. Aujourd’hui personne ne pourrait soutenir un pareil discours.
DENIS BOISSIER : Si. Rien n’a changé pour les « dévots de Molière ». Prenez par exemple Georges Mongrédien, auteur d’une douzaine d’ouvrages hagiographiques : Molière est, je le cite, « très honnête homme, très bon et généreux » [La Vie privée de Molière, 1950, p. 155].
GD : Ils vénèrent donc un homme qui peut-être pratiqua l’inceste et fut un « cocu notoire », comme vous dites.
DENIS BOISSIER : Et vous pouvez ajouter que Molière fut, comme son alter ego en bouffonnerie Lully, un pédophile. Ses contemporains l’ont accusé d’avoir jeté son dévolu sur Baron, âgé de treize ans. Ce jeune comédien que Molière a formé a tenté de le fuir, mais Molière a supplié le roi de le réintégrer de force dans la troupe. Louis XIV, qui a toujours tout pardonné à son bouffon, là encore, lui a obéi. Grimarest raconte, et il tenait cette information de Baron lui-même, que « l’ordre avait été expédié sur le champ » [Vie de Monsieur de Molière, 1705].
GD : Baron a reçu une lettre de cachet qui lui ordonnait de revenir auprès de Molière ?
DENIS BOISSIER : Exactement. Baron avait quitté Paris pour la province afin d’échapper à Molière, mais cela n’a pas été suffisant…
GD : Décidément, pauvre Molière…
DENIS BOISSIER : Oui, « le pauvre homme » comme dirait Orgon. Sur ce point certains moliéristes, là encore, lui ont beaucoup pardonné. Je pense à Roger Duchêne, qui attendit le dernier moment de sa vie pour écrire que Molière avait été accusé d’être « sodomite avec un mineur » [Molière, 1998, p. 580], je pense à Ramon Fernandez qui se jugeait bien placé pour comprendre l’homosexualité de Jean-Baptiste Poquelin [Molière, ou l’essence du génie comique, 1929]. Alain Niderst dans sa dernière biographie est parfois presque honnête sur ce point [Molière, 2004].
GD : Il doit être difficile d’être équitable en pareille matière, surtout pour un moliériste.
DENIS BOISSIER : Oui, bien sûr… Toutefois le moliériste Yves Giraud a eu le courage d’écrire : « La liaison homosexuelle de Molière avec le tout jeune comédien ne peut-être traitée de pure calomnie. » [« La Fameuse Comédienne (1688) : problèmes et perspective d’une édition critique » in Mélanges Grimm, Biblio 17, 1994, pp. 209]. Après la mort de Molière, Baron devenu adulte connaîtra une grande célébrité. Mais le pli étant pris, il mènera une vie de débauche et c’est dans la catégorie des « principaux débauchés » qu’il sera classé par l’historien du théâtre Jean-Nicolas de Tralage, qui le connaissait bien, [Notes et documents sur l’histoire des théâtres de Paris au XVIIe siècle, éd. critique Bibliophile Lacroix, 1880, p. 14].
GD : Tralage était un petit-bourgeois, non ?
DENIS BOISSIER : En effet, mais ce n’est pas pour autant un menteur. D’ailleurs Baron n’a pas pris seulement de son maître l’art de jouer et de provoquer le bourgeois… Il fut aussi accusé, comme Molière avant lui, d’être un « fat ».
GD : Qui a dit que Molière était un « fat » ?
DENIS BOISSIER : Son ami Charles Dassoucy. Il n’aimait pas l’homme qu’était devenu Molière : un « fat en toute manière » et un « gros seigneur » [Rimes redoublées (sans indication de date)]. Baron, ex-élève de Molière, partage avec son maître une autre caractéristique, celle de ne pas avoir écrit les pièces qu’il a publiées sous son nom.
GD : Allons bon, lui aussi !
DENIS BOISSIER : Pas moins de dix pièces seront signées par lui. De son temps, personne ne fut dupe. Voltaire est clair : « On ne croit pas que les pièces qu’il donna sous son nom soient de lui. » [Le Siècle de Louis XIV, 1739, éd. critique Antoine Adam, 1961, p. 195]. Un de ses gros succès fut L’Andrienne jouée en 1703. Comme on l’accuse de n’en être pas l’auteur, Baron dans la préface de cette pièce se compare à Térence, lequel, dit-il, s’est trouvé dans le même cas que lui.
GD : Il a convaincu ses détracteurs ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr que non ! On peut tromper la postérité, mais plus difficilement ceux qui vous connaissent bien. Baron n’a convaincu personne, d’autant que tous les professionnels du théâtre savaient que son maître Molière, lui aussi, avait été comparé à Térence et que ce dernier avait été le prête-nom de Scipion…[voir Troisième dialogue].
GD : Corneille n’a tout de même pas écrit pour Baron ?
DENIS BOISSIER : La question mérite d’être posée car, en fin de vie, Pierre Corneille s’est beaucoup rapproché de Baron. Je ne sais plus si je vous l’ai déjà dit, mais un des grands traits du caractère de Corneille c’est d’avoir toujours eu peur de voir sa carrière échouer. Son aptitude à prendre tous les styles, à s’essayer dans tous les registres vient de là. Comme il était lucide et savait que sa carrière ne tenait qu’à la célébrité de ceux qui interprétait ses œuvres, il a toujours veillé à demeurer dans l’ombre d’une vedette. D’abord ce fut Mondory, qui créa Le Cid, puis ce fut Floridor qui le mit à l’abri de l’insuccès jusque vers 1650. Et après une longue retraite, c’est Molière qui est entré dans sa vie en 1658. Et quand Molière meurt, Corneille cesse d’écrire pour le théâtre… En fin de vie, il se rapprocha de Baron. Il fut témoin à son mariage. Baron était devenu riche et célèbre, on peut supposer que Corneille, qui était plus que jamais dans le besoin, a essayé de lui être utile…
GD : Il aurait écrit pour Baron ? Mais il avait quel âge, ce brave Corneille ?
DENIS BOISSIER : Plus de soixante-dix ans. Il est fatigué. Mais c’est un fait avéré que jusqu’à sa fin, à deux ans près, Corneille ne perdit aucune de ses facultés intellectuelles. Corneille conservait nécessairement des manuscrits de pièces qui n’avaient pas été jouées, ne serait-ce qu’à cause de la mort soudaine de Molière… Pourquoi ne les aurait-il pas vendus à celui qui pouvait en faire un succès ? Le célèbre corneilliste Auguste Dorchain n’était pas loin de penser que Pierre Corneille n’était pas étranger à la pièce la plus célèbre de Baron, L’homme à bonne fortune [Pierre Corneille, 1918, p. 477]. Notons que c’est Armande, ex-maîtresse de Baron et veuve de Molière, qui joue Léonor dans L’Homme à bonne fortune, pièce qui paraîtra… sans nom d’auteur. Comme au temps de Molière, tout reste en famille… J’ai aussi remarqué que dans la Dédicace de La Place royale, publiée en 1637, Corneille avait écrit avec regret : «… si j’étais homme à bonne fortune ».
GD : Mais il faudrait tout de même prouver que Baron n’est pas l’auteur de ses pièces.
DENIS BOISSIER : C’est fait. Le Débauché qui fut joué en 1689 sous le nom de Baron ne figurera finalement pas dans les Œuvres de Baron [en trois volumes in-12]. On sait aussi que Baron a payé la pièce La Coquette et la fausse prude cinq cents écus à l’écrivain désargenté D’Alègre. La tragédie Géta, jouée sous le nom de Baron, est de Pechantré, lequel fut payé vingt pistoles, c’est-à-dire 200 livres, autrement dit une misère, et encore uniquement parce qu’est intervenu en sa faveur le comédien célèbre Champmeslé qui, ensuite, a tout raconté.
GD : Molière, lui, payait 2000 livres Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Il lui payait 2000 livres des tragédies qui n’obtenaient pas de grands succès. Nous ignorons combien il a payé (au noir, bien sûr) des comédies qui triomphaient. Ce que nous savons, en revanche, c’est que Pierre Corneille a fini par préférer être payé au pourcentage des recettes.
GD : S’il a demandé à être payé au pourcentage des recettes pour Tartuffe ou Dom Juan il n’a pas dû s’en plaindre puisque ce furent de très gros succès…
DENIS BOISSIER : Il est probable que c’est ainsi qu’il a pu faire vivre professionnellement sa grande famille et établir ses fils aînés.
GD : Georges Forestier dit que Corneille avait de confortables revenus et que sa pauvreté est une légende [« Cette légende ne résiste à l’examen d’aucun document de l’époque. Corneille avait de confortables revenus, et, à la veille de sa mort, il gagne encore un procès contre un débiteur insolvable, accroissant sa fortune immobilière d’une belle propriété. » sur le site CHRT].
DENIS BOISSIER : M. Forestier confond patrimoine et revenus d’auteur. Certes, il a des biens fonciers, mais il s’agit du patrimoine de sa femme et non du sien. Croyez-vous que l’orgueilleux Corneille ait jamais accepté de prendre sur cet héritage pour faire vivre correctement sa maisonnée ? Faut-il rappeler que Corneille a été mal accueilli par sa belle-famille, qu’il a fallu l’intervention de Richelieu pour que celle-ci accepte son mariage ? Un homme comme Corneille a bien trop d’orgueil pour grignoter le patrimoine de sa belle-famille et lui devoir quoi que ce soit. C’eût été admettre que son "génie" n’était pas capable de faire vivre ceux dont il avait la charge.
GD : Pour vous, il n’était pas assez riche pour se dispenser de l’apport financier que lui apportait le Palais-Royal ?
DENIS BOISSIER : Si tous ses contemporains ont dit de lui qu’il était un « mercenaire » de l’écriture, qu’il était, comme nous l’apprend l’abbé d’Aubignac dans sa Quatrième dissertation [1663] un « poète à titre d’office » au « service d’un histrion », traduisons : un poète de troupe au service d’un farceur nommé Molière, ce n’est pas pour rien [lire dans ce site « Boileau, d’Aubignac, La Fontaine dévoilent la collaboration Corneille-Molière »]. De son temps, tout le monde savait que Corneille avait toujours besoin d’argent et que la gloire ne lui en rapportait pas assez. J’en veux pour preuve que lorsque Molière meurt, Pierre Corneille déménage pour prendre un appartement plus petit et moins cher.
GD : C’est en 1673 que meurt Molière. Quand déménage Corneille ?
DENIS BOISSIER : Corneille quitte en 1674 son appartement de la rue des Deux-Portes pour un logement plus modeste de la rue de Cléry. M. Forestier aurait-il oublié de vous le dire ? En 1678, il supplie Colbert de lui rendre sa pension qu’il ne touche plus, comme fait exprès, depuis que Molière est mort. Toujours plus pauvre, Corneille sera ensuite contraint en 1682 de loger rue d’Argenteuil, sur la butte Saint-Roch, qui était alors le quartier de la prostitution. Le Père Tournemire témoignera que Pierre Corneille vécut les dernières années de sa vie dans une misère certaine. Comment M. Forestier explique-t-il cela ?
GD : Je ne suis pas certain qu’il l’explique.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, posez-vous la question : pourquoi Corneille, ayant correctement vécu jusqu’en 1673, date de la mort de Molière, connaît-il brusquement une situation financière médiocre et même, très vite, mauvaise ? Inversement, comment expliquer qu’entre 1658 et 1673 Pierre Corneille paraît n’avoir jamais souffert de la pauvreté ?
GD : Peut-être que Corneille était alors suffisamment riche.
DENIS BOISSIER : Dans ce cas, il faudra comprendre pourquoi il a cessé de l’être. Mais puisque rien, officiellement, n’explique ce néfaste changement, il faut admettre que nous ne savons pas de quoi exactement vécut, sans souci financier, Pierre Corneille de 1658 à 1673. Car même si, entre 1658 et 1673, Corneille n’a jamais été pauvre, il n’a jamais été riche, loin de là. Et même eût-il été assez riche grâce aux biens fonciers de son épouse, il n’en aurait jamais eu assez pour satisfaire aux exigences de ses enfants. Ses deux fils aînés étaient officiers dans l’armée du Roi et, en ce temps-là, les officiers devaient pourvoir à l’équipement des hommes qu’ils dirigeaient. Pour cela, il fallait être fils de princes ou de financiers.
GD : Et Corneille n’était ni l’un ni l’autre.
DENIS BOISSIER : Et je ne vous parle pas de la dot de ses deux filles ni de son cadet qui était entré dans les ordres et qu’il entretenait encore sept ans après la mort de Molière. Pour sa progéniture Pierre Corneille s’est littéralement ruiné. S’il avait entendu M. Forestier lui apprendre qu’il vivait confortablement, il en eût été enchanté. S’il avait eu suffisamment d’argent, croyez-vous qu’il se serait humilié en 1678 devant Colbert ?
GD : Corneille s’est humilié ?
DENIS BOISSIER : Oui, par lettre. Il a demandé la charité au ministre Colbert, qu’il méprisait, et qui, en la lui refusant, le lui a bien rendu.
GD : A lui aussi on a envie de dire « Pauvre Corneille… ».
DENIS BOISSIER : Le plus triste, c’est que Corneille ne demandait pas une pension pour lui, mais pour pouvoir continuer à entretenir ses deux fils qui étaint officiers dans l’armée du roi, dépensaient une fortune en équipement militaire.
GD : Revenons à Baron. Vous pensez que l’attitude de Baron "auteur" est expliquée par celle de Molière ?
DENIS BOISSIER : Je crois, en effet, que le comportement d’un disciple reflète fatalement celui du maître. Grâce à leur célébrité et leur fortune, tous deux ont eu la « fertile veine ».
GD : Un moliériste a-t-il déjà fait le rapprochement entre l’attitude de Baron devenu adulte et celle de Molière ?
DENIS BOISSIER : Pas à ma connaissance. Mais pour nous, cornéliens, l’accusation portée par ses contemporains à l’encontre de Baron de n’avoir pas écrit le théâtre publié sous son nom de vedette est une confirmation de ce qui s’est passé avec Molière.
GD : Lors de nos précédents dialogues vous avez insisté sur ce fait historique que les comédiens célèbres étaient dits les "auteurs" des pièces qu’ils créaient uniquement parce que c’était alors l’usage social, puisque ainsi les comédiens mettaient à l’abri les véritables auteurs qui ne bénéficiaient pas, comme eux, d’un statut qui les mettait à l’abri des lois sociales. Mais dans le cas de Baron, ce n’était déjà plus la même situation.
DENIS BOISSIER : En effet. Toutefois le pli étant pris, les vedettes ont continué à s’approprier les pièces d’écrivains sans le sou. Voyez, après Baron, l’exemple de l’illustre Frédérick Lemaître. Comme pour Molière, comme pour Baron, sa célébrité lui a permis d’être l’"auteur" de plusieurs grands succès [« Frédérick Lemaître n’a jamais rien écrit pour le théâtre, dit le catalogue Soleinne, quoique son nom se trouve sur trois pièces ; la plus célèbre est Robert Macaire, pièce commandée aux auteurs de l’Auberge des Adrets. On dit qu’une vingtaine d’auteurs y concoururent… Frédérick la leur acheta pour en être seul propriétaire, et il a toujours refusé la permission de l’imprimer. » Victor Fournel, Curiosités théâtrales, anciennes et modernes, françaises et étrangères, 1859, p. 382]. Ce que nous pourrions appeler le star-system s’est développé sous Louis XIV. Toute une industrie a commencé à vivre des retombées commerciales d’un nom célèbre. Imaginez les bénéfices que l’on pouvait retirer d’un farceur-vedette devenu bouffon du roi. C’était une industrie si florissante qu’un jour Molière, certain de l’appui du roi, a voulu gardé pour lui seul les bénéfices de toutes les pièces auxquelles son nom était lié.
GD : Quand ?
DENIS BOISSIER : En 1666, juste après Le Misanthrope.
GD : Et alors ?
DENIS BOISSIER : Les éditeurs se sont tous coalisés contre lui. Il faut dire que Molière réduisait à néant leurs privilèges d’édition.
GD : Un seul homme contre toute une corporation !
DENIS BOISSIER : Pas un seul homme : deux. Le roi soutient Molière. Sans lui, Molière n’aurait rien osé. D’ailleurs, c’est le roi qui a tranché le différend, et non la juridiction du maître des requêtes.
GD : C’est ce qu’on appelle le fait du prince.
DENIS BOISSIER : Ce fait du prince scandalisait le grand moliériste Charles-Louis Livet qui le trouvait « inique », c’est l’adjectif qu’il emploie [« Etait-il juste, était-il légitime de ruiner des libraires qui avaient fait de grands frais peut-être pour exploiter leur privilège, d’annuler ce privilège avant la date où il devait expirer ? Etait-il juste que le roi retînt, pour être jugées par lui et son Conseil, les appellations et oppositions des libraires lésés ? Le droit de committimus dont Molière pouvait bénéficier comme officier du Roi lui permettait bien de recourir à la juridiction des maîtres de requêtes : mais le Conseil du Roi, le Roi lui-même jugeant de simples affaires de librairie, c’était le comble de l’iniquité. » dans Le Moliériste, 1881, n° 30, p. 177].
GD : Donc Molière se met à dos tous les éditeurs.
DENIS BOISSIER : Oui, après les Précieuses, les marquis, les mondains, les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, les dévots vrais ou faux, après avoir malmené des érudits comme Géraud de Cordemoy, Pierre Perrin ou Charles Cotin, l’intouchable Molière s’attaque à la corporation des marchands-libraires de Paris…
GD : C’est de l’inconscience ou du courage ?
DENIS BOISSIER : Ni l’un ni l’autre. Sous un règne absolutiste, Molière a le roi avec lui. Que risque-t-il ? Rien. Qu’a-t-il à gagner ? Tout.
GD : D’autres écrivains n’ont pas alors tenté de l’imiter ?
DENIS BOISSIER : Aucun, puisque personne d’autre n’est le bouffon du roi. On ne pouvait rien contre une décision de Sa Majesté, fût-elle la plus injuste. Sous Louis XIV, l’iniquité est partout, et elle prend sa source dans la Chambre du roi où Molière a le privilège d’accéder.
GD : C’est uniquement pour des raisons de gros sous que Molière a voulu retirer aux libraires leurs privilèges d’édition ?
DENIS BOISSIER : Le privilège d’édition dit que Molière a voulu « revoir et corriger tous ses ouvrages pour les donner au public dans leur dernière perfection ».
GD : Il agit donc aussi en tant qu’auteur.
DENIS BOISSIER : Parce que vous croyez à cette petite phrase ? Durant près de douze ans, Molière ne s’est jamais occupé de l’édition de son théâtre… et brusquement le voilà scrupuleux.
GD : Pourquoi pas ?
DENIS BOISSIER : Il va combattre à s’en rendre malade la corporation des marchands-libraires pour la satisfaction de corriger des virgules et des didascalies ?
GD : Corneille le faisait bien !
DENIS BOISSIER : Et Molière devient brusquement plus exigeant que le puriste Corneille ! Je vous trouve bien naïf de penser que ce n’est pas pour une affaire de gros sous qu’il s’est mis en tête de publier sa propre édition, mais uniquement pour le bonheur des bibliophiles.
GD : N’empêche que le privilège d’édition accrédite cette version.
DENIS BOISSIER : Evidemment ! Lorsque Molière présenta à son maître son projet d’auto-édition, le croyez-vous bête au point de ne pas faire valoir l’utilité de préparer une édition digne d’un aussi glorieux roi ?… Et Louis XIV, toujours complaisant envers son bouffon, lui accorde ce privilège exorbitant comme il le fera avec son autre bouffon Lully lorsque ce dernier, en quête lui aussi d’un monopole et sous le même prétexte de servir au mieux les intérêts de Sa Majesté, s’appropriera les comédies-ballets signées Molière et les éditera sous son nom.
GD : Lully publie ses œuvres complètes dans le même temps que Molière publie les siennes ?
DENIS BOISSIER : Oui. L’un et l’autre, l’un contre l’autre, agissent comme des chefs d’entreprise qui veulent accroître leurs débouchés et leurs revenus. Molière élimine les éditeurs, Lully, qui a le vent en poupe, élimine même Molière.
GD : En quelle année déjà Molière se lance dans ce projet d’auto-édition ?
DENIS BOISSIER : En 1666.
GD : Quand il est assuré du soutien indéfectible du roi.
DENIS BOISSIER : Oui, il a décidé comme l’écrit Edric Caldicott d’être patron « d’industrie d’édition » et il a « lancé un défi » aux éditeurs parisiens [« Dès 1666, il avait lancé un défi à la corporation des imprimeurs de Paris en dirigeant seul, avec quelques imprimeurs de son choix, sa propre industrie d’édition », La carrière de Molière entre protecteurs et éditeurs, 1998, p. 151].
GD : Il veut le monopole ?
DENIS BOISSIER : Il veut le monopole d’exploitation des pièces qu’il a achetées ou fait fabriquer par ses collaborateurs. C’est dans ce but qu’il s’est associé avec Jean Ribou, un « pirate de l’édition », comme l’a défini l’éminent Georges Couton. Mais les marchands-libraires de Paris, pour ne pas perdre l’argent qu’ils avaient investi, font jeter Ribou en prison.
GD : Pourquoi ?
DENIS BOISSIER : Il a publié des livres interdits par la Censure.
GD : Ils attaquent Ribou plutôt que Molière.
DENIS BOISSIER : Parce qu’ils ne peuvent rien contre Molière. D’ailleurs, Molière obtient du Roi une atténuation de la peine et prête avec intérêts à Ribou l’argent nécessaire pour qu’il continue de travailler pour lui.
GD : Et les éditeurs pendant ce temps ?
DENIS BOISSIER : Ils demandent justice contre Molière mais ne l’obtiennent pas. Je vous l’ai dit, c’est Louis XIV qui règle lui-même leur différend avec son bouffon…
GD : En ne favorisant que celui-ci…
DENIS BOISSIER : … A tel point que cela navrait le grand moliériste Charles-Louis Livet.
GD : Pourquoi navré, s’il est moliériste ?
DENIS BOISSIER : Parce que Livet était aussi un historien.
GD : C’est en effet injuste qu’un roi favorise autant son… favori.
DENIS BOISSIER : C’est injuste, mais c’est logique si l’on tient compte des liens existant entre un roi et son bouffon. Louis XIV a toujours favorisé Molière. Pourquoi voulez-vous qu’il cesse soudain ? Il faudrait qu’il ait une raison majeure… Or, la seule raison qui pourrait faire changer un roi vis-à-vis de son bouffon, c’est qu’il décide de s’en choisir un autre…C’est d’ailleurs ce qui arrivera après 1670 : Louis XIV, lassé de Molière, va lui préférer son autre bouffon : Lully, un bouffon-musicien, alors que Molière n’était que bouffon-comédien.
GD : Louis XIV préférait la musique au théâtre. Contre Lully, Molière avait d’avance perdu son combat.
DENIS BOISSIER : Tout à fait. C’est pour cela que Lully s’approprie les comédies-ballets de Molière et les publie sous son propre nom. Mais pendant cette lutte contre les éditeurs, nous sommes en 1666, date où Louis XIV ne peut vivre sans Molière, donc il le soutient. Malheureusement pour Molière, ce combat pour le monopole d’édition va durer jusqu’en 1673. Or en 1671 le roi commence à se détourner de son amuseur. Ce privilège pour publier à son compte sa propre édition complète, c’est le dernier cadeau que le roi fait à son bouffon.
GD : Molière a donc gagné ?
DENIS BOISSIER : Pas encore. Mais comme l’écrit Edric Caldicott [La carrière de Molière entre protecteurs et éditeurs, 1998, p.127] c’est une véritable « déclaration de guerre » de Molière, qui vient de priver tous les éditeurs de Paris, et ils sont huit ou neuf, du revenu futur de la vente des œuvres qu’il leur avait cédées par le passé.
GD : Il a donc gagné sa guerre.
DENIS BOISSIER : A ceci près que Molière, vous le savez, meurt en 1673. Les marchands-libraires vont aussitôt racheter à Jean Ribou, le « pirate d’édition », le privilège que lui avait octroyé son associé. Et ce sont eux, finalement, qui publieront à leur bénéfice les œuvres complètes de Molière…
GD : Pauvre Molière…
DENIS BOISSIER : Ne le plaignez pas trop. C’était un homme d’affaires redoutable. Il avait vendu avec Ribou chaque exemplaire du Tartuffe au double du prix habituel.
GD : Rassurez-moi, nous parlons bien de Jean-Baptiste Poquelin, le « parfaitement homme du monde » [La Grange] et non des Poquelin marchands et bailleurs de fond.
DENIS BOISSIER : C’est la même famille... et bon sang bourgeois ne saurait faire faillite. Mais puisque vous évoquez les oncles de Jean-Baptiste, savez-vous qu’ils ont créé avec Colbert une compagnie d’assurances dont Louis XIV fut actionnaire… avec Molière ?
GD : Molière actionnaire d’une compagnie d’assurances ?
DENIS BOISSIER : Son nom figure dans la liste des trente actionnaires de la compagnie d’assurances.
GD : Aucune des biographies que j’ai lues ne mentionne cela.
DENIS BOISSIER : Parce qu’un Molière actionnaire ne fait pas suffisamment romantique.
GD : Aussi dans quelle galère s’est-il mis de vouloir être actionnaire d’une compagnie d’assurances, de vouloir lutter contre tous les éditeurs à la fois !
DENIS BOISSIER : Votre déception vient de ce que vous avez à l’esprit le Molière aux blonds cheveux bouclés des manuels scolaires. Moi, je vous parle de Jean-Baptiste Poquelin, celui qui, pour pouvoir être membre de la troupe de Madeleine Béjart, dont il était amoureux, a payé son entrée 630 livres, soit la moitié des fonds dont la troupe allait disposer pour commencer sa carrière parisienne. Jean-Baptiste Poquelin n’a pas étudié le latin mais il sait compter. Il signe seul l’acte du 19 décembre 1644 qui officialise le désistement du bail du jeu de paume des Mestayers où jouait l’Illustre Théâtre. Quand la troupe sillonne la province, Molière est son trésorier. C’est à lui qu’on délivre les quittances. Nous en avons conservé deux. Il sait gérer ses intérêts et ceux de ses compagnons. Il offre des places gratuites aux notables afin de les décider en leur faveur. En 1656, il finit même par commettre une indélicatesse que sanctionnent aussitôt les Etats de Languedoc.
GD : Si je comprends bien, entre 1643 et 1658, Molière est un membre important de la troupe non en tant qu’auteur, non en tant que grand comédien, mais comme trésorier.
DENIS BOISSIER : Exactement. On n’entend jamais parler de Molière en tant qu’auteur, ni en tant que grand comédien. Les vedettes de cette troupe sont d’abord féminines : Madeleine Béjart, qui est co-directrice avec le réputé comédien tragique Du Fresne, et Marquise du Parc dont la beauté intéresse les seigneurs qui invitent la compagnie à jouer devant eux.
GD : C’est à cette époque qu’ils jouent devant le prince de Conti.
DENIS BOISSIER : En 1653 Du Fresne, Madeleine Béjart et leurs compagnons sillonnent le Languedoc. Si vous lisez les biographes de Molière, vous apprenez que Molière impressionna le prince de Conti qui voulut même faire de lui son secrétaire particulier. C’est doublement faux. Primo, ce n’est pas Molière qui a décidé le prince en faveur de la troupe, mais Sarrazin, le secrétaire de Conti. Deuxio, il n’a jamais été question que le prince Conti fasse de Molière son secrétaire particulier.
GD : Racontez-nous ça…
DENIS BOISSIER : Il y avait deux troupes en rivalité. Le prince de Conti préférait l’autre troupe quand son secrétaire, l’écrivain Sarrazin, est intervenu et a fait pencher son maître vers la troupe de Du Fresne/Madeleine Béjart.
GD : Vous dites « la troupe de Du Fresne/Madeleine Béjart », ce n’est donc toujours pas celle de Molière.
DENIS BOISSIER : Non, pas en 1653. La troupe est celle du vétéran Charles Du Fresne, ami de nombreux princes et dont le père était le peintre du roi. C’est la troupe réputée de Du Fresne qu’ont intégrée vers 1644 Madeleine et ses compagnons de l’ex Illustre Théâtre…
GD : … L’Illustre Théâtre qui avait complètement fait faillite…
DENIS BOISSIER : Oui. Molière le trésorier a fui Paris pour non-paiement de dettes et a rejoint en province Madeleine Béjart et ses compagnons, lesquels, en attendant des jours meilleurs, avaient grossi les rangs de la troupe itinérante de Charles Du Fresne. En 1653, Molière est un membre de la troupe, à ceci près qu’il a des oncles bailleurs de fonds et que c’est sans doute à cela qu’il doit d’être trésorier.
GD : Je vous ai interrompu…Vous disiez que c’est l’écrivain-secrétaire Sarrazin qui a décidé le prince de Conti en faveur de la troupe de… Du Fresne/Béjart.
DENIS BOISSIER : Oui, c’est Sarrazin. Nous le savons parce que l’abbé Cosnac, qui était au service du prince de Conti, l’a raconté dans ses Mémoires [« Sarrazin, à force de prôner leurs louanges, fit avouer à M. le prince de Conti qu’il fallait retenir la troupe de Molière, à l’exclusion de celle de Cormier. » Mémoires de Daniel de Cosnac, éd. posth. 1852, T. I, p. 127]. Et savez-vous pourquoi Sarrazin a choisi la troupe de Du Fresne/Béjart ? Parce qu’il était tombé amoureux de Marquise du Parc !
GD : Ce n’est pas donc Molière qui a fait pencher la balance en faveur de ses compagnons, c’est la charmante Marquise du Parc.
DENIS BOISSIER : Et ce n’est pas le prince de Conti qui a pris la décision de les engager, mais son secrétaire Sarrazin alors sous le charme de la comédienne.
GD : Des biographes affirment que le prince de Conti a voulu engager Molière comme secrétaire, c’est donc qu’il l’estimait.
DENIS BOISSIER : On voudrait même nous faire croire que le prince de Conti, qui était un érudit, a été littéralement fasciné par le ténébreux et magnétique Molière… mais tout cela est un rêve de biographes romantiques. C’est plus encore une lecture abusive d’un texte de l’abbé Voisin, écrit en 1667… Je vais vous le lire…C’est un bon exemple de la façon dont les moliéristes s’arrangent avec l’Histoire et même la petite histoire…. C’est instructif…
« Monseigneur le prince de Conti avait eu en sa jeunesse tant de passion pour la comédie qu’il entretint longtemps à sa suite une troupe de comédiens afin de goûter avec plus de douceur le plaisir de ce divertissement ; et ne se contentant pas de voir les représentations du théâtre, ils conférait souvent, avec le chef de leur troupe, qui est le plus habile comédien de France, de ce que leur art a de plus excellent et de plus charmant. Et lisant souvent avec lui les plus beaux endroits et les plus délicats des comédies tant anciennes que modernes, il prenait plaisir à les lui faire exprimer naïvement ; de sorte qu’il y avait peu de personnes qui pussent mieux juger d’une pièce de théâtre que ce prince. »
Voulez-vous que je vous relise ce passage ?
GD : C’est inutile.
DENIS BOISSIER : Voilà le document sur lequel s’appuient tous les moliéristes. Il a pour titre : Défense du traité de Mgr le prince de Conti touchant la comédie et les spectacles. Il a été publié en 1667. Et le passage qui nous intéresse est à la page 419. Première constatation, nous ne pouvons avoir aucune certitude que le « comédien » dont parle l’abbé est Molière.
GD : Il n’est jamais nommé ?
DENIS BOISSIER : Non seulement il n’est jamais nommé mais il est défini comme « le plus habile comédien de France ». Or Molière, durant toute sa carrière, ne fut jamais connu pour être un bon comédien, seulement un excellent mime et un farceur efficace. De plus, en 1653 Molière était encore un inconnu. Enfin, l’abbé Voisin dit de ce comédien qu’il était « chef de leur troupe », ce qui n’était pas le cas de Molière à cette date.
GD : Peut-être en 1653 commençait-il à l’être ?
DENIS BOISSIER : L’aurait-il été, cela n’aurait rien changé pour le prince de Conti : seul le chef de troupe Charles Du Fresne, acteur de tragédie fort apprécié, avait été attaché à la maison du duc d’Orléans, et lui seul bénéficiait de l’amitié du duc d’Epernon, lequel l’estimait au point de faire de lui son protégé et favori, ainsi que deux lettres l’attestent. Du Fresne était le seul parmi ses compagnons (mis à part Madeleine Béjart qui connaissait le duc de Guise) à être admis à fréquenter les "grands" de ce monde. Et le prince de Conti ne l’ignorait pas. Du Fresne avait alors quarante-deux ans, c’était un homme accompli. Molière n’avait que trente ans et il était encore, nécessairement, mal dégrossi.
GD : Donc à cette époque la seule troupe provinciale digne de considération était celle de Du Fresne.
DENIS BOISSIER : Exactement. Parmi les plus illustres compagnies théâtrales Le Roman comique cite « la troupe de Monseigneur le duc d’Epernon » et en premier, son directeur Du Fresne. Aux yeux de la noblesse, personne ne pouvait tenir ce rôle de chef de troupe, à part lui.
GD : L’abbé Voisin ne parlerait donc pas de Molière, mais de Charles Du Fresne ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. C’est parce qu’il était le fils de Claude Du Fresne, peintre du Roi, et parce qu’il pouvait se recommander du duc d’Epernon, au service duquel il dirigeait sa troupe, et plus encore parce qu’il était connu pour son répertoire tragique que Du Fresne a pu, lors d’un séjour de la troupe sur ses terres, intéresser le prince de Conti qui, du reste, n’a jamais aimé ni la farce ni les farceurs.
GD : Molière n’avait évidemment pas les atouts de Du Fresne.
DENIS BOISSIER : Molière avait pour lui que ses oncles Poquelins étaient des bailleurs de fonds.
GD : Au fond, quelle importance de savoir si l’abbé Voisin parle de Molière ou de Du Fresne ?
DENIS BOISSIER : Tout de même… Cela montre comment les moliéristes s’arrangent pour donner systématiquement le beau rôle à leur idole.
GD : C’est compréhensible.
DENIS BOISSIER : Maintenant demandez-vous qui était l’abbé Voisin et de quelle sorte de livre est tiré l’extrait que je vous ai lu. La Défense du traité de Mgr le prince de Conti touchant la comédie et les spectacles de l’abbé Voisin défend l’attitude du prince de Conti devenu grand chrétien et condamne avec lui non seulement la farce, non seulement la comédie, mais le théâtre tout entier.
GD : L’abbé Voisin n’était donc pas homme à faire l’éloge du farceur Molière en 1667, en plein scandale du Tartuffe.
DENIS BOISSIER : En effet. Il serait incompréhensible que l’abbé ait eu l’idée de mettre en valeur Molière alors que celui-ci représente, dès 1662 et plus encore en 1667, celui qui bafoue les principes chrétiens, et donc l’adversaire à éliminer. Du Fresne, lui, avait depuis 1659 abandonné la scène et avait épousé une dame de la noblesse. L’abbé Voisin pouvait donc l’évoquer discrètement.
GD : Venons-en au second point : Molière secrétaire potentiel du prince de Conti. Lorsque les moliéristes disent que le prince de Conti a voulu faire de Molière son secrétaire, sur quel document s’appuient-ils ?
DENIS BOISSIER : Sur un seul document : l’hagiographie de Grimarest, publiée en 1705. Mais certains moliéristes, comme l’éminent Anaïs Bazin, ont démontré que nous étions en pleine Légende Dorée, car lorsque le secrétaire Sarrazin mourut, Molière était loin de Conti et c’est Guilleragues qui fut choisi [« il ne nous a pas été possible de placer l’offre faite à Molière, suivant Grimarest, par le prince de Conti de le prendre pour secrétaire en remplacement de Sarrazin, non plus que le beau discours de Molière en refusant cette place, qui fut donnée, dit Grimarest, sur le refus de celui-ci, à M. de Simoni. La vérité est que Jean-François Sarrazin, secrétaire des commandements du prince de Conti, mourut à Montpellier au mois de décembre 1654, lorsque Molière était encore à Lyon, et que la même gazette qui annonçait sa mort fit connaître le nom de son successeur, le sieur de Guilleragues. D’Assoucy nous apprend aussi qu’en arrivant à Pézenas avec Molière, il trouva M. de Guilleragues installé dans ses fonctions, à telles enseignes qu’il en reçut de l’argent », Notes historiques sur la vie de Molière, 1851, p. 48].
GD : Dans des biographies récentes on parle de Conti et de l’estime dans laquelle il tenait Molière en 1653.
DENIS BOISSIER : Si on enlève à Molière son légendaire, que lui reste-t-il ? Presque rien. En province c’est sa Légende Dorée qui constitue tout l’appareil biographique. A Paris, c’est Louis XIV et l’ « emploi » de bouffon, autrement dit une seconde Légende Dorée. Si on refuse ces deux Légendes Dorées qui se complètent à merveille il n’y a pas cent pages historiques à écrire sur Molière/Poquelin.
GD : Ce légendaire est donc essentiel à Molière.
DENIS BOISSIER : Il lui est même consubstantiel. C’est un encens dont ne peuvent se passer les moliéristes. Sans cet encens trompeur comment pourraient-ils croire que le prince de Conti, un des cinq hommes les plus influents de France, qui prit pour secrétaire le fils d’un trésorier-général de France, aurait pu choisir le fils d’un boutiquier, farceur de son état, qui plus est en fuite pour non-paiement de dettes…
GD : Guilleragues qui succéda à Sarrasin occupait quel poste ?
DENIS BOISSIER : Il était premier président de la cour des aides de je ne sais plus quelle grande ville [Bordeaux] quand il entra au service du prince de Conti.
GD : Vous avez raison, je ne crois pas qu’un homme aussi érudit et aristocrate que le prince de Conti aurait pris pour secrétaire particulier un fils de Tapissier… A moins qu’il n’ait eu dans l’idée de faire quelque emprunt auprès de ses oncles bailleurs de fond.
DENIS BOISSIER : En effet, si ce que nous apprend Grimarest a un fond de vérité ce n’est certainement pas à Molière que le prince de Conti a pu accorder son attention, mais à Jean-Baptiste Poquelin, neveu des frères Poquelin en affaires avec Colbert et le roi.
GD : Ce qui est certain, c’est que le prince de Conti va finir dévot et adversaire du Tartuffe.
DENIS BOISSIER : Oui. Et nous savons aussi qu’en fin de vie, Molière est resté un farceur doublé d’un homme d’affaires. Il n’a, sur ce point, jamais changé. Il possède de nombreuses créances sur de petites gens, exactement comme son père. Molière, cet « homme d’une parfaite droiture, généreux, délicat » comme l’écrit le moliérâtre Pierre-Paul Plan [in Mercure de France, 16 décembre 1919, p. 606], peu avant que son père ne meure, a voulu garder pour lui la maison familiale et en spolier ses cohéritiers. Cela vous choque ? L’éminent Roger Duchêne l’a écrit en toutes lettres : Molière a faussement prêté à son père la somme de 10 000 livres afin d’être « crédité par son père sur son héritage » [« Le but de l’emprunt et de la contre-lettre d’août 1668 n’étant pas pour Molière de prêter de l’argent à son père sans qu’il le sache, mais d’avoir sur lui, avec sa complicité, une créance sur sa maison que ses cohéritiers ne pourraient pas lui contester. Il va de soi que la somme n’a pas vraiment été fournie par Molière, mais lui a été ainsi créditée par son père sur son héritage futur afin de compenser ce que leurs comptes avaient d’insuffisamment établi. », Molière, 1998, p. 721].
GD : A ce qu’il semblerait, l’argent a perverti Molière beaucoup plus que l’on se l’imagine.
DENIS BOISSIER : Mis à part les clichés des manuels scolaires, les Français d’aujourd’hui n’ont aucune idée de l’homme quotidien que fut Jean-Baptiste Poquelin. Jeanne d’Arc et le Molière des moliéristes sont des contes que l’on apprend aux enfants. Le vrai Jean-Baptiste Poquelin, ce n’est pas du sirop d’orgeat, mais un alcool puissant.
GD : Et ne disons rien de Jeanne d’Arc !
DENIS BOISSIER : C’est pareil pour Lully. Ses contemporains voyaient en lui un monstre d’égoïsme et de fatuité, ils n’ont pas pu tous se tromper. Comme je vous le disais, dans le même temps où Molière voulait pour lui un monopole d’édition, Lully obtenait du roi le privilège de s’approprier les comédies-ballets de Molière et de les publier sous son nom. Eux qui avaient commencé par être compères en bouffonnerie, puis qui avaient été associés pour le plus grand plaisir de Louis XIV, eux qui s’étaient mis d’accord en 1671 pour déposséder l’abbé Perrin de son privilège de l’Opéra, sont désormais adversaires. Lully retourne contre Molière son pragmatisme commercial : tout ce qu’autrui écrit pour moi m’appartient. Lully peut d’autant plus l’affirmer que ni lui ni Molière ne sont les auteurs à proprement parler, ni les propriétaires de leurs spectacles. Le seul propriétaire et au final, le seul auteur, c’est Louis XIV.
GD : Le Louis B. Mayer de Versailles en version cinémascope !
DENIS BOISSIER : Absolument. Louis XIV fut le seul et grandiose producteur de son siècle, et le seul auteur de son règne.
GD : Revenons à Pierre Corneille que nous avons un peu perdu de vue. Si je vous comprends bien, c’est parce que Molière fut le bouffon de Louis XIV que personne n’a parlé de ses relations avec Pierre Corneille. S’il n’avait été qu’un comédien parmi tant d’autres, peut-être aurait-on mentionné que Corneille écrivait pour lui ?
DENIS BOISSIER : Même dans ce cas de figure, j’en doute. Le XVIIe siècle fut un siècle qui s’est interdit beaucoup de confidences. Prenez l’exemple de La Fontaine. Il a écrit des comédies pour le comédien-vedette Champmeslé, mais rien n’a filtré de leurs arrangements.
GD : Les comédies jouées par Champmeslé sont de Champmeslé.
DENIS BOISSIER : Exactement. Conséquence directe de la politique absolutiste de Louis XIV, une sorte d’omerta a existé qui a empêché les mauvaises langues de révéler ses dessous politiques et artistiques. Voyez comment fut camouflée l’Affaire des Poisons ou occultée la détention du célèbre Masque de fer. L’anonymat et les prête-noms étaient une nécessité sociale et personne n’a jamais vendu la mèche. J’ai conscience de ce qu’ont de superficiel mes réponses. Mais la masse énorme des données historiques, sociologiques et littéraires qu’il faudrait condenser afin de ne pas trop paraître superficiel est telle qu’elle rend le présent entretien très insuffisant.
GD : C’est le problème de tous les érudits qui veulent livrer le fruit de leurs recherches, non ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr, mais les moliéristes ont un avantage considérable sur nous autres qui essayons, à propos de Molière, de remettre les pendules à l’heure de Louis XIV… l’avantage de n’avoir qu’à véhiculer des clichés acceptés de tous. Rien n’est plus reposant que de se contenter de répéter ce que tout le monde connaît ou croit connaître. Nous autres qui questionnons le dogme moliériste avons le lourd handicap de devoir déplaire, surprendre ou agacer, et cela presque à chaque minute de nos discussions. Or les gens n’aiment rien mieux qu’entendre ce qu’ils connaissent déjà, mais cela vous le savez aussi bien que moi, en tant qu’universitaire.
GD : Je sais, pour en avoir été la victime, qu’il est toujours difficile de se déprendre d’idées toutes faites dont on s’était jusqu’ici parfaitement accommodé. Mais mise à part cette routine intellectuelle que vous rencontrez chez la plupart de vos contradicteurs, je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que vous n’aimez guère les moliéristes.
DENIS BOISSIER : Ils ont fait beaucoup de mal à Pierre Louÿs, et aussi à Henry Poulaille [auteur de Corneille sous le masque de Molière, 1957], et récemment ils ont calomnié un scientifique sincère et modeste : Dominique Labbé [Corneille dans l’ombre de Molière, histoire d’une découverte, 2003].
GD : Que reprochez-vous aux moliéristes, ou plutôt au moliérisme ?
DENIS BOISSIER : La comparaison que je vais faire risque de choquer ceux qui n’ont pas réfléchi à cette question… mais il me paraît évident que le moliérisme, dans son fonctionnement le plus orthodoxe, exige de penser le XVIIe siècle avec une approche exclusivement moderniste, et de tout juger à l’aune de préjugés petits-bourgeois. A cause du moliérisme, la critique a même fini par croire à ses propres leurres, notamment à l’ « école classique » dont nous avons déjà parlé [voir : Premier dialogue], mais aussi à ce cliché si réducteur que l’on pourrait intituler « Corneille grand chrétien ».
GD : Pour vous, Corneille n’est pas un poète chrétien.
DENIS BOISSIER : Corneille est un poète tout court. Pour vous, Victor Hugo est-il chrétien ?
GD : Pas vraiment.
DENIS BOISSIER : Eh bien, Pierre Corneille est chrétien comme Victor Hugo a pu l’être. Ce sont tous deux des continents. Ils ont en eux et dans leur œuvre tous les climats moraux, et génèrent toutes les perspectives. Il y a du chrétien en Pierre Corneille, bien évidemment (comment ne pas être chrétien en pleine période de crise sociale dévote et lorsqu’on a grandi dans une famille pieuse !), mais aussi du païen et même, d’après l’abbé d’Aubignac qui le connaissait bien, de l’ « hérésie », jusque dans son œuvre la plus religieuse : L’Imitation de Jésus-Christ [« On y compterait plus de cinquante hérésies, ou du moins cent propositions que l’on qualifierait en Sorbonne proches de l’hérésie. » Troisième Dissertation, 1663, p. 162].
GD : Vous voyez dans le moliérisme le modèle universitaire de l’interprétation "politiquement correcte".
DENIS BOISSIER : Pas seulement moi, beaucoup d’historiens et même certains moliéristes plus lucides sur cette question que leurs confrères. Quand on pense que certains font de Molière un « grand chrétien » ! « Molière grand écrivain » et « Molière parfaitement honnête homme » ne leur suffisaient pas. Ils veulent aussi que Molière soit « un grand chrétien », ce qui eût fait hurler de rire, mais plus encore de colère, ses contemporains qui ne lui reconnurent, dès 1660, que le talent d’avoir été le « premier farceur de France ».
GD : En 1660 certainement, mais plus tard ?
DENIS BOISSIER : Des années plus tard l’académicien Valentin Conrart le définissait très exactement comme le « Héros des Farceurs ».
GD : Les contemporains ne sont pas toujours bons juges et souvent la postérité a consacré des artistes qui ont été incompris de leur temps.
DENIS BOISSIER : En effet. Toutefois, en ce qui concerne Molière il ne s’agit pas tant de savoir si ses contemporains l’ont vu tel qu’il était que de voir comment l’exégèse moderne en est arrivée à l’encenser toujours plus. Prendre conscience de cela, c’est aborder l’aspect politique de l’Affaire Corneille-Molière.
GD : Ce serait plus une affaire politique que littéraire ?
DENIS BOISSIER : Evidemment. Comme je vous l’ai dit dans notre Premier dialogue, la France de l’après Révolution française avait besoin d’un « écrivain du peuple ». Faute d’alternative, elle a choisi Molière et pour les besoins de la cause elle a dénaturé sa vraie carrière.
GD : Molière serait un mythe politique ?
DENIS BOISSIER : On peut dire cela ainsi puisqu’on a étudié un théâtre carnavalesque à but politique comme s’il s’était agi d’une œuvre de littérature, qui plus est subversive. Corneille et Racine sont des littéraires. Sade ou Marx sont subversifs. Molière, lui, n’est ni littéraire ni subversif. Il a toujours agi dans le cadre du carnaval et n’a jamais remis en question les fondements de la société particulièrement arbitraire et injuste dans laquelle il vivait en « fat » et en « gros seigneur », comme l’a défini, je vous l’ai dit, son ami Dassoucy. Cette distorsion de la vérité historique, propre au moliérisme, est la conséquence d’une idéologie : celle de la Troisième République qui a fait de l’Université sa domestique. Or, le fruit de toute idéologie peut être assimilé à un mythe. Pas au sens antique de ce beau mot, mais au sens moderne qui est devenu, hélas, le sien : un mensonge. En l’espèce, un mensonge politique et culturel.
GD : Mais comment a-t-on pu si facilement arranger la vérité historique ? Je crois qu’il est nécessaire de revenir sur ce point. Il fallait bien qu’elle s’y prêtât, cette vérité historique, pour se retrouver, selon vous, à ce point travestie ?
DENIS BOISSIER : Dans un sens, oui. Et je vais vous dire comment. Puisque Molière avait été bouffon du roi, il suffisait de gommer le roi, de gommer le Service du Roi, d’occulter l’écriture collégiale des comédies, les collaborateurs de Molière, la notion de prête-nom, le rôle de Pierre Corneille… pour obtenir le produit idéologique parfait : « Molière génial et familier », c’est d’ailleurs le titre d’une biographie officielle de Georges Bordonove. Il a suffi de ne retenir que l’aspect people et légendaire du bouffon du roi, en prenant soin, évidemment, de ne pas dire que Molière avait tenu très précisément cet « emploi » [cf. Premier placet au Roi, 1664]. Ainsi, à nos yeux de modernes candides, Molière gardait tous les avantages d’avoir été à la fois un « être à part », comme l’a défini l’historien Gérard Moret, un comédien très populaire et, apparemment, un auteur subversif. Il suffisait de ne mettre en avant que ses caractéristiques positives et d’effacer ce fait historique incontestable que Molière a toujours été aux ordres de Louis XIV.
GD : Et, selon vous, c’est ce qu’a fait le moliérisme ?
DENIS BOISSIER : C’est ce qu’il a fait et continue de faire. Le moliérisme a la charge d’entretenir la Légende dorée de Molière puisque celle-ci, par raison d’Etat, est désormais classée "vérité nationale". Ce que la Sorbonne a fait avec Molière en 1880, l’Eglise, dans le même temps, l’a fait avec Jeanne d’Arc. Toute l’infrastructure politique de la stratégique ascension de Jeanne d’Arc, qui fut un personnage complexe et continuellement manipulé, a été gommée au profit d’un légendaire absurde, mais qui plaît beaucoup aux médias et aux historiens dévots [sur ce sujet lire Philippe Erlanger, Charles VII, 1945, qui réduit à peu de chose la biographie dévote de la « pucelle »].
GD : C’est intéressant que vous évoquiez Jeanne d’Arc car sous la Troisième République, on a opposé Molière à Jeanne d’Arc.
DENIS BOISSIER : Oui, l’homme du peuple contre l’élue de Dieu. La République contre l’Eglise.
GD : N’est-ce pas Voltaire qui a commencé le travail de déification de Molière ?
DENIS BOISSIER : Disons que c’est le premier qui fut assez influent pour conditionner la postérité. Il a fait de Molière un philosophe [« Molière avait d’ailleurs une autre sorte de mérite, que ni Corneille, ni Racine, ni Boileau, ni La Fontaine n’avaient pas : il était philosophe, et il l’était dans la théorie et dans la pratique », Siècle de Louis XIV, 1751]. Voltaire a rabaissé Corneille, dont il jalousait le talent de poète dramatique, et mis sur un piédestal Molière, dont il n’avait rien à jalouser, et dont il fit le fer de lance de sa politique anti-jésuite. C’est sous son règne intellectuel que l’on a déboulonné le buste de Corneille qui était à l’Académie française pour le remplacer par celui de Molière, enfin, si on veut, car ce n’est pas du tout le visage de Jean-Baptiste Poquelin que ce buste-là. Mais, avant Voltaire, il y a eu La Grange et Vivot.
GD : En 1682.
DENIS BOISSIER : Oui. Jean Vivot, comme je vous l’ai dit, était directement aux ordres de Louis XIV [voir Deuxième dialogue].
GD : Ensuite c’est Grimarest en 1705.
DENIS BOISSIER : Qui, lui, était aux ordres de Fontenelle, alors censeur royal. Puis vient La Serre en 1734, lui aussi censeur royal. Vous avez là les quatre évangélistes du Dieu fait comédien.
GD : Il a donc fallu un officier du roi et deux censeurs royaux pour faire de Molière un pur produit idéologique.
DENIS BOISSIER : Grâce aux efforts de Voltaire et de ses épigones on a élu de façon posthume Monsieur de Molière à l’Académie française. Ce quarante et unième fauteuil, c’est en quelque sorte la victoire de l’anticléricalisme.
GD : Si Molière a été un libertin notoire, comme vous le pensez, cette élection posthume est en partie justifiée.
DENIS BOISSIER : Jean-Baptiste Poquelin était un libertin qui vécut dans la mouvance des anciens gouliards, lesquels étaient des poètes libertins et des chansonniers politiques. Mais ce n’est pas Jean-Baptiste Poquelin qui a été immortalisé au milieu de vieux barbons, c’est l’auteur du Tartuffe et du Misanthrope. Or, comme j’ai eu le plaisir d’essayer de vous en persuader, Molière a tout été sauf l’auteur du Tartuffe et du Misanthrope. Molière a surtout été le plus assidu des courtisans. Ce n’est pas moi qui l’affirme, c’est La Grange, qui fut son bras droit [Préface à l’édition de 1682 des Œuvres de Monsieur de Molière]. En faisant entrer de force Molière à l’Académie française, c’est Mascarille qu’on a élu. Le plus injuste, c’est qu’en croyant rendre hommage à l’auteur de Tartuffe, on assassine Corneille. Car plus on élève Molière, plus on se détourne de Corneille.
GD : Et c’est cela, je crois, qui vous blesse le plus… cette injustice. J’ai eu le même sentiment lorsque j’ai assisté à je ne sais plus quelle soirée de remise des césars, et que j’ai vu le grand metteur en scène Alain Resnais remettre un césar au très commercial réalisateur Claude Zidi, lequel fut applaudi comme s’il avait été Marcel Carné ou Sacha Guitry. J’en ai été choqué, et même gêné pour Alain Resnais.
DENIS BOISSIER : On place sous les projecteurs la France de Molière et de Zidi et on relègue dans les coulisses la France de Corneille et de Resnais…
GD : La « France de Molière », c’est une formule que le XIXe siècle a souvent utilisée.
DENIS BOISSIER : Ne voyez là qu’une conséquence de l’influence du moliérisme qui travaille depuis plus d’un siècle à la création d’un Molière exemplaire. C’était un farceur issu des tréteaux du Pont-Neuf, il en fait un érudit sorti du plus célèbre des collèges dirigés par les jésuites. C’était un jeune homme sans grande personnalité amoureux d’une femme de tête, il efface le rôle de Madeleine Béjart et il attribue à Molière la création et la direction de la troupe de l’Illustre Théâtre. C’était un libertin assez inculte, il en a fait un moraliste et un puits d’érudition à rendre jaloux Bouvard et Pécuchet [héros d’un roman éponyme célèbre de Flaubert], quitte à occulter le fait que sa bibliothèque ne contenait pas cent cinquante ouvrages. On a voulu oublier que son premier biographe avait dit que Molière « était l’homme du monde qui travaillait avec le plus de difficulté » (Vie de Monsieur de Molière, 1705) et on le crédite de plusieurs chefs-d’œuvre quasi spontanés. Molière s’était montré pendant toute la seconde partie de sa vie le plus zélé des courtisans. On oublie ce détail et on en fait un humaniste. En 1848, après qu’on eut renversé Louis-Philippe, comme on ne voulait plus rien avoir en commun avec le règne de Louis XIV et de ses successeurs, on a jeté aux oubliettes tous les contradicteurs de Molière pour ne garder que l’"auteur" du Tartuffe, autrement dit une icône idéologique. Cela avait pour avantage de pouvoir lui faire dire ce qu’il n’avait jamais pensé. Comme l’a constaté bien avant moi le professeur Jean-Jacques Weiss, le valet de chambre s’est transfiguré en un héros du peuple [« Savez-vous quand a commencé l’admiration absolue et de parti pris pour Molière ? Dans les premières années du XIXe siècle, à l’époque de la Restauration, quand s’était engagée la querelle entre le parti libéral et le parti congréganiste, c’est alors qu’on a sacrifié à Molière comme à une divinité, il avait fait Tartuffe, il devenait sacré ! […] Le valet de chambre tapissier de Louis XIV converti en citoyen ! » Jean-Jacques Weiss, Molière, 1900, p. 7]. Dans ces conditions, oui, on peut dire que le "Molière" de l’Après Révolution et plus encore le "Molière" de la Troisième République est un mythe littéraire et le parangon de l’esprit petit-bourgeois.
GD : Qu’on ait magnifié Molière, je vous l’accorde, mais de là à penser qu’il n’a pas écrit une ligne.
DENIS BOISSIER : Je n’y suis pour rien si nous n’avons aucune ligne de sa main. Savait-il seulement écrire correctement, cet homme qui ne laissa aucun manuscrit, aucune note, aucune dédicace, aucune correspondance et dont jamais personne ne fit connaître une seule lettre professionnelle ou personnelle ?
GD : On ne conserve non plus aucune lettre de Rotrou.
DENIS BOISSIER : C’est normal, Rotrou a plusieurs caractéristiques qui expliquent cela. Primo, c’est un auteur de la génération de Corneille, et l’on a moins de documents pour cette génération. Deuxio, les dernières années de Rotrou s’enfoncent dans un brouillard biographique. Tertio, Rotrou n’était pas au centre de l’infrastructure médiatique de Louis XIV et il n’avait pas les mêmes nécessités de correspondre avec tout le monde. Quarto, Rotrou est aujourd’hui infiniment moins célèbre que Molière et l’on n’a pas fait pour lui le centième des recherches que l’on a faites pour Molière. Nous avons des correspondances, des dédicaces, des annotations des frères Corneille, de Boileau, de Racine, de tous les auteurs célèbres, sauf de Molière. Or Molière fut de tous ces écrivains célèbres le plus célèbre et celui qui, à cause de sa position de directeur de théâtre et de favori du Roi, aurait dû laisser le plus de témoignages de son activité. Mais il ne laisse rien.
GD : Oui, il y a là un mystère qui dérange. Et qui inquiète les moliéristes eux-mêmes.
DENIS BOISSIER : Pour le vétéran Louis Loiseleur « il y a là un mystère plus obscur encore que tous ceux que nous cherchons à éclaircir dans cette étude. » [Les points obscurs de la vie de Molière, 1877, p. 194, note]. Et pourtant Loiseleur s’était fait une spécialité d’étudier les points obscurs de la vie et de la carrière de Molière.
GD : Aucun moliériste n’a proposé d’explication à cette lacune de manuscrit ?
DENIS BOISSIER : Aucun. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont soin de toujours utiliser le terme « disparition » plutôt que celui d’ « absence » ; le mot « disparition » induit tout naturellement à penser que les manuscrits ont existé. Mais ces manuscrits n’ont à l’évidence jamais existé, et pas davantage son testament olographe.
GD : Il est temps, je crois, que vous nous parliez de la solution que vous proposez.
DENIS BOISSIER : La solution de ce « mystère » pourrait être aussi simple qu’historiquement probable : jamais les bouffons du roi n’ont écrit ; d’autres écrivaient pour eux ; Molière ayant été le bouffon du roi n’a, dans cet « emploi », rien écrit par lui-même. Pour les farces, c’était une équipe collégiale, pour les pièces de prestige, c’était Pierre Corneille.
GD : Une solution radicale.
DENIS BOISSIER : Cela fait deux cents ans que l’on s’interroge sur Molière, deux cents ans que l’on avance des hypothèses qui ne tiennent pas la route, deux cents ans que l’on répète qu’il y a un « mystère Molière ». La solution que j’apporte a au moins le mérite de répondre à une centaine de questions restées jusqu’ici sans réponse [voir dans le site corneille-moliere.org : « Position de thèse » et « Droit de réponse aux réponses de M. Georges Forestier », rubrique A LIRE EN PRIORITE]. Oubliez un instant le Molière des manuels scolaires et voyez en face le farceur Jean-Baptiste Poquelin que le destin a élu pour être le fou du roi. Il entre dans une organisation que l’on peut appeler, pour simplifier, le Service du Roi, section "bouffonnariat". Le Service du Roi a pour seul but de satisfaire Sa Majesté. Le "bouffonnariat" étant une institution depuis le Moyen Age, toute une équipe a toujours écrit pour le bouffon du roi, c’est-à-dire selon la volonté du roi.
GD : Vous voulez dire que Molière était entouré de toute une équipe de collaborateurs.
DENIS BOISSIER : Evidemment ! Non seulement il était le bouffon du roi, mais aussi un entrepreneur de spectacles. Chacun de ses deux métiers est déjà un métier à plein temps. Et il fut aussi la vedette de sa troupe, c’est-à-dire le comédien qui joue les plus longs rôles. Cela aussi, c’est un métier à part entière. Où aurait-il trouvé l’énergie, le temps et l’état d’esprit pour composer des chefs-d’œuvre dont certains requièrent une formation intellectuelle poussée ? Il est même probable que Molière n’a jamais su réellement écrire. A son époque, je vous le rappelle, quatre-vingt-dix pour cent des gens ne savaient pas écrire correctement. Comment se présente Poquelin en 1643 ? Comme un assistant-farceur du Pont-Neuf. Comment se présente-t-il en province ? Comme un membre d’une troupe qui favorise la farce italienne. Comment se présente-t-il en 1658, devant Louis XIV ? Comme celui qui va réussir à plaire au roi uniquement en jouant des farces. Ajoutons que les farceurs étaient alors tous issus de basse condition et qu’un farceur n’avait aucun besoin de maîtriser l’alexandrin des Femmes savantes ou du Misanthrope. Il n’est d’ailleurs pas indispensable de savoir écrire pour être comique.
GD : Si les farceurs étaient issus d’un milieu social défavorisé, Molière, lui, était tout de même fils de tapissier du Roi.
DENIS BOISSIER : On peut donc être certain que ses parents lui ont très tôt appris à compter. D’ailleurs il a très bien su gérer la fortune que son « emploi » auprès de Louis XIV lui procurait. Mais savoir écrire son nom en bas d’un acte administratif ou juridique est une chose, écrire Tartuffe en est une autre. Un de ses proches a-t-il jamais témoigné avoir vu Molière écrire une pièce ? Jamais !
GD : Quelqu’un a-t-il dit avoir vu Pierre Corneille au travail ?
DENIS BOISSIER : L’écrivain Chapelain, par exemple, a raconté qu’il a rendu visite à Corneille alors que celui-ci écrivait sa tragédie Horace.
GD : C’était juste pour savoir… Revenons à Molière. Pourquoi n’aurait-il pas fait d’études ? Pourquoi lui refuser le bénéfice du doute ? Vous vous êtes expliqué sur ce point dans notre Deuxième dialogue, mais j’aimerais y revenir. Nous savons que jusqu’à l’âge de quatorze ans, Jean-Baptiste Poquelin n’a pas fait de scolarité et qu’il est resté auprès de son boutiquier de père. Mais après ?
DENIS BOISSIER : En décembre 1637 Jean-Baptiste, âgé de quinze ans, a prêté serment devant la corporation des Tapissiers, ce qui signifie qu’il a fait sérieusement son apprentissage et qu’il a été admis dans la profession. En ce temps-là avoir quinze ans ne signifie pas qu’on est un adolescent, mais qu’on a l’âge de succéder à son père. A quinze ans en ce temps-là beaucoup exercent déjà un métier. De plus, comme il s’agit d’une charge assez prestigieuse, il serait illogique que Poquelin père, lequel fonde ses espoirs sur son fils aîné, veuille dans le même temps qu’il fasse de longues études destinées, à cette époque, aux seuls clercs ou ecclésiastiques. Cela aurait été comme s’il poussait son fils à s’éloigner des affaires.
GD : Peut-être Jean-Baptiste s’est-il sur ce point opposé à la volonté de son père ?
DENIS BOISSIER : Rien ne l’indique. Constatons aussi que Molière n’a jamais fait allusion à une scolarité, encore moins à une éducation reçue chez les jésuites. Alors que Corneille, Racine, La Fontaine ou Boileau, pour ne citer qu’eux, n’ont pas manqué d’y faire allusion… De même, jamais personne n’a dit avoir enseigné quoi que ce soit à Molière.
GD : Qui s’est vanté d’avoir enseigné quelque chose à Pierre Corneille ?
DENIS BOISSIER : Le Révérend père Delidel, son professeur de latin. Corneille lui a d’ailleurs dédié une de ses traductions pieuses. Vous savez, les contemporains de Molière auraient été abasourdis par l’incroyable vénération qu’on lui voue et le culte qu’on entretient. Faut-il rappeler que ceux qui le connurent n’ont jamais considéré les pièces qu’il signait comme des œuvres littéraires ? Pour les contemporains de Molière tout ce qui sortait de son entreprise théâtrale n’était que des comédies, avec cette connotation péjorative qui accompagnait alors le mot « comédie ». Tout le monde savait que Molière, avec la bénédiction du roi qui en matière littéraire était un ignare, avait fait régresser le théâtre. Pour ses contemporains, c’était d’autant plus regrettable que le théâtre venait d’acquérir ses lettres de noblesse grâce à Richelieu et Pierre Corneille.
GD : Le premier étant le protecteur du second. Pour les intellectuels d’alors Molière fait rire le public au lieu de le faire réfléchir et de l’éduquer.
DENIS BOISSIER : C’est cela. On l’accusait d’avoir ramené le théâtre à son niveau le plus bas.
GD : Il y a pourtant de la profondeur dans certaines de ses comédies.
DENIS BOISSIER : S’il y a de la profondeur dans son théâtre collégial, c’est grâce à son principal collaborateur Pierre Corneille, lequel savait très bien ce qu’il faisait en travaillant pour le bouffon du roi. Il a toujours essayé de ménager la chèvre et le chou, de trouver un juste milieu afin de plaire à l’élite et au peuple : Le Menteur, Les Fâcheux, L’Ecole des Femmes en sont de bons exemples.
GD : Revenons au moliérisme. Pour vous, il empêche de voir et de comprendre ce que fut réellement le XVIIe siècle.
DENIS BOISSIER : Né de l’idéologie politique de la Troisième République, le moliérisme empêche de mesurer combien le XVIIe siècle est un siècle de faux-semblants durant lequel l’hypocrisie est devenue un art social. Je ne puis donc que regretter le monopole qu’exercent à la Sorbonne les « dévots de Molière ».
GD : De leur côté, les moliéristes reprochent aux partisans de Pierre Louÿs de n’être pas des « dix-septiémistes . Ils vous accusent aussi d’être de « mauvaise foi ». Qu’avez-vous à leur répondre ?
DENIS BOISSIER : Comme je vous le disais en ouverture à ces Cinq dialogues, on peut passer toute sa vie assis sur un banc d’école et n’en être pas pour autant plus lucide. C’est tellement facile d’apprendre les préjugés de ses maîtres. C’est Désiré Nisard qui a donné le ton à la Sorbonne républicaine. Nisard a engendré Brunetière qui engendra Lanson qui engendra… etc. Et nous arrivons à Georges Couton qui vient d’être remplacé par Georges Forestier. Tous ces gens sont payés par des institutions qui, en raison même de leur origine politique, ne se préoccupent absolument pas de remettre en question quoi que ce soit. Et pour rendre inébranlable toute cette idéologie sous-jacente, la Bibliothèque de la Pléiade publie les hagiographies moliéristes comme paroles d’évangile… Cela dit, il est exact que les défenseurs des thèses de Pierre Louÿs ne sont pas tous des spécialistes du XVIIe siècle. C’est le cas notamment de Cyril et Dominique Labbé, spécialistes en calcul intertextuel. Mais précisément, leurs études assistées par ordinateur ne portent que sur le calcul intertextuel du corpus Corneille-Molière. Or les calculs prouvent – et ce sont les statistiques qui parlent – que seize pièces signées Molière sont de la main de Corneille. Heureusement que MM. Labbé ne sont pas dix-septiémistes ! S’ils l’avaient été, jamais ils n’auraient eu l’idée, jugée blasphématoire, de se lancer dans des analyses lexicales comparatives.
GD : C’est donc un atout, pour vous, de n’être pas un moliériste si on veut résoudre le « mystère Molière ».
DENIS BOISSIER : C’est au moins un gage d’indépendance intellectuelle. D’ailleurs, les moliéristes ne veulent pas résoudre le « mystère Molière ». Pour eux, l’existence de Molière est aussi évidente que celle de Jésus pour un curé. Pour eux, il n’y a pas de contradictions, d’obscurités, d’anomalies dans la vie et la carrière d’un fils de Tapissier devenu un dieu national : il n’y a que la pure et stricte réalité historique. Les moliéristes forment une chapelle universitaire et ne s’en cachent pas d’ailleurs puisqu’ils ont les institutions avec eux. Les continuateurs de Pierre Louÿs, ou si vous préférez les cornéliens (à ne pas confondre avec les corneillistes qui sont tous des moliéristes) regroupent des chercheurs venus d’horizons différents. Qu’ils soient écrivains, professeurs, historiens, metteurs en scène, les continuateurs de Pierre Louÿs sont de « mauvaise foi » uniquement parce qu’ils n’ont pas reçu l’imprimatur de la Sorbonne.
GD : Cela me fait songer aux Gros boutiens et Petits boutiens de Lilliput, ces deux camps qui s’affrontent à longueur de temps au lieu de déguster tranquillement leurs œufs par le bout qu’ils veulent.
DENIS BOISSIER : Personnellement je déplore que moliéristes et cornéliens ne puissent pas travailler ensemble à l’éclaircissement de ce qui les oppose. Mais le fait que jamais un seul moliériste n’a supposé nécessaire d’élever le moindre doute sur Molière est la preuve, à nos yeux, du grave vice de forme du moliérisme.
GD : Et selon vous, ce n’est pas prêt de changer ?
DENIS BOISSIER : Non. Et la raison de cet immobilisme est toute simple : raison d’Etat. Molière est l’icône de la France, pas question d’aller enquêter sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
GD : Et qui rapporte beaucoup d’argent…
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Ce qui, dans une société comme la nôtre, le met plus encore à l’abri de tout soupçon. Voilà pourquoi travailler sous le patronage du CNRS, ainsi que le fait Dominique Labbé, est un atout non négligeable, de même qu’enquêter avec la formation d’un docteur en histoire comme l’a fait Gérard Moret. Et pour parler théâtre, le comédien, professeur d’art dramatique et metteur en scène Jean-Laurent Cochet est bien placé, non ?
GD : Jean-Laurent Cochet partage votre conviction ?
DENIS BOISSIER : Oui. Il l’a d’ailleurs dit publiquement à plusieurs reprises [Lire dans le site corneille-moliere.org : « Impromptus sur l’Affaire Corneille-Molière », rubrique INVITES]. Mais sans doute va-t-on classer M. Cochet dans la catégorie des gens de « mauvaise foi ».
GD : Le combat d’idées est donc à ce niveau : ceux qui ont la foi en Molière et ceux qui, parce qu’ils doutent de Molière, sont de « mauvaise foi ».
DENIS BOISSIER : C’est en ces termes que s’est exprimé sur le site CRHT le professeur Georges Forestier, porte-parole des moliéristes.
GD : Je constate qu’il y a aussi de la « mauvaise foi » chez les moliéristes puisque j’en ai entendu qui disaient que vous doutiez de Molière parce que vous étiez des chercheurs livresques et que vous ne connaissiez rien au théâtre ni au monde de la scène. Ce reproche est d’autant plus de « mauvaise foi » que c’est chez les cornéliens qu’il y a, proportionnellement, le plus de professionnels du théâtre. Pierre Louÿs et Henry Poulaille étaient des poètes. Hippolyte Wouters est auteur dramatique, Pascal Bancou aussi [l’une de ses comédies, L’Imposture comique, créée en 2000, a pour sujet la collaboration Corneille-Molière]. Vous-même avez écrit de nombreuses dramatiques pour France Culture.
DENIS BOISSIER : Pierre Louÿs n’était pas qu’un poète, c’était aussi un érudit et un spécialiste de l’alexandrin. J’ai lu les essais où il explique la différence entre un vers de Pierre Corneille, d’André Chénier ou de Victor Hugo… A l’évidence, l’alexandrin est sa langue maternelle. Alors que le professeur Georges Forestier a déclaré qu’il n’arrivait pas à différencier du Pierre Corneille, du Philippe Quinault ou du Racine [« Moi-même, lorsque j’entends tel court passage de Boyer, Quinault, Thomas Corneille, sans connaître l’auteur du passage, je suis bien incapable de dire de qui il s’agit, hésitant entre Corneille, Racine et les trois auteurs cités… », sur le site CRHT].
GD : Ce n’est pas toujours facile, en effet.
DENIS BOISSIER : Question d’oreille. Il y a autant de différences entre une tirade de Pierre Corneille et une de Philippe Quinault qu’il y en a entre une musique de Gabriel Pierné et une d’Offenbach. Vous qui êtes un fan des Beatles, ne savez-vous pas reconnaître une chanson des Beatles d’une chanson des Bee Gees, ou un morceau des Pink Floyd d’un morceau de Led Zeppelin ?
GD : Bien sûr que si ! Comme je suis sûr de reconnaître une œuvre de Debussy d’une œuvre de Saint-Saens.
DENIS BOISSIER : Eh bien, c’est la même chose avec Corneille ou Racine. Question d’habitude. Vous savez ce qu’un éminent moliériste a écrit pour nier l’étonnante ressemblance stylistique entre certaines scènes signées Molière et celles signées Pierre Corneille ? Qu’une telle ressemblance ne prouve rien car des analogies se retrouvent dans toutes les œuvres d’une même génération. Une seule phrase lui a suffi pour enterrer l’Affaire Corneille-Molière. Formidable, non ?
GD : Voyons, cet argument n’en est pas un. Jamais deux chefs-d’œuvre, même d’une même époque, n’ont eu le même style ni la même respiration.
DENIS BOISSIER : Dans sa biographie Molière, publiée en 2007, Alain Niderst a pourtant écrit cette réfutation, qui ne tient que dans une seule petite ligne reléguée en bas de page : « Les analogies stylistiques ou dramaturgiques ne sont pas probantes, puisqu’on les retrouverait aussi bien entre tous les auteurs de théâtre de la même génération. » [p. 9, note 1].
GD : J’ai du mal à admettre que l’on puisse régler ainsi le problème de la similitude entre l’alexandrin de Molière et celui de Corneille.
DENIS BOISSIER : C’est contre cette façon de procéder que Pierre Louÿs se battait il y a déjà cent ans. Louÿs n’était pas un dix-septiémiste usiné par la Sorbonne, c’était un vrai érudit, ses nombreux travaux sur les XVe et XVIe siècles l’attestent, ainsi que sa bibliothèque qui comptait plus vingt mille ouvrages, dont plus de deux mille rarissimes. D’ailleurs, s’il est exact qu’on reconnaît un arbre à ses fruits, nous pouvons être rassurés : son élève fut Frédéric Lachèvre qui a vite été reconnu comme l’un des plus subtils érudits des XVe et XVIe siècles. Certes, il ne fut pas maître de chaire, mais Pierre Louÿs prouva surabondamment qu’il était un parfait connaisseur de la poésie française. Il fut même, et cela vaut tous les diplômes que des sourds offrent à des sourds ou que des aveugles délivrent à des aveugles, le conseiller technique de Paul Valéry quand celui-ci composait La Jeune Parque.
GD : C’était avant l’affaire Corneille-Molière ?
DENIS BOISSIER : Oui. La Jeune Parque a été publiée en 1917, et Pierre Louÿs a fait connaître sa thèse le 16 octobre 1919.
GD : Octobre est le mois qui convenait puisque c’est celui que les Grecs consacraient à Dionysos, le dieu du théâtre. Mais revenons au moliérisme. Au fond, ce que vos adversaires vous reprochent, c’est de ne pas partager leur foi en Molière.
DENIS BOISSIER : Oui. Pour cette chapelle de « dévots » nouvelle mouture qui vénèrent celui que leurs ancêtres sorbonnards ont tellement haï, quiconque ose dire que Molière a subi la tutelle intellectuelle de Madeleine Béjart ou de Pierre Corneille et plus encore la volonté de Louis XIV, est de « mauvaise foi » et veut « induire en erreur » le brave concitoyen qui paie ses impôts, lesquels, notons-le, financent la Sorbonne.
GD : Votre combat semble désespéré. Dès les petites classes on apprend à considérer Molière comme un « grand homme ».
DENIS BOISSIER : Oui, cela s’appelle du conditionnement. En France, tout le monde naît moliériste. Mais à l’âge adulte, ne serait-il pas temps d’aller voir au-delà des idées reçues ?
GD : C’est beaucoup demander.
DENIS BOISSIER : Si l’on veut combattre l’IPPB, c’est un minimum.
GD : Pour ceux qui l’auraient oublié, rappelez-nous ce qu’est l’IPPB.
DENIS BOISSIER : L’Impérialisme des Préjugés Petits-Bourgeois [voir Premier dialogue].
GD : Combattre l’IPPB est votre engagement personnel ?
DENIS BOISSIER : C’est le combat de ceux qui pensent par eux-mêmes et qui constatent que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Vous souriez, mais il y a une véritable guerre idéologique entre les moliéristes et les cornéliens. Nous gênons les moliéristes et les institutions qu’ils protègent parce que nous démontrons que le Molière présenté par l’Université est plus un mythe républicain qu’un sujet de Louis XIV.
GD : Vous demandez aux dix-septiémistes de revoir leurs copies ! Vous leur dites qu’ils ont passé leur vie studieuse à se tromper du tout au tout, et vous voudriez qu’ils lisent vos travaux et acquiescent à vos idées… C’est trop exiger, vous ne trouvez pas ?
DENIS BOISSIER : De notre point de vue, à nous autres « gens de mauvaise foi », Molière n’est pas une source de haute montagne mais un bassin. Ce n’est d’ailleurs pas nous qui l’affirmons mais un de ses contemporains, le gazetier Charles Robinet, lequel écrivait qu’on ne peut pas dire que Molière « soit une source vive, mais un bassin qui reçoit ses eaux d’ailleurs » [Panégyrique de l’Ecole des Femmes, 1663].
GD : En gros, on vous reproche de ne pas mettre Molière sur un piédestal.
DENIS BOISSIER : On nous fait le même procès qu’à ceux qui au milieu du XIXe siècle ne croyaient pas au « Miracle grec » et démontraient, avec les témoignages des Grecs eux-mêmes, que le « Miracle grec » était un concept aussi faux historiquement que médiocre intellectuellement.
GD : Le « Miracle grec », c’est le grand concept d’Ernest Renan, célébrissime auteur d’une Vie de Jésus…
DENIS BOISSIER : Renan fut en quelque sorte le chef de file des moliéristes du Siècle de Périclès. Comme le moliérisme pour Molière, la thèse du « Miracle grec » interdisait aux hellénistes de rattacher la Grèce à rien d’autre qu’elle-même. On affirmait que la Grèce était absolument originale et qu’elle était la source que toute civilisation digne de ce nom.
GD : Mais aujourd’hui ce préjugé est abandonné.
DENIS BOISSIER : Mais il a perduré plus d’un siècle ! Désormais nous admettons que la Grèce doit l’essentiel de sa religion, de sa mythologie, de son ésotérisme, de sa physique, en un mot de sa culture, à l’Egypte et à la Crête, à la Chaldée mathématicienne, mais aussi à la fière région du Caucase.
GD : D’où était originaire Prométhée, le grand dieu des Grecs.
DENIS BOISSIER : Exactement.
GD : Et vous voudriez qu’on fasse pour Molière ce qu’on a fait pour la Grèce, qu’on reconnaisse ce qu’il doit à d’autres.
DENIS BOISSIER : Ce serait un bon début.
GD : Pour réfuter le dogme du « Miracle grec », il aurait simplement suffi aux hellénistes de lire sans parti pris Platon ou Plotin, Pythagore ou Diodore, lesquels écrivaient en toutes lettres qu’ils devaient beaucoup aux Egyptiens.
DENIS BOISSIER : Mais les hellénistes d’hier, comme les moliéristes d’aujourd’hui, ne voulaient rien savoir et considéraient comme des blasphèmes tout ce qui pouvait rabaisser leur déesse : la Grèce éternelle. Comme Molière, la Grèce de Périclès était parfaite. Et vous savez pourquoi on a cru dur comme marbre au « Miracle grec » ? Parce qu’Ernest Renan, Monsieur Collège de France, par le biais de l’IPPB, avait contaminé ses confrères au point qu’ils en étaient devenus presque tous dogmatiques et hypocrites.
GD : Il y a souvent à l’origine des préjugés universitaires un intellectuel très influent… Un seul intellectuel très médiatisé suffit pour que tous les suiveurs entonnent la litanie.
DENIS BOISSIER : Comme il a suffi en 1870 d’une poignée de moliéristes pour qu’une chapelle se forme et avec elle, un organe officiel : Le Moliériste [création : 1879]. Chaque fois qu’il y a parasitage de l’esprit scientifique, comme ce fut le cas avec l’hellénisme du Collège de France ou le dix-septiémisme de la Sorbonne, c’est parce que l’esprit petit-bourgeois s’en mêle.
GD : Ce n’est donc pas tant aux moliéristes et aux corneillistes que les continuateurs de Pierre Louÿs s’opposent, mais à l’esprit petit-bourgeois.
DENIS BOISSIER : Bien obligés. L’esprit petit-bourgeois ramène tout à l’aune de son jugement de classe. Et dans la catégorie petit-bourgeois, le moliériste, dans toute son envergure prudhommesque, est un cas remarquable. Même des bourgeois académiques comme l’écrivain Anatole France ou Ferdinand Brunetière ont été très sévères envers lui [lire notamment Brunetière, « Trois moliéristes », Revue des Deux-Mondes, 1884, T. 66]. Imaginez alors ce que pensaient des moliéristes des hommes de la trempe d’un Théophile Gautier ou d’un Léon Bloy ! Si les études sur Molière et Corneille avaient été entreprises par des hommes solitaires et non grégaires, des hommes comme Michelet, Flaubert ou Jules Vallès, pour rester dans le XIXe siècle, nous n’en serions pas là.
GD : Mais les solitaires ne créent jamais des écoles ni des chapelles !
DENIS BOISSIER : Non, ce sont uniquement les petits-bourgeois. Voilà pourquoi l’Affaire Corneille-Molière existe depuis près de cent ans. Le moliérisme est l’enfant naturel de la Marianne des mairies de la Troisième République et de Désiré Nisard, Monsieur Sorbonne en personne.
GD : Récemment un écrivain a publié un pamphlet intitulé Démolir Nisard [Eric Chevillard, 2006, Les Editions de Minuit].
DENIS BOISSIER : Il ne s’agit pas tant de démolir que d’abolir. Démolir peut être méchant et de tout façon c’est trop tard, le temps s’en est chargé. Mais il faut abolir Nisard. Abolir ce genre d’hommes qui obtient tous les honneurs à force de n’avoir rien d’autre à dire qu’amen aux sentiments nationaux, amen aux conventions sociales, amen aux préjugés de la classe dominante. Dans chaque activité humaine, il faut circonscrire le Désiré Nisard, l’Ernest Renan ou le Jules Lemaître. Dans la grande famille des dix-septiémistes, ceux qui ont le pouvoir et l’audience, ce sont les moliéristes. Les Désiré Nisard sont là. A tel point que les corneillistes sont depuis toujours obligés de leur faire allégeance. C’est pour cela qu’au lieu de se dire corneillistes, les continuateurs de Pierre Louÿs préfèrent le qualificatif de cornéliens.
GD : Pour vous, quelle est la différence fondamentale entre corneillistes et « cornéliens » ?
DENIS BOISSIER : Les corneillistes étudient Corneille et le comprennent grâce à ses œuvres, selon un critère presque toujours "petit-bourgeois chrétien". Pour les cornéliens, Corneille et Molière ne doivent pas être compris seulement par leurs œuvres mais par leur époque. Pour aller vite, ce qui explique Pierre Corneille, ce n’est pas seulement ce qu’il a écrit mais ce qu’il n’a jamais voulu ou pu écrire sous son nom, ou qu’il n’a pu dire qu’à demi-mot. De la même façon que le Tout est supérieur à la somme des parties, Corneille est beaucoup plus que la somme de ses œuvres. En d’autres termes, pour les corneillistes, Corneille est la somme de tout ce qu’il a écrit. Pour les cornéliens, Corneille est un tout qui non seulement englobe ce qu’il a écrit, mais aussi ce qu’il a écrit mais pas signé, ce qu’il a corrigé chez autrui, ce qu’il a voulu cacher tout en le disant, etc. Un artiste de l’envergure de Corneille a nécessairement écrit des œuvres qu’il n’a pas signées. Puisque c’est vrai pour ses confrères Alexandre Hardy, Rotrou ou Tristan L’Hermite, ça l’est plus encore pour Pierre Corneille.
GD : Parce qu’il avait plus de talent qu’eux ?
DENIS BOISSIER : Pas seulement. Nous savons que le caractère de Corneille était secret et que pour lui la littérature, comme l’a constaté Georges Couton, était une « cryptographie » [« La forme de pensée qui consiste à voir dans l’art et la littérature une cryptographie est certaine chez Corneille. » Corneille, 1958, p. 8]. De plus, à la fin de sa longue, très longue carrière, les mœurs se sont prêtées toujours plus à ces jeux de faux-semblants souvent subversifs. Combien d’œuvres littéraires ont-elles été publiées sans nom d’auteur ou sous un pseudonyme !
GD : Je pense comme vous qu’un grand artiste, surtout aussi discret que Corneille, ne peut être circonscrit dans les pages qu’il a laissées à la postérité.
DENIS BOISSIER : Mais c’est plus commode de le croire, et c’est aussi plus rassurant.
GD : Et plus reposant. Il suffit d’étudier et de répéter ce que d’autres ont étudié avant vous. Répéter les clichés ne coûte rien puisque le travail universitaire est déjà balisé.
DENIS BOISSIER : Mais Pierre Corneille n’est pas une statue. Ce fut un être humain. Il a forcément écrit des œuvres que nous ignorons ou dont nous ignorons qu’il en fut l’auteur.
GD : Selon vous dans quelle proportion ?
DENIS BOISSIER : De ce que nous connaissons de ses problèmes d’argent et des mœurs littéraires de son temps, je dirais que plus d’un tiers de sa production, évidemment la moins stylée, nous est inconnue. Comme ses modèles Alexandre Hardy ou Rotrou, Corneille a écrit beaucoup plus qu’il ne l’a reconnu… D’ailleurs il l’avoue lui-même dans une de ses poésies [cf. « Madrigal »]. Pierre Corneille est bien plus que ce que nous disons de lui, surtout depuis qu’une postérité dévote s’est fait un malin plaisir, de 1690 à 1750, à le réduire à l’image d’Epinal de « poète chrétien ». En raison même des caractéristiques de son siècle, le grand artiste que fut Corneille est nécessairement sorti des limites que la bienséance bourgeoise lui fixait, et cela aussi souvent qu’il le jugea utile à l’expression de son génie.
GD : Sans cela, Corneille ne serait que l’expression de son époque.
DENIS BOISSIER : Tout à fait. Or les corneillistes ne veulent rien découvrir au-delà de la surface bien plane que Corneille a laissé voir de sa personnalité, ou plutôt que ses proches survivants, Thomas Corneille et Fontenelle, qui exerça la fonction de censeur officiel, ont voulu laisser voir de lui.
GD : C’est vrai que le Corneille de la Sorbonne m’a semblé bien étriqué.
DENIS BOISSIER : Aussi étriqué qu’est surdimensionné Molière.
GD : C’est un choix politique ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Pour vous en convaincre, lisez les travaux du plus célèbre des dix-septiémistes américains, Ralph Albanese [Molière à l’Ecole républicaine, 1992 ; Corneille à l’école républicaine, 2008]. Les corneillistes ne tiennent presque jamais compte que Corneille vécut dans une époque où la contrainte de l’Eglise, de la Sorbonne et du Pouvoir était insupportable pour un artiste. Les corneillistes veulent que Corneille soit un auteur chrétien. Pourquoi ? Parce qu’il a traduit du latin plusieurs œuvres religieuses, notamment L’Imitation de Jésus-Christ. Nous avons donc droit au laïus sur « Corneille grand chrétien » et on s’arrête là.
GD : Devant l’éternelle statue de « Corneille grand chrétien »...
DENIS BOISSIER : Et si notre corneilliste est lui-même chrétien et petit-bourgeois, ce qu’ils sont presque tous, il en conclura que Corneille ne pouvait pas écrire pour Molière qui était un libertin notoire.
GD : Mais pour les cornéliens, j’imagine que les choses sont loin d’être aussi évidentes…
DENIS BOISSIER : En effet, sans aller très loin, puisque pour beaucoup de moliéristes Molière fut un « chrétien » doublé d’un « moraliste », rien n’empêchait le prétendu chrétien Corneille d’écrire pour le prétendu chrétien Molière.
GD : Une hypothèse à laquelle vous ne croyez pas.
DENIS BOISSIER : Croire que ces deux artistes aient fait du sentiment chrétien le moteur de leurs carrières ! Mais soit, suivons le faux raisonnement qui veut que Pierre Corneille ait été un chrétien convaincu parce qu’il a passé du temps à traduire des textes pieux. Première constatation : en suivant un tel raisonnement on méconnaît qu’à cette époque un écrivain traduisait des œuvres pieuses d’abord dans l’espoir de gagner beaucoup d’argent, car ces œuvres se vendaient bien. Et plusieurs témoignages prouvent que telle fut bien l’espérance de Corneille [Corneille avoua que « son Imitation lui avait plus valu que la meilleure de ses comédies, et qu’il avait reconnu, par le gain considérable qu’il y a fait, que Dieu n’est jamais ingrat envers ceux qui travaillent pour lui. » Gabriel Guéret, Promenade de Saint-Cloud : dialogue sur les auteurs, dans Bruys, Mémoires historiques, critiques et littéraires, 1751, II, p. 213]. Deuxième constatation : d’autres raisons peuvent avoir fait de Corneille un traducteur d’œuvres religieuses. Par exemple, il a très bien pu s’y atteler parce qu’il était athée.
GD : C’est un paradoxe !
DENIS BOISSIER : Pas du tout ! N’être pas directement concerné permet souvent de traiter efficacement un problème, une affaire ou de s’acquitter d’un devoir. On peut aussi se sentir concerné par le Sacré, mais vouloir rester en dehors de toute religion. On peut également, à force d’études et de réflexions, se définir comme gnostique.
GD : J’imagine assez Pierre Corneille gnostique, après tout il a lu Horace, Rabelais et Montaigne.
DENIS BOISSIER : Et plus encore Dante, lequel était un gnostique. Enfin, indépendamment de ses convictions religieuses ou philosophiques, Pierre Corneille a très bien pu vouloir donner le change. Mettez-vous à sa place. Il a toujours vécu dans un milieu bourgeois et chrétien. Son oncle était curé, son jeune frère Antoine fut presque un saint homme, deux de ses jeunes sœurs se feront religieuses. Et deux de ses filles aussi… Dans ce milieu où la bienséance est reine, un artiste comme Pierre Corneille court le risque d’être jugé et rejeté.
GD : Et Corneille, en homme avisé, aurait caché sa véritable personnalité avec notamment ses traductions pieuses ?
DENIS BOISSIER : Il avait à protéger sa famille et sa gloire difficilement et fragilement établie. A sa façon, Corneille a très bien pu être une sorte de résistant à l’Occupation de la France par les troupes dévotes.
GD : Une sorte de "Père tranquille" de la Résistance intellectuelle…
DENIS BOISSIER : D’un côté, il s’affiche quelque temps marguillier de sa paroisse, de l’autre, il achète plusieurs ouvrages anti-jésuites. D’un côté, il traduit L’imitation, de l’autre, il se lie avec une troupe de farceurs. Il aime son épouse Marie, mais il propose à Marquise du Parc d’être son Pygmalion. Le corneilliste Louis Herland l’a dit : il y a deux hommes en Corneille. Et le spécialiste Louis Rivaille est d’accord sur ce point : Corneille, surtout dans sa jeunesse, a toujours joué double jeu [« Le goût pour une vie mondaine et voluptueuse semble peu compatible avec l’adhésion à une règle ascétique. Cependant l’une et l’autre tendances coexistaient aussi certainement dans l’esprit de Corneille qu’elles voisinent dans ses premières pièces. », Les Débuts de Pierre Corneille, 1936, p. 745]. D’ailleurs pour Rivaille c’est cette ambivalence – il parle même de « tendances opposées » – qui fut le moteur de la carrière de Corneille [« Ce partage de l’esprit de Corneille entre deux tendances opposées a dû être très favorable à sa carrière littéraire. », idem, p. 746]. Il ne croyait pas si bien dire : une de ces tendances a pour visage Corneille, l’autre a pour masque Molière.
GD : Corneille ou le Janus du théâtre.
DENIS BOISSIER : C’est cela… Il n’y a rien d’étonnant à ce que Pierre Corneille ait porté un masque social. Mais ce n’était qu’une image bourgeoise. Tout grand artiste que le sort fait naître dans une famille à la fois bourgeoise et pieuse passe nécessairement pour le vilain canard de la fable. Comme Gustave Flaubert, autre Normand célèbre, Pierre Corneille a dû passer aux yeux de ses proches pour "l’idiot de la famille", celui dont on désespère... Dans sa jeunesse il fréquentait la Basoche, le carnaval et les clubs gouliards [les gouliards étaient les précurseurs des poètes libertins et des chansonniers politiques]. Ensuite, il a toujours été proche de mécréants comme Gaston d’Orléans ou le prince de Condé, ou encore le satiriste Saint-Amant ou le musicien burlesque Dassoucy... Sans parler de Molière et de ses amis qui se réunissaient à la taverne de la Croix-Blanche !…
GD : Je ne suis pas loin de penser, en effet, que Corneille, qui était très prudent, qui avait une famille à protéger et de nombreux enfants à établir…
DENIS BOISSIER : Six.
GD : … ne pouvait pas, sous le règne de Louis XIV, courir le risque de montrer à ses contemporains toute l’envergure de sa personnalité. Surtout s’il menait une carrière discrète de nègre littéraire du plus célèbre des farceurs.
DENIS BOISSIER : N’oubliez pas que les contemporains de Corneille ne l’ont jamais considéré comme un auteur chrétien. On lui a même attribué une poésie que nous dirions aujourd’hui pornographique, L’Occasion perdue et recouvrée, que l’on s’efforce depuis la crise dévote de 1680-1750 d’attribuer à l’obscur poète de Cour Cantenac.
GD : Pourquoi ?
DENIS BOISSIER : Parce que, si elle est de Corneille, cette poésie pornographique porte un coup terrible à son image de "grand chrétien". C’était hors de question en 1750.
GD : Vous pensez que cette poésie est de Corneille ?
DENIS BOISSIER : En tout cas, celui qui a révélé cette paternité n’est pas n’importe qui. C’est François Charpentier, un académicien qui fut le doyen de l’Académie française, et qui connaissait bien Pierre Corneille. On ne peut donc pas dédaigner son témoignage. D’autant que ce témoignage met en scène un homme important, le chancelier Séguier, et qu’il est corroboré par l’académicien Bernard de La Monnoye qui n’est pas non plus n’importe qui. Et La Monnoye dit bien que L’Occasion perdue est une œuvre de jeunesse de Pierre Corneille et que des copies circulaient dès 1650, donc bien avant que cette poésie ne soit publiée anonymement en 1658 dans un recueil galant.
GD : Dans ce cas, pourquoi attribuer cette poésie à Cantenac ?
DENIS BOISSIER : Parce qu’elle s’est retrouvée en 1662 dans le recueil des Poésies nouvelles de Cantenac. Cela a suffi pour que la postérité fasse de lui l’auteur de L’Occasion perdue. Mais c’est oublier que l’Avis Au Lecteur précise que cette publication des Poésies nouvelles a été faite à « l’insu de l’auteur ». C’est donc l’éditeur qui a ajouté au dernier moment un feuillet de quatorze pages entre les pages numérotées "102" et "103" afin d’augmenter les ventes car L’Occasion perdue était très appréciée des amateurs.
GD : Qu’est-ce qui vous fait douter que Cantenac en soit l’auteur ?
DENIS BOISSIER : C’est qu’il a écrit une mauvaise poésie sur le même thème et que je trouve curieux, lorsqu’on est l’auteur d’un petit chef-d’œuvre, qu’on montre qu’on est incapable d’en refaire un. De plus, L’Occasion perdue est signée d’un « C », comme Corneille avait l’habitude de le faire avec les textes qu’il ne souhaitait pas ouvertement reconnaître pour siens.
GD : Cantenac signait comment ?
DENIS BOISSIER : « Le Sieur de C. », « Monsieur de C. » « Le sieur D.C. » également les initiales « D.C. » A ma connaissance, il n’a jamais signé « C », comme, de son côté, jamais Corneille n’a ajouté « Monsieur » ou « Le Sieur de ».
GD : L’argument me paraît valable.
DENIS BOISSIER : Ce n’est pas tout. Puisque l’initiale « C » était connue pour être le poinçon de Corneille, il est peu logique que Cantenac ait signé d’un « C ». Primo, il ne cherchait à demeurer mystérieux car ses cryptonymes ne sont là que par bienséance. Cantenac étant un ecclésiastique, il ne devait pas signer de son nom, voilà tout. Deuxio, utiliser l’initiale « C » c’eût été mettre le grand Corneille dans une situation embarrassante, et il n’avait aucune raison pour cela.
GD : Mais pourquoi Corneille aurait-il, lui, écrit cette poésie que vous dites « pornographique » ?
DENIS BOISSIER : L’académicien La Monnoye dit que c’est une œuvre de jeunesse. Pourquoi pas ? Corneille, qui aimait les femmes faciles et qui au début de sa carrière a fréquenté les mascarades des grands princes mécréants, a nécessairement écrit des textes licencieux. Or nous n’avons aucun de ces textes dans lesquels il jetait sa gourme.
GD : Ce serait une œuvre de jeunesse que Corneille, devenu gloire nationale, aurait voulu oublier ?
DENIS BOISSIER : Oui, une de ces poésies licencieuses qui n’ont pas été publiées par l’abbé Granet, son premier éditeur posthume. Cet abbé précurseur de nos modernes corneillistes avoue sans détours qu’il a censuré Corneille [« Je n’ai pas fait difficulté de supprimer des plaisanteries d’un goût peu délicat et divers traits d’une galanterie trop libre… » préface des Œuvres diverses de Pierre Corneille, 1738].
GD : Vous penchez donc pour l’attribution de cette « poésie pornographique », comme vous l’appelez, à Pierre Corneille ?
DENIS BOISSIER : L’érudit Paul Lacroix était persuadé qu’il en était l’auteur. Pour ma part, l’empressement qu’ont eu les « dévots » du XVIIIe siècle à dédouaner Corneille de cette œuvre m’incite à me méfier. Et aussi le fait que Cantenac n’a rien écrit d’aussi bon que ces « stances » licencieuses, alors que de la part de Corneille, elles peuvent passer pour une production rapide et inspirée. Au final, nous avons pour l’attribution à Corneille deux témoignages sérieux, l’Avis au Lecteur qui nous apprend que l’éditeur a agi seul, et l’initiale « C ». Tandis que pour l’attribution à Cantenac nous avons uniquement la volonté des dévots de 1750 de faire de Corneille un « poète chrétien ».
GD : Qu’en pense la critique moderne ?
DENIS BOISSIER : La paternité de Cantenac lui convient, évidemment !
GD : Parce que cela ne force personne à ouvrir une contre-enquête ?
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Puisqu’il est admis que Cantenac est l’auteur de L’Occasion perdue recouvrée, quel universitaire aurait l’idée d’aller contre l’opinion consensuelle de ses pairs et de jouer sa carrière en remettant en cause une paternité qui contente tout ce petit monde.
GD : Décidément Pierre Corneille est un personnage bien gênant. On ne veut pas de lui dans les affaires de Molière, on ne veut pas de lui dans la poésie libertine…
DENIS BOISSIER : Dans notre société on ne veut de lui nulle part. La France n’a même pas fêté en 2004 le quatrième centenaire de sa naissance. Toutefois la paternité de Cantenac est loin d’être évidente car aucun universitaire n’a encore cherché à l’établir sérieusement.
GD : La piste Pierre Corneille n’est donc pas à dédaigner.
DENIS BOISSIER : Une chose est certaine : Corneille fut accusé par des intellectuels chrétiens comme le prince de Conti ou Nicole d’être un poète païen et d’œuvrer dans le giron de l’hérésie. Comme je vous l’ai dit, même sa traduction de L’Imitation de Jésus-Christ, selon l’abbé d’Aubignac, contenait plus d’une centaine d’hérésies [Troisième dissertation, 1663, p. 162].
GD : Et j’imagine que d’Aubignac parlait en connaissance de cause.
DENIS BOISSIER : Bien mieux que les biographes modernes de Corneille. Voyez-vous, il ne suffit pas de traduire des textes pieux pour être un "auteur chrétien". De même, si nous cessons de croire qu’un auteur n’est que ce qu’il écrit, nous commençons à comprendre que Corneille a nécessairement utilisé plusieurs plumes et que la plus libre de ses plumes n’est pas forcément celle dont il s’est servi sous son nom. Pierre Corneille était un homme secret, un homme du clair-obscur.
GD : Il semble en effet le modèle idéal pour un peintre comme Rembrandt. On a donc exagérément affadi l’image de Corneille ?
DENIS BOISSIER : On a privilégié le portrait qu’ont brossé de lui ceux qui ont subi la crise dévote qui a dirigé la France à partir de 1680. Cet esprit dévot s’est même montré intolérant après 1700. Dans ces conditions, que voulez-vous qu’il reste du vrai et contradictoire Pierre Corneille ? C’est à cause de cette stalinisation chrétienne des esprits que le païen et libertin, pour tout dire le rabelaisien Corneille, a été métamorphosé en un auteur rigide, contrit et bienséant. Et ce qu’on a fait pour Corneille on l’a fait aussi, plus modestement, pour Boileau, Racine, La Fontaine. En revanche, on a accumulé les mensonges pieux et les omissions par contrition pour Molière. Ce même Molière que son contemporain Rochemont avait défini comme un « homme et démon tout ensemble » [La Lettre sur la comédie de l’Imposteur, 1667]. Le Britannique Edric Caldicott a remarqué que la Troisième République avait « réinventé » les auteurs qui avaient travaillé sous Louis XIV [« Le Panthéon français était déjà occupé au dix-neuvième siècle par les auteurs de l’ancien régime, il avait fallu les réinventer, surtout ceux de la Cour de Louis XIV. » La Carrière de Molière entre protecteurs et éditeurs, 1998, p. 150].
GD : Il faut donc appréhender les artistes du XVIIe siècle comme des êtres qui jouent un jeu social et qui nous cachent l’essentiel de ce qu’ils ont à nous dire.
DENIS BOISSIER : Exactement. La Troisième République a créé son panthéon, et n’a pas hésité à tout réaménager. Nous évoquions Désiré Nisard, le patron du Collège de France. C’est lui qui a dit qu’en France « on n’est pas libre de ne pas lire Boileau » [« Depuis près de deux siècles, non seulement aucun gouvernement, mais aucun système d’enseignement, ne l’a retranché des études nécessaires. Nous apprenons à lire dans ses ouvrages ; nous en sommes imbus ; Boileau est dans nos veines. On n’est pas libre en France de ne pas lire Boileau. » Histoire de la littérature française, 1854, T. 4, p. 293]. On n’est pas non plus libre, en France, de ne pas lire Molière. Et il est même interdit de ne pas le vénérer.
GD : Comme vous, je suis persuadé que Corneille, pour reprendre une expression de l’écrivain Jacques Chardonne, c’est beaucoup plus que Corneille. Et je suis d’avis que Molière, je veux dire le Molière des moliéristes, n’est pas tant un être individuel que le résultat d’une époque.
DENIS BOISSIER : Il ne vous manque plus qu’à donner un nom et une fonction à ce « fait sociologique » qui a produit le théâtre moliéresque.
GD : J’hésite encore à affirmer que Molière était le bouffon du roi. Même si c’est le cas, cette fonction est réductrice. Elle ne laisse de place ni à l’écrivain ni à l’homme.
DENIS BOISSIER : Vous faites du sentimentalisme.
GD : Certainement.
DENIS BOISSIER : Molière ne peut se comprendre que si l’on accepte de voir en lui le produit de son époque. Son action sociale, les scandales qu’il provoqua, son impunité, son enterrement obscur et controversé, ne s’expliquent que si l’on admet qu’il n’était pas un écrivain mais le bouffon du roi. Le théâtre moliéresque ne s’explique parfaitement que si l’on met en avant les mécanismes du milieu social et politique dans lequel, par lequel et pour lequel il s’exprima. C’est à cause de cela que la thèse des moliéristes, qui se refuse à toute analyse historico-critique, accumule les incohérences, les anomalies ou les obscurités. Vouloir expliquer le cas Molière à partir des états d’âme d’un individu est insuffisant puisque cent cinquante ans de moliérisme n’y sont pas parvenus. Même si l’on fait de Molière un écrivain idéal, et même surhumain, on ne réussit pas à gommer de très lourdes contradictions.
GD : En résumé, selon vous, Molière est un fait sociologique indépendant de l’individu Jean-Baptiste Poquelin. Disons-le autrement : le théâtre moliéresque est un certain état de la conscience collective de son temps.
DENIS BOISSIER : Exactement. Molière n’est pas un « grand écrivain », encore moins « un génie sans pareil » tel que le rêvait Désiré Nisard. En revanche, son théâtre collégial est la synthèse, plus ou moins réussie (et plus souvent mal que bien), de plusieurs petits écrivains plus un immense, qui ont travaillé dans l’urgence afin de répondre à la demande. Comme Shakespeare avant lui et Alexandre Dumas après lui, Molière est un fait sociologique dans l’acception d’Emile Durkeim, c’est-à-dire devant être compris en dehors de toute manifestation individuelle. A défaut de cette clef de lecture, les moliéristes ont obtenu une dizaine de "Molière" différents les uns des autres, et incompatibles entre eux.
GD : C’est le pain quotidien des universitaires, sinon il y aurait du chômage…
DENIS BOISSIER : Certes, toutes ces lectures qui se contredisent font marcher le commerce universitaire, mais cela a eu pour effet pervers qu’on prend désormais Molière pour une sorte de demi-dieu, et pour conséquence néfaste qu’on lui voue un culte national. La mécanique universitaire nous a privés de la vérité historique et du plaisir de n’être pas dupes de cette politique de l’autruche qui nous fait croire aux vertus d’un Grand Siècle.
GD : …Un Grand Siècle qui, selon vous, n’a existé que dans l’idéologie des universitaires de la Troisième République. Et nous voici revenus à notre point de départ, quand, dans notre Premier dialogue, nous cherchions à savoir si le XVIIe siècle était bien, comme on l’affirme, le siècle "classique". Vous nous aviez dit que vous vous défiiez beaucoup de l’étiquette "classique" parce que derrière elle vous deviniez plusieurs arrangements idéologiques avec l’Histoire. Votre point de vue sur la notion de "classicisme" ébranle si vigoureusement certaines habitudes de penser que je crois nécessaire de terminer cette série d’entretiens par où nous l’avons commencée.
DENIS BOISSIER : Le "classicisme", si jamais il a existé tel que l’Université française, et elle seule, le définit depuis 1880 n’a duré qu’une décennie, aux environs de 1668. Encore n’y a-t-il jamais eu à proprement parler d’"école classique", conclusion que corroborent les études d’éminents dix-septiémistes comme René Bray ou Raymond Picard. Aussi, je n’hésite pas à dire que le "classicisme" est une vision démagogique mise en place durant la Troisième République pour permettre à l’art aristocratique louis-quatorzien d’être compatible avec un public bourgeois qui voulait, après la défaite de Sedan [1870], asseoir son idéologie républicaine. On a donc présenté cet art aristocratique (donc, par nature, non démocratique) comme un art "classique", quasiment "hors du temps", pour occulter l’idéologie royaliste qui était la sienne.
GD : On a bien réussi, semble-t-il.
DENIS BOISSIER : On a mis exclusivement en avant une certaine perfection formelle, perfection étroite et abstraite, mais qui avait l’avantage de n’offrir aucune prise aux commentaires politiques que cet art, sinon, aurait immanquablement suscités. Ainsi, cet art ayant été déclaré a-politique (alors qu’en 1670 il était on ne peut plus politique), il put servir dans son nouvel habillage les intérêts de la République anticléricale et être enseigné à l’Ecole.
GD : Une république anticléricale, certes, mais studieusement entichée d’un Molière dont elle instaurait le culte national.
DENIS BOISSIER : Comment faire autrement pour qu’un farceur aux ordres du Roi puisse être perçu deux cents ans plus tard comme un héros pré-républicain ? Puisque Molière n’avait rien été de son vivant, sinon, en tant que bouffon du roi, un catalyseur des scandales latents de son époque, il fallait, de façon posthume, qu’il devienne pour le moins un demi-dieu. C’est ce que font toutes les religions qui prétendent d’un homme faire un modèle insurpassable.
GD : Il est bien certain que la Sorbonne et la Comédie-Française ont brossé un portrait idéal auquel il est depuis longtemps interdit d’apporter la moindre retouche. Mais revenons à ce Grand Siècle dont on vante tant les mérites et qui serait, en quelque sorte, l’écrin d’où se dégagerait le joyau Molière. Vous dites que sous le règne de Louis XIV les artistes, qui étaient pensionnés, n’ont fait qu’obéir à un roi qui, par peur de la noblesse et de l’Eglise, voulait rompre avec le passé.
DENIS BOISSIER : Louis XIV craignait l’esprit féodal qui avait jusqu’ici si bien réussi à la France, notamment en littérature et en architecture. Louis XIV avait peur de l’esprit féodal parce qu’il donnait beaucoup de pouvoir aux seigneurs. Aussi Louis XIV, Colbert et Louvois se sont-ils empressés de remplacer cet esprit féodal par l’esprit bourgeois dont la première caractéristique est d’être spontanément servile.
GD : Nous devrions donc détester l’esprit Grand Siècle puisque nous croyons l’aimer pour tout ce qu’il n’a jamais été.
DENIS BOISSIER : Nous l’admirons parce que nous prêtons à ce siècle la force et l’élévation qui lui ont manqué. Nous sommes triplement hypocrites : primo : le XVIIe siècle n’avait pas les vertus que nous lui prêtons ; deuxio : nous les lui prêtons les yeux fermés ; tertio : nous nous gargarisons de ces vertus dites "classiques", mais nous n’en voulons surtout pas pour nous-mêmes !
GD : C’est un peu, me semble-t-il, comme si nous prétendions aimer la cérémonie des césars pour tout ce qu’elle a de sincère, de spontané et d’authentique, alors qu’en coulisses ce ne sont que magouilles, vanités et business.
DENIS BOISSIER : C’est précisément ce que l’on appelle l’hypocrisie bourgeoise. Tout le monde fait semblant d’y croire, mais au fond personne n’est dupe.
GD : D’un autre côté, comment critiquer un XVIIe siècle que l’on a appris à vénérer depuis sept ou huit générations ? Quand vous êtes un chercheur, vous devez aller dans le sens du courant, sinon on ne publie pas vos recherches.
DENIS BOISSIER : Tout le problème en France est là. Les chercheurs ne sont pas libres de tout dire. Non pas à cause de la censure, elle est presque inexistante, mais à cause du consensus et de l’audimat.
GD : Heureusement qu’internet existe ! Mais puisqu’on nous impose d’admirer sans réserve les artistes "classiques", que diriez-vous à un étudiant ès Lettres ?
DENIS BOISSIER : Je lui dirais que les artistes "classiques" ont mis en place un art certes rigoureux, mais courtisan ; qu’ils n’ont œuvré ni pour le Peuple ni pour servir l’Art, comme le feront courageusement certains artistes romantiques. Et que, tout en étant aristocratiques dans l’âme, les artistes "classiques" ont été, pour plaire au roi, favorables à l’esprit mercantile de la bourgeoisie qui voulait tenir le rôle social des seigneurs d’antan, mais, bien sûr, sans menacer Louis XIV.
GD : Elle ne voulait pas inquiéter le roi puisqu’elle avait beaucoup à gagner avec lui.
DENIS BOISSIER : Oui, seul l’appât du gain intéressait les grands bourgeois et Louis XIV leur permettait d’en gagner toujours plus. Très vite les financiers ont remplacé les aristocrates, le théâtre collégial de Molière s’est substitué à la tragédie chère à l’esprit féodal, et ce théâtre bouffon a préparé la venue du théâtre de boulevard de 1860. Ce que nous appelons le "classicisme" illustre le contraire de ce que nous lui faisons dire aujourd’hui : nous prétendons que l’esprit classique s’est émancipé de l’esprit féodal alors qu’il en a continué toutes les caractéristiques, mais forcément avec un langage et une petitesse morale adaptés au nouveau contexte. C’est l’esprit féodal version bourgeoise. Le seigneur est devenu un financier, mais l’arrogance est la même, à ceci près que l’esprit de la noblesse et son code de l’honneur, eux, sont définitivement morts. C’est le temps de l’ « honnête homme », expression qui signifie le contraire de ce que peut être un homme honnête.
GD : Pour vous, l’esprit dit "classique" serait l’antithèse à la fois de l’esprit féodal et de l’esprit républicain.
DENIS BOISSIER : Oui, c’est une parenthèse qui s’est refermée d’elle-même. De la même façon que, selon Marx, le capitalisme secrète son propre poison, la parenthèse classique s’est auto-détruite par excès de fatuité, d’hypocrisie et de bienséance.
GD : Une sorte de colosse d’or aux pieds d’argile.
DENIS BOISSIER : Cette image lui convient bien. De la même façon que Versailles a été bâti sur des marécages, le classicisme s’est élevé à coups d’injustice sociale, de vanité intellectuelle et de frilosité morale. Le grand écrivain du règne de Louis XIV, ce n’est pas Pierre Corneille ou Blaise Pascal. C’est Jean Chapelain, l’auteur de la Pucelle, un courtisan aux ordres du roi et un capitaliste convaincu qui avait un mépris total de la "populace" (c’était le terme de l’époque). Critiquer les écrits de Chapelain, c’était presque un délit contre l’ordre public. Des comédiens qui l’avaient ridiculisé dans leur théâtre ont été immédiatement sanctionnés. Qu’y a-t-il chez Chapelain de "classique", au beau sens de ce terme ? Rien. Tout chez lui est creux et grandiloquent, terne et lourd. Seule son immense correspondance est intéressante car elle nous révèle l’homme derrière le pontife.
GD : Des artistes comme Racine ou Molière ne sont-ils pas "classiques" pour avoir combattu l’influence de Chapelain ?
DENIS BOISSIER : Vous savez bien que l’esprit d’une époque est presque toujours plus fort que l’esprit des individus. Même Racine a pris Chapelain pour juge de ses essais poétiques. Il écrit dans une lettre « Voici le jugement de M. Chapelain, que je rapporterai comme le texte de l’Evangile, sans y rien changer. ». Quant à Molière… Brossette, secrétaire de Boileau, raconte que Molière avait exhorté Boileau à épargner dans ses satires Chapelain, protégé de Colbert et du roi.
GD : Mais Boileau a critiqué La Pucelle, l’œuvre majeure de Chapelain !
DENIS BOISSIER : Qu’est-ce que cela prouve ? A vingt-cinq ans Boileau se moquait de tout le monde, même de Molière [lire « Boileau, d’Aubignac, La Fontaine dévoilent la collaboration Corneille-Molière », rubrique A LIRE EN PRIORITE ; aussi le Quatrième dialogue]. Le Grand Siècle n’a jamais été le siècle d’hommes fiers et authentiques, mais celui de la "courtisanerie" et du « bouffonnariat". Un siècle si infatué de son roi et si satisfait de lui-même qu’il mit le père Lemoine, un poète de Cour, au même rang que Virgile.
GD : Décidément, nous avons une vision trop ensoleillée du règne du Roi-Soleil.
DENIS BOISSIER : Celle des manuels scolaires. Il y a dans notre compréhension universitaire du "classicisme" une simplification idéologique grâce à laquelle on a pu faire admirer aux républicains les porte-parole de l’esprit courtisan.
GD : Il n’y a personne qui trouve grâce à vos yeux ?
DENIS BOISSIER : Eh bien, si, il y en aurait un… Je crois bien que Pierre Corneille est le seul auteur de ce siècle sournois à avoir réussi à être simultanément des deux bords : d’un côté, l’esprit rabelaisien et féodal pur et dur (celui qui avait cours sous le règne de Louis XIII), de l’autre, l’esprit bourgeois mercantile et superficiel. En cela, aussi, Corneille est remarquable.
GD : On pourrait aussi dire que c’est le comble de l’hypocrisie !
DENIS BOISSIER : Bien sûr ! Corneille a parfois été hypocrite ! Comment voulez-vous qu’il ne soit pas hypocrite quand l’hypocrisie était l’air intellectuel que tout le monde alors respirait. Mais au-delà de cette hypocrisie bienséante, et tandis que tous ses confrères s’adonnaient à une propagande aristo-fascisante, Corneille est le seul à avoir affirmé qu’il écrivait pour le peuple. Il a eu ce courage républicain alors que, pour des raisons artistiques, il défendait les plus belles idées réactionnaires : l’honneur, le mérite, la maîtrise. Il est aussi le seul à avoir assumé, sans protection (exceptée celle, indirecte, de Molière), sa condition d’écrivain. Il est le premier de nos vrais écrivains, c’est-à-dire le premier à ne vivre que de sa plume, et plutôt mal. Oui, il est le premier à avoir pris ce risque…
GD : Molière aussi a couru des risques…
DENIS BOISSIER : Molière a toujours été aux ordres de son maître et n’a flatté ouvertement que la Cour. Certes, parfois, parce que Corneille était là ou que cela favorisait la politique du roi, Molière est allé du côté de la fierté du peuple, mais toujours il retombe dans la rigolade, le scabreux ou le scandaleux. Relisez L’Ecole des Femmes ou Tartuffe. La part de Molière est aussi bouffonne que celle de Corneille est dramatique. Toutes deux s’opposent mais ce complètent admirablement.
GD : Oui, nous avons vu que la dichotomie entre l’écriture de Corneille et la mise en scène de Molière suscite des ruptures de tons et des contradictions dont les moliéristes ne se sont jamais dépêtrés [lire : Troisième dialogue].
DENIS BOISSIER : Savoir que Molière avait pour « emploi » de rabaisser ce qui est, ou pourrait être, grand a dû souvent agacer Corneille. Mais Corneille savait qu’au delà de l’esprit grotesque et de la bouffonnerie il y a l’esprit du Peuple, cet esprit qui, lorsqu’il n’est pas galvaudé comme l’a trop souvent fait Molière, ce que lui reprochait d’ailleurs Boileau dans son Art poétique [1674], est le vrai sel de la terre.
GD : Le Grand Siècle n’aurait donc rien à voir avec l’esprit du peuple que vous appelez « le sel de la terre ».
DENIS BOISSIER : C’en est même la négation. Le prétendu Grand Siècle du "classicisme" est la mise à mort de la liberté rabelaisienne et de l’esprit de Montaigne. Seul La Bruyère a combattu « l’esprit Grand Siècle » et a préféré la prose du XVIe siècle. Le siècle "classique", en littérature, ce n’est pas Racine, c’est le père Bouhours. Pour le père Bouhours, le Français louis-quatorzien appartenait à la race supérieure, tout en lui était parfait, jusqu’au son de sa voix [« De toutes les prononciations, la nôtre est la plus naturelle et la plus unie. Les Chinois et presque tous les peuples de l’Asie chantent ; les Allemands râlent ; les Espagnols déclament ; les Italiens soupirent ; les Anglais sifflent. Il n’y a proprement que les Français qui parlent. »]. C’était le père Bouhours la référence de ces Messieurs de l’Académie française. Et qu’a apporté aux Lettres l’Académie française ? Rien.
GD : Si, un dictionnaire.
DENIS BOISSIER : Même son Dictionnaire a été écrit à l’extérieur d’elle, principalement par Furetière que les académiciens avaient excommunié. Sous le joug de Louis XIV l’inculte, ce sont les gens de qualité qui dictent le bon ton dans les Lettres, les arts et les mœurs. Rappelez-vous la phrase de Flaubert « J’appelle bourgeois quiconque pense bassement. » La pensée bourgeoise étant ce qu’elle est, et poursuivant les buts que l’on sait, quoi qu’elle entreprenne, elle reste basse. Savez-vous qui était tenu pour le plus grand poète de la fin du XVIIe siècle "classique" ? Chaulieu, à moins que ce ne soit La Fare… ou peut-être bien La Faye. De parfaits médiocres.
GD : En résumé, ce que nous avons retenu du Grand Siècle c’est précisément ce qui le caractérise le moins, et les hommes que nous admirons aujourd’hui n’étaient pas ceux que les "classiques" eux-mêmes portaient aux nues.
DENIS BOISSIER : Ce ne sont ni Descartes ni Pascal qui sont consubstantiels au Grand Siècle mais Chapelain et Houdar de La Motte. Ce qui caractérise le Grand Siècle, ce n’est pas l’art, mais la religion dans son aspect le plus bigot. Et cette religion de salon englobe les dévots dépeints par Corneille-Molière jusqu’aux financiers de Turcaret [comédie de Le Sage créée en 1709 ; cette satire contre les financiers parvenus provoqua de leur part un scandale comparable à celui de Tartuffe]. Rien n’est plus rétrograde ou conservateur que l’esprit qui règne de 1670 à 1715. Tout le monde est le domestique de quelqu’un, même La Bruyère, domestique de la maison de Condé. Il n’y a pas à proprement parler de philosophes, mais des bourgeois contre le peuple, des bourgeois contre les protestants, des bourgeois qui – vanité des vanités – s’auto-proclament éclairés et mesurés. Dans ce Paris qui pue la crotte, cherchez autant que vous le voudrez des "classiques", vous ne rencontrerez que des monarchistes écartelés entre la soif du pouvoir et la faim d’une liberté à laquelle, finalement, ils se refusent.
GD : Sans doute aussi parce que la Bastille, les galères, l’échafaud ou la déportation étaient là pour les rappeler à l’ordre.
DENIS BOISSIER : Bien sûr. Ce qui caractérise sociologiquement l’esprit du Grand Siècle, ce ne sont pas, comme nous voulons le croire, les tragédies de Racine ou les opéras de Lully, c’est la guerre des Anciens et des Modernes dont nos élites ne parlent presque jamais. Vous savez ce que cachait cette guerre ? Le dégoût pour la simplicité des mœurs et la sincérité des sentiments. On voulait exterminer l’esprit antique et païen, c’est-à-dire l’essentiel de ce qui avait animé les hommes jusqu’à 1660 environ. Cette éradication du sentiment populaire, menée par le général de la propagande Charles Perrault, s’apparente pour moi à du fascisme intellectuel.
GD : Cette guerre a commencé quand ?
DENIS BOISSIER : Disons en 1670, donc du vivant de Molière, et elle finit à peu de chose près à la mort de Louis XIV, en 1715. Le christianisme social qui était alors de mise balaie tout ce la France avait de vif, de spontané, de rugueux et de bon enfant. C’en est fini de Rabelais et de Montaigne. Et c’est ce siècle de terrorisme intellectuel que l’on appelle le « Siècle classique » ! C’est par trop simplifier ou donner trop de poids aux mots.
GD : Précisément, quel emploi faisait-on du mot "classique" sous Louis XIV ?
DENIS BOISSIER : Le mot "classique", dans le Dictionnaire de l’Académie française de 1694, ne s’emploie que dans l’expression « auteur classique », et il signifie : « qui est fort approuvé et qui fait autorité dans la matière qu’il traite ». Donc, lorsque nous disons du XVIIe siècle qu’il est "classique", nous affirmons que la façon dont l’élite de ce temps-là pensait doit être approuvée par nous. Or, comme je vous l’ai dit, cette pensée est par essence anti-démocratique et plus encore, si c’était possible, anti-républicaine.
GD : Nous commettons donc un abus de langage.
DENIS BOISSIER : A l’évidence, puisque nous ne pouvons décemment pas admirer ce qui nie nos valeurs fondamentales.
GD : Le XVIIe siècle a tout de même introduit la notion de progrès.
DENIS BOISSIER : C’est vrai. Mais faut-il s’en réjouir ? « Du passé faisons table rase », cela ne vous rappelle rien ? Le progrès, selon Fontenelle, c’est affirmer que le dernier qui parle a forcément raison. Puisque nous venons après les Grecs, après les Gaulois, après tout le monde, nous sommes donc plus intelligents qu’eux. Nous sommes supérieurs à tous ceux qui nous ont précédés. Seule notre façon de penser et de vivre est la bonne. Voilà ce qu’est la notion "classique" du progrès. Un tel présupposé est intrinsèquement dangereux.
GD : Cela évoque en effet de fâcheux souvenirs. Mais ce préjugé, nous en avons en partie hérité puisque nous disons encore d’une civilisation qu’elle est "primitive", alors qu’elle est seulement antérieure à nous. Nous essayons d’ailleurs de nous en corriger, puisque l’on ne dit plus aujourd’hui « primitives » mais « premières »…
DENIS BOISSIER : Il reste encore beaucoup de préjugés du Grand Siècle dans nos mentalités d’hommes dits modernes. La force des préjugés est redoutable. Même un intellectuel comme Boileau, adversaire farouche de Perrault, a fini par rejoindre le consensus et fait amende honorable dans une lettre publique écrite en 1700. Tous les régimes totalitaires exigent des amendes honorables, organisent des procès et multiplient les autodafés. Le XVIIe de Louis XIV fut le siècle d’un régime politique que l’on pourrait appeler le National-Monarchisme Moderniste Chrétien.
GD : Amusant.
DENIS BOISSIER : Appeler ce siècle "classique" c’est, au final, admirer une élite qui n’a rien compris à Homère ni à Montaigne, très peu à Corneille, qui a détruit le génie de Racine et a forcé La Fontaine et Boileau à se renier. C’est admirer des hommes et des femmes qui ont trouvé dans le bouffon du roi un prétexte pour rire de tout. C’est admirer des intellectuels qui n’ont fait un dictionnaire et des règles de grammaire que pour interdire tous les mots nouveaux qui avaient envie de naître et qui venaient presque tous du peuple.
GD : Mais Molière, lui, aimait le peuple.
DENIS BOISSIER : Ce qu’il aimait plus encore, me semble-t-il, c’est obtenir le rire du peuple, car ce rire lui assurait la fortune et le confortait dans son métier d’amuseur public et dans son « emploi » de bouffon du roi.
GD : Personne ne trouve donc grâce auprès de vous ?
DENIS BOISSIER : Personne ! C’est d’ailleurs pour cela que l’on a fait un jour la Révolution.
GD : Personne… sauf Pierre Corneille.
DENIS BOISSIER : Parce que Pierre Corneille est un homme du siècle de Louis XIII. Pour Louis Rivaille, Corneille sortait même tout droit du moyen-âge [« La pensée de Corneille est à l’aboutissement d’une manière de penser du moyen-âge… » Les Débuts de Pierre Corneille, 1936, p. 757].
GD : C’est pour cela selon vous que les sujets de Louis XIV l’ont délaissé.
DENIS BOISSIER : Je ne vois pas d’autre raison.
GD : Et c’est parce qu’il avait encore l’esprit rempli du théâtre de tréteaux et des soties du moyen-âge que Corneille a pu écrire pour le théâtre de farces et de satires de Molière ?
DENIS BOISSIER : J’en suis persuadé. Savez-vous ce que disait l’écrivain provençal Jean Giono ? « A Paris, je suis connu sous le nom de Marcel Pagnol ». Eh bien, dans le Paris de Louis XIV, le Rouennais Corneille était applaudi sous le nom de Molière.
GD : Ce sera, si vous le voulez, le mot de la fin.
DENIS BOISSIER : Oui, gardons pour l’avenir le nom de...

Pierre Corneille.